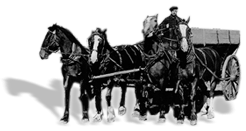Revue historique: volume 1 numéro 2
Une Fransaskoise se raconte
par Lucille Tessier
Vol. 1 - no 2, mars 1991
Vol. 1 - no 2, mars 1991
Gens du pays
Lorsque j'ai appris au printemps que le thème de ce colloque serait “Héritage et avenir des francophones de l'Ouest,” je me suis mise à réfléchir sur mon propre héritage. Cette expérience m'a valu une surprise, une prise de conscience. Je me savais depuis toujours une Franco-Canadienne, une Fransaskoise. Mais ces réflexions au sujet de mon héritage m'ont amenée à faire deux observations : d'abord, retracer l'arbre généalogique de ma famille, c'est faire un long trajet de deux cents ans, à partir de Paris, jusqu'en Saskatchewan, traçant au passage le développement du Canada français.
Deuxièmement, je me suis rappelé les efforts et les sacrifices faits par mes parents afin de conserver la langue française, la culture canadienne-française dans notre foyer. Ce matin, ce n'est pas une communication savante que je me propose de faire. Je voudrais plutôt vous faire part de mon héritage personnel.
Le premier ancêtre français qu'on retrouve au Canada est un Raymond Bourdages1. En 1755, il est maître chirurgien de la garnison du lieutenant Charles de Boishébert à la rivière Saint-Jean en Acadie. Né en 1728 vraisemblablement en France, il est en Acadie depuis quelque temps puisqu'il a déjà épousé une Acadienne, Esther Leblanc. Après la chute du fort Beaubassin en 1755, Raymond Bourdages se rend à Québec. Grâce à des documents qui ont été conservés dans la famille, on sait qu'en 1760 il fait un voyage en Europe apparemment dans le but de régler une succession ou de recevoir sa part d'héritage de ses parents. Un de ses fils, Louis, s'établira à Saint-Denis-sur-Richelieu en 1789 où il deviendra un des fondateurs du journal Canadien lancé par un groupe de députés patriotes. À l'Assemblée législative du Bas-Canada, Louis Bourdages propose en 1832 que le Conseil législatif soit élu, proposition qui ne sera pas acceptée, même avec l'appui de Papineau. David, fils de Louis Bourdages, participera à la bataille de Saint-Denis.
Revenons au grand-père, Raymond Bourdages. Au début des années 1770, il accompagne en Gaspésie le père de la Brosse, missionnaire du golfe Saint-Laurent. C'est vers cette époque qu'il décide de s'installer avec sa famille à Bonaventure, où certains Acadiens, ayant échappé aux troupes anglaises, s'étaient installés sur la rive nord de la Baie des Chaleurs. Raymond Bourdages devient le premier marchand de l'endroit et possède des moulins à farine et à scie. Une copie de son testament démontre qu'à sa mort, il possède de vastes propriétés. Il doit être un personnage assez important puisqu'il est enterré sous le choeur de l'église avec le curé. (Aujourd'hui, plus de deux cents ans plus tard, mon cousin Alexis Bourdages habite toujours, au premier rang à Saint-Siméon, la ferme d'un des descendants de ce premier ancêtre.)
Mon père, Jean Bourdages, quitte Saint-Siméon à l'âge de quatorze ans. “On crevait de faim, il n'y avait plus de terres,” nous dira-t-il plus tard. (En effet, mon père montrait à une de mes soeurs, il y a quelques années, le bout de terrain qui aurait été son patrimoine s'il était resté à Saint-Siméon. Et ma soeur de s'exclamer : “Mais papa, le jardin sur notre ferme était plus grand que ça!”) Pendant une dizaine d'années, mon père est cuisinier dans les chantiers de bois, voyage à travers le Canada, débarque en Angleterre en 1917 grâce à la conscription. Après la guerre, il reprend ses déplacements pour enfin s'installer à Verwood, Saskatchewan, en 1920, à douze milles au nord de Willow Bunch. A Verwood, il fait la connaissance de Madeleine, fille de Prudent Lapointe.
Prudent Lapointe est un des pionniers de Willow Bunch(2). Ses mémoires débutent par cette phrase : “À l'âge de 19 ans, ayant le goût des voyages et aventures, et ayant aussi mon frère Joseph résident à Willow Bunch, je décidai de visiter l'Ouest canadien.” Il quitte Montréal le 27 mars 1883 par le Canadien Pacifique. Cette ligne de chemin de fer n'ayant pas encore été terminée, il doit faire un détour par Chicago et Saint-Paul. Cinq jours plus tard, il arrive à Regina, qui, à ce temps-là, n'était qu'une ville de tentes. Pendant trois mois, il travaille comme commis dans le premier magasin de la ville, le magasin de Pascal Bonneau, tandis que celui-ci s'occupe d'arpenter les rues de Regina. Ensuite, Prudent Lapointe va rejoindre son frère Joseph à Talle-de-Saules. (C'est ainsi qu'on nommait le village de Willow Bunch à l'époque.) C'est le cinquième Canadien français à s'y établir avec Joseph et Jean-Louis Légaré. Le 5 décembre de la même année, étant jeune, ne pensant qu'à l'aventure, il part avec un groupe de Métis pour aller faire la chasse aux bisons. Il a comme équipement un bon cheval, un fusil, des provisions pour un mois. Mais la vie de chasse n'est pas aussi rose qu'il l'avait imaginée. Les chasseurs n'arrivent pas à trouver les troupeaux de bisons, il fait tempête, les provisions font défaut. Voici comment mon grand-père décrit le Jour de l'An 1884 :
“Nous manquions de tout.... Pour notre journée, nous avions seulement un (rat musqué) à séparer entre cinq personnes. Croyez-moi, cette journée-là j'ai pensé aux bonnes tourtières à maman. Malgré notre position, il n'y avait pas de découragement, il y avait même des farces. Un de nos compagnons avait une pance d'un animal qui avait traîné parmi la viande empoisonnée. Nous décidâmes de la faire cuire sur la braise : il paraît que le feu purifie tout. Aussitôt dit, fut fait, et le mets apprêté ne me sourit guère, mais il faut y goûter. Quel drôle de goût, c'est comme si je m'étais attaqué à des gros essuie-mains, a n'a point de goût mais mes associés me disent qu'elle est bonne. Enfin c'est fait et je ne voudrais pas recommencer.”
Après cette expérience M. Lapointe devient commis au magasin de Jean-Louis Légaré pendant une vingtaine d'années.
Lorsque commence à déferler vers les plaines de l'Ouest la grande vague d'immigration, Prudent devient agent des terres de la Couronne. Voici un autre passage de ses mémoires :
“(En 1906) nos Canadiens de la province de Québec ont commencé à arriver pour prendre des Homesteads.... Je tenais à former une Bonne Paroisse, il était assez difficile de le faire car la majorité des immigrants étaient de toutes nations et convoitaient les belles terres que nos Canadiens détiennent aujourd'hui, mais ils n'osaient venir trop près de l'église et je leur donnait (sic) une poussé (sic) plus au sud....”
Comme cette citation le montre, les pionniers de la première heure tiennent à fonder dans l'Ouest canadien des paroisses québécoises. Très attachés à leurs traditions, à leur langue et à leur foi, ils veulent préserver cet héritage culturel. Dans ce but, ils établissent des institutions religieuses et scolaires, des associations patriotiques : à Willow-Bunch, en 1870, alors que les Métis ne sont encore qu'une race nomade, ils reçoivent les soins sacerdotaux des Oblats-missionnaires de la Mission de Qu'Appelle. Quand les premiers colons viennent s'inscrire pour un homestead au bureau de Prudent Lapointe, il existe donc un clocher autour duquel ils peuvent se regrouper. Il en va de même pour l'école : en 1888, on établit une école catholique libre dirigée par Joseph Lapointe. Il a la charge de 28 élèves. Le secrétaire-trésorier, Prudent Lapointe, doit aller de porte en porte afin de percevoir les contributions, lesquelles en 1891 se montent à 176 $. En 1914, les Filles de la Croix, une communauté de religieuses françaises, viennent prendre la direction de l'école du village et fonder un couvent. Les Canadiens français, eux, fondent une société Saint-Jean-Baptiste en 1911. (3) On prend comme devise “Rendre le peuple meilleur.” C'est cette société qui réunit les Canadiens français de la paroisse, qui conçoit, organise et coordonne les diverses activités. La colonisation, les arts, les sports, les écoles - chaque domaine de la vie de la communauté reçoit ses soins vigilants et paternels. Prudent Lapointe remplit les fonctions de président et de secrétaire-trésorier à plusieurs reprises.
Entre-temps, grand-père Lapointe avait épousé Elizabeth Ouelette de Saint François Xavier au Manitoba. En 1870, un grand nombre de Métis, ayant perdu leurs terres ou se les étant fait voler lors de la création du Manitoba, se sentant de plus persécutés, avaient quitté la Rivière Rouge. Tandis que quelques-uns s'établissaient à Prince Albert et à Batoche, une quarantaine de familles s'étaient rendues au sud du district d'Assiniboia près de la frontière du Montana. Ces Métis formaient une population nomade qui vivait de la chasse aux bisons. C'est avec eux que Jean-Louis Légaré faisait la traite des fourrures. Les fils de Joseph Ouelette, François, Antoine et Pierre, étaient parmi les principaux chasseurs et traiteurs de l'endroit. Tandis que quelques Ouelette s'étaient établis à la Montagne de Bois, d'autres membres de la famille étaient à Batoche: Moïse Ouelette, marié avec la soeur de Gabriel Dumont, figurera dans le groupe de Métis qui ira chercher Louis Riel au Montana en 1884, tandis que Joseph Ouelette père sera tué pendant la Rébellion à l'âge de 95 ans. Jean-Louis Légaré, ayant épousé Marie, la fille de François Ouelette, se trouvait donc être le beau-frère de mon grand-père Prudent Lapointe.
Elizabeth Lapointe meurt de la tuberculose en 1912, après avoir donné naissance à quatorze enfants. Ma mère Madeleine a onze ans, alors elle est placée dans un orphelinat au Manitoba avec six frères et soeurs - les filles à Saint-Boniface et les garçons à Saint-Norbert. À son retour de Saint-Boniface, elle fait la connaissance de mon père, Jean Bourdages, et l'épouse à Verwood en 1922. Dès qu'ils en ont les moyens, ils achètent une terre à Fife Lake, à 12 milles au sud de Willow Bunch.
Un jour, ils se rendent compte que leurs enfants, qui sont âgés de 8, 10 et 12 ans, et qui fréquentent une école de campagne publique, ne parlent plus français. Alors, en 1935, en plein milieu de la sécheresse, de la crise économique, avec un nouveau bébé de trois mois, ils quittent Fife Lake pour s'installer sur une autre terre à quatre milles du couvent de Willow Bunch. Six ans plus tard quand vient mon tour de fréquenter le couvent, la famille est refrancisée à tel point qu'on doit faire un effort pour m'apprendre quelques mots d'anglais avant mes premiers jours à l'école, car, on se le rappelle, la loi scolaire de la province exige l'enseignement en anglais, sauf une heure par jour de français.
Dès ma deuxième année scolaire, mes parents décident de me placer, avec ma petite soeur, en pension au couvent de Willow Bunch. C'est que “les grands” ont terminé leurs études et “les petites” ne peuvent pas voyager seules tous les jours. Alors pendant sept ans nous sommes pensionnaires tandis que le petit frère qui nous suit est placé au Jardin de l'Enfance à Gravelbourg. Je me suis toujours demandé comment mes parents ont pu faire pour payer les frais de pensionnat de trois enfants quand on sortait à peine de la crise économique et qu'on n'avait pas encore eu de bonnes récoltes. C'était le genre de sacrifices que les parents s'imposaient quand ils tenaient à ce que les enfants apprennent à parler français.
Le jour est arrivé où mes parents ont pu se payer le luxe d'une maison au village. Enfin la famille est réunie au foyer. Adieu la vie de pensionnaire! Hélas! Les autorités de la grande unité scolaire, usurpant le droit des parents de choisir les maîtres et maîtresses d'école, envoyaient un anglo-protestant remplacer la religieuse à la direction de l'école de Willow Bunch. En protestation, un bon nombre de parents retirent leurs enfants de l'école. Me voilà envoyée au pensionnat de Laflèche pour terminer mes études!
Avec le recul du temps, je me rends compte des bénéfices de mes années au couvent. Une bonne formation religieuse, de bonnes habitudes d'application aux études, l'apprentissage de la langue française, la participation aux activités culturelles telles que les leçons de musique, les choeurs de chant, les festivals de la Bonne Chanson, la participation au mouvement d'Action catholique qui tentait de développer des qualités de leadership chez les jeunes, voilà ce que j'aurais manqué si on m'avait envoyée à l'école de campagne à deux milles de chez nous.
L'histoire des francophones de la Saskatchewan nous apprend que certains chefs de file ont travaillé d'arrache-pied pour préserver chez nous la trinité québécoise historique : la langue, la foi, la race. La petite histoire de ma famille est un exemple typique des efforts peu ordinaires que certains pionniers ordinaires ont fait dans le même but. Que ce soient des Métis de la Rivière Rouge à l'accent étrange mais mélodieux qui fuient la ruée assimilatrice ontarienne, que ce soit un Prudent Lapointe qui éloigne les étrangers de la place afin de former une bonne paroisse canadienne-française, que ce soit un Jean Bourdages qui assure l'éducation française de ses enfants - ces francophones ont essayé de demeurer fidèles à leur héritage.
Pour ma part, j'apprécie l'occasion de ce colloque qui m'a poussée à réfléchir à mon propre héritage, à mes souches française, acadienne, gaspésienne, montréalaise, métisse; qui m'a poussée à réfléchir aux efforts de mes ancêtres pour préserver la culture canadienne-française dans l'Ouest canadien, qui m'a permis de leur rendre hommage. Chapeau!
Notes et références
(1) Bicentenaire de Bonaventure 1760-1960, (Volume-souvenir des Centenaires de la paroisse de Bonaventure, Province de Québec), sans lieu, sans date.
(2) Lapointe, Prudent, Mémoires, Archives de la Saskatchewan.
(3) Tessier, Lucille, La vie culturelle dans deux localités d'expression française du diocèse de Gravelbourg (Willow Bunch et Gravelbourg) 1905-1930, mémoire de maîtrise inédit, Université de Regina, 1974.
| Plusieurs familles ont été importantes dans la fondation de Talle-de-Saules (Willow Bunch). Le texte suivant est une transcription d'une conférence préparée par Mme Lucille Tessier de l'Université de Regina pour le 5e colloque du Centre d'études franco-canadiennes de l'Ouest tenu au Collège St-Thomas More, Université de la Saskatchewan, les 18 et 19 octobre 1986. Ce texte a déjà paru dans les actes du 5e colloque du C.E.F.C.O. Nous reproduisons le texte avec la permission de l'auteure, Mme Lucille Tessier, de M. Jean-Guy Quenneville, directeur du 5e colloque du C.E.F.C.O. et du Centre d'études franco-canadiennes de l'Ouest. |
Lorsque j'ai appris au printemps que le thème de ce colloque serait “Héritage et avenir des francophones de l'Ouest,” je me suis mise à réfléchir sur mon propre héritage. Cette expérience m'a valu une surprise, une prise de conscience. Je me savais depuis toujours une Franco-Canadienne, une Fransaskoise. Mais ces réflexions au sujet de mon héritage m'ont amenée à faire deux observations : d'abord, retracer l'arbre généalogique de ma famille, c'est faire un long trajet de deux cents ans, à partir de Paris, jusqu'en Saskatchewan, traçant au passage le développement du Canada français.
Deuxièmement, je me suis rappelé les efforts et les sacrifices faits par mes parents afin de conserver la langue française, la culture canadienne-française dans notre foyer. Ce matin, ce n'est pas une communication savante que je me propose de faire. Je voudrais plutôt vous faire part de mon héritage personnel.
Le premier ancêtre français qu'on retrouve au Canada est un Raymond Bourdages1. En 1755, il est maître chirurgien de la garnison du lieutenant Charles de Boishébert à la rivière Saint-Jean en Acadie. Né en 1728 vraisemblablement en France, il est en Acadie depuis quelque temps puisqu'il a déjà épousé une Acadienne, Esther Leblanc. Après la chute du fort Beaubassin en 1755, Raymond Bourdages se rend à Québec. Grâce à des documents qui ont été conservés dans la famille, on sait qu'en 1760 il fait un voyage en Europe apparemment dans le but de régler une succession ou de recevoir sa part d'héritage de ses parents. Un de ses fils, Louis, s'établira à Saint-Denis-sur-Richelieu en 1789 où il deviendra un des fondateurs du journal Canadien lancé par un groupe de députés patriotes. À l'Assemblée législative du Bas-Canada, Louis Bourdages propose en 1832 que le Conseil législatif soit élu, proposition qui ne sera pas acceptée, même avec l'appui de Papineau. David, fils de Louis Bourdages, participera à la bataille de Saint-Denis.
 |
| M. Prudent Lapointe (Photo: Lucille Tessier) |
Revenons au grand-père, Raymond Bourdages. Au début des années 1770, il accompagne en Gaspésie le père de la Brosse, missionnaire du golfe Saint-Laurent. C'est vers cette époque qu'il décide de s'installer avec sa famille à Bonaventure, où certains Acadiens, ayant échappé aux troupes anglaises, s'étaient installés sur la rive nord de la Baie des Chaleurs. Raymond Bourdages devient le premier marchand de l'endroit et possède des moulins à farine et à scie. Une copie de son testament démontre qu'à sa mort, il possède de vastes propriétés. Il doit être un personnage assez important puisqu'il est enterré sous le choeur de l'église avec le curé. (Aujourd'hui, plus de deux cents ans plus tard, mon cousin Alexis Bourdages habite toujours, au premier rang à Saint-Siméon, la ferme d'un des descendants de ce premier ancêtre.)
Mon père, Jean Bourdages, quitte Saint-Siméon à l'âge de quatorze ans. “On crevait de faim, il n'y avait plus de terres,” nous dira-t-il plus tard. (En effet, mon père montrait à une de mes soeurs, il y a quelques années, le bout de terrain qui aurait été son patrimoine s'il était resté à Saint-Siméon. Et ma soeur de s'exclamer : “Mais papa, le jardin sur notre ferme était plus grand que ça!”) Pendant une dizaine d'années, mon père est cuisinier dans les chantiers de bois, voyage à travers le Canada, débarque en Angleterre en 1917 grâce à la conscription. Après la guerre, il reprend ses déplacements pour enfin s'installer à Verwood, Saskatchewan, en 1920, à douze milles au nord de Willow Bunch. A Verwood, il fait la connaissance de Madeleine, fille de Prudent Lapointe.
Prudent Lapointe est un des pionniers de Willow Bunch(2). Ses mémoires débutent par cette phrase : “À l'âge de 19 ans, ayant le goût des voyages et aventures, et ayant aussi mon frère Joseph résident à Willow Bunch, je décidai de visiter l'Ouest canadien.” Il quitte Montréal le 27 mars 1883 par le Canadien Pacifique. Cette ligne de chemin de fer n'ayant pas encore été terminée, il doit faire un détour par Chicago et Saint-Paul. Cinq jours plus tard, il arrive à Regina, qui, à ce temps-là, n'était qu'une ville de tentes. Pendant trois mois, il travaille comme commis dans le premier magasin de la ville, le magasin de Pascal Bonneau, tandis que celui-ci s'occupe d'arpenter les rues de Regina. Ensuite, Prudent Lapointe va rejoindre son frère Joseph à Talle-de-Saules. (C'est ainsi qu'on nommait le village de Willow Bunch à l'époque.) C'est le cinquième Canadien français à s'y établir avec Joseph et Jean-Louis Légaré. Le 5 décembre de la même année, étant jeune, ne pensant qu'à l'aventure, il part avec un groupe de Métis pour aller faire la chasse aux bisons. Il a comme équipement un bon cheval, un fusil, des provisions pour un mois. Mais la vie de chasse n'est pas aussi rose qu'il l'avait imaginée. Les chasseurs n'arrivent pas à trouver les troupeaux de bisons, il fait tempête, les provisions font défaut. Voici comment mon grand-père décrit le Jour de l'An 1884 :
“Nous manquions de tout.... Pour notre journée, nous avions seulement un (rat musqué) à séparer entre cinq personnes. Croyez-moi, cette journée-là j'ai pensé aux bonnes tourtières à maman. Malgré notre position, il n'y avait pas de découragement, il y avait même des farces. Un de nos compagnons avait une pance d'un animal qui avait traîné parmi la viande empoisonnée. Nous décidâmes de la faire cuire sur la braise : il paraît que le feu purifie tout. Aussitôt dit, fut fait, et le mets apprêté ne me sourit guère, mais il faut y goûter. Quel drôle de goût, c'est comme si je m'étais attaqué à des gros essuie-mains, a n'a point de goût mais mes associés me disent qu'elle est bonne. Enfin c'est fait et je ne voudrais pas recommencer.”
Après cette expérience M. Lapointe devient commis au magasin de Jean-Louis Légaré pendant une vingtaine d'années.
Lorsque commence à déferler vers les plaines de l'Ouest la grande vague d'immigration, Prudent devient agent des terres de la Couronne. Voici un autre passage de ses mémoires :
“(En 1906) nos Canadiens de la province de Québec ont commencé à arriver pour prendre des Homesteads.... Je tenais à former une Bonne Paroisse, il était assez difficile de le faire car la majorité des immigrants étaient de toutes nations et convoitaient les belles terres que nos Canadiens détiennent aujourd'hui, mais ils n'osaient venir trop près de l'église et je leur donnait (sic) une poussé (sic) plus au sud....”
Comme cette citation le montre, les pionniers de la première heure tiennent à fonder dans l'Ouest canadien des paroisses québécoises. Très attachés à leurs traditions, à leur langue et à leur foi, ils veulent préserver cet héritage culturel. Dans ce but, ils établissent des institutions religieuses et scolaires, des associations patriotiques : à Willow-Bunch, en 1870, alors que les Métis ne sont encore qu'une race nomade, ils reçoivent les soins sacerdotaux des Oblats-missionnaires de la Mission de Qu'Appelle. Quand les premiers colons viennent s'inscrire pour un homestead au bureau de Prudent Lapointe, il existe donc un clocher autour duquel ils peuvent se regrouper. Il en va de même pour l'école : en 1888, on établit une école catholique libre dirigée par Joseph Lapointe. Il a la charge de 28 élèves. Le secrétaire-trésorier, Prudent Lapointe, doit aller de porte en porte afin de percevoir les contributions, lesquelles en 1891 se montent à 176 $. En 1914, les Filles de la Croix, une communauté de religieuses françaises, viennent prendre la direction de l'école du village et fonder un couvent. Les Canadiens français, eux, fondent une société Saint-Jean-Baptiste en 1911. (3) On prend comme devise “Rendre le peuple meilleur.” C'est cette société qui réunit les Canadiens français de la paroisse, qui conçoit, organise et coordonne les diverses activités. La colonisation, les arts, les sports, les écoles - chaque domaine de la vie de la communauté reçoit ses soins vigilants et paternels. Prudent Lapointe remplit les fonctions de président et de secrétaire-trésorier à plusieurs reprises.
 |
| Jean-Louis Légaré (assis), Prudent Lapointe, Edouard Beaupré et Gaspard Beaupré (Photo: Archives de la Saskatchewan) |
Entre-temps, grand-père Lapointe avait épousé Elizabeth Ouelette de Saint François Xavier au Manitoba. En 1870, un grand nombre de Métis, ayant perdu leurs terres ou se les étant fait voler lors de la création du Manitoba, se sentant de plus persécutés, avaient quitté la Rivière Rouge. Tandis que quelques-uns s'établissaient à Prince Albert et à Batoche, une quarantaine de familles s'étaient rendues au sud du district d'Assiniboia près de la frontière du Montana. Ces Métis formaient une population nomade qui vivait de la chasse aux bisons. C'est avec eux que Jean-Louis Légaré faisait la traite des fourrures. Les fils de Joseph Ouelette, François, Antoine et Pierre, étaient parmi les principaux chasseurs et traiteurs de l'endroit. Tandis que quelques Ouelette s'étaient établis à la Montagne de Bois, d'autres membres de la famille étaient à Batoche: Moïse Ouelette, marié avec la soeur de Gabriel Dumont, figurera dans le groupe de Métis qui ira chercher Louis Riel au Montana en 1884, tandis que Joseph Ouelette père sera tué pendant la Rébellion à l'âge de 95 ans. Jean-Louis Légaré, ayant épousé Marie, la fille de François Ouelette, se trouvait donc être le beau-frère de mon grand-père Prudent Lapointe.
Elizabeth Lapointe meurt de la tuberculose en 1912, après avoir donné naissance à quatorze enfants. Ma mère Madeleine a onze ans, alors elle est placée dans un orphelinat au Manitoba avec six frères et soeurs - les filles à Saint-Boniface et les garçons à Saint-Norbert. À son retour de Saint-Boniface, elle fait la connaissance de mon père, Jean Bourdages, et l'épouse à Verwood en 1922. Dès qu'ils en ont les moyens, ils achètent une terre à Fife Lake, à 12 milles au sud de Willow Bunch.
Un jour, ils se rendent compte que leurs enfants, qui sont âgés de 8, 10 et 12 ans, et qui fréquentent une école de campagne publique, ne parlent plus français. Alors, en 1935, en plein milieu de la sécheresse, de la crise économique, avec un nouveau bébé de trois mois, ils quittent Fife Lake pour s'installer sur une autre terre à quatre milles du couvent de Willow Bunch. Six ans plus tard quand vient mon tour de fréquenter le couvent, la famille est refrancisée à tel point qu'on doit faire un effort pour m'apprendre quelques mots d'anglais avant mes premiers jours à l'école, car, on se le rappelle, la loi scolaire de la province exige l'enseignement en anglais, sauf une heure par jour de français.
Dès ma deuxième année scolaire, mes parents décident de me placer, avec ma petite soeur, en pension au couvent de Willow Bunch. C'est que “les grands” ont terminé leurs études et “les petites” ne peuvent pas voyager seules tous les jours. Alors pendant sept ans nous sommes pensionnaires tandis que le petit frère qui nous suit est placé au Jardin de l'Enfance à Gravelbourg. Je me suis toujours demandé comment mes parents ont pu faire pour payer les frais de pensionnat de trois enfants quand on sortait à peine de la crise économique et qu'on n'avait pas encore eu de bonnes récoltes. C'était le genre de sacrifices que les parents s'imposaient quand ils tenaient à ce que les enfants apprennent à parler français.
Le jour est arrivé où mes parents ont pu se payer le luxe d'une maison au village. Enfin la famille est réunie au foyer. Adieu la vie de pensionnaire! Hélas! Les autorités de la grande unité scolaire, usurpant le droit des parents de choisir les maîtres et maîtresses d'école, envoyaient un anglo-protestant remplacer la religieuse à la direction de l'école de Willow Bunch. En protestation, un bon nombre de parents retirent leurs enfants de l'école. Me voilà envoyée au pensionnat de Laflèche pour terminer mes études!
 |
| Madeleine et Jean Bourdage (Photo: Lucille Tessier) |
Avec le recul du temps, je me rends compte des bénéfices de mes années au couvent. Une bonne formation religieuse, de bonnes habitudes d'application aux études, l'apprentissage de la langue française, la participation aux activités culturelles telles que les leçons de musique, les choeurs de chant, les festivals de la Bonne Chanson, la participation au mouvement d'Action catholique qui tentait de développer des qualités de leadership chez les jeunes, voilà ce que j'aurais manqué si on m'avait envoyée à l'école de campagne à deux milles de chez nous.
L'histoire des francophones de la Saskatchewan nous apprend que certains chefs de file ont travaillé d'arrache-pied pour préserver chez nous la trinité québécoise historique : la langue, la foi, la race. La petite histoire de ma famille est un exemple typique des efforts peu ordinaires que certains pionniers ordinaires ont fait dans le même but. Que ce soient des Métis de la Rivière Rouge à l'accent étrange mais mélodieux qui fuient la ruée assimilatrice ontarienne, que ce soit un Prudent Lapointe qui éloigne les étrangers de la place afin de former une bonne paroisse canadienne-française, que ce soit un Jean Bourdages qui assure l'éducation française de ses enfants - ces francophones ont essayé de demeurer fidèles à leur héritage.
Pour ma part, j'apprécie l'occasion de ce colloque qui m'a poussée à réfléchir à mon propre héritage, à mes souches française, acadienne, gaspésienne, montréalaise, métisse; qui m'a poussée à réfléchir aux efforts de mes ancêtres pour préserver la culture canadienne-française dans l'Ouest canadien, qui m'a permis de leur rendre hommage. Chapeau!
Notes et références
(1) Bicentenaire de Bonaventure 1760-1960, (Volume-souvenir des Centenaires de la paroisse de Bonaventure, Province de Québec), sans lieu, sans date.
(2) Lapointe, Prudent, Mémoires, Archives de la Saskatchewan.
(3) Tessier, Lucille, La vie culturelle dans deux localités d'expression française du diocèse de Gravelbourg (Willow Bunch et Gravelbourg) 1905-1930, mémoire de maîtrise inédit, Université de Regina, 1974.