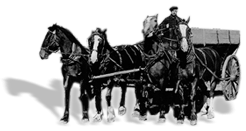Des histoires
Quotidien au couvent de Prud'homme
La congrégation religieuse des Filles de la Providence fonda une maison à Howell en 1905. Dès l'année suivante, les religieuses accueillaient quelques pensionnaires dans leur résidence, malgré le manque d'espace. En 1920, elles entreprenaient la construction d'un couvent moderne qui fut complété à la toute fin de l'année suivante. C'est à peu près à ce moment que le village reçut son nouveau nom de Prud'homme. De 60 à 90 élèves logeaient dans l'édifice imposant. Une des pensionnaires, Dorothy Danes, de père breton et de mère irlandaise, y vécut de 1925 à 1930.
Son père était employé de la Compagnie de la Baie d'Hudson à Fort Providence, sur le Grand Lac des Esclaves, à 1000 kilomètres au nord d'Edmonton; il tenait à ce que ses enfants grandissent dans un milieu civilisé et qu'ils sachent le français. Elle a conservé d'excellents souvenirs de ses années comme pensionnaire et elle explique le quotidien au couvent de Prud'homme:
«Nous n'avions pas d'excuse pour faire la grasse matinée : il fallait être debout à six heures du matin. Le tintamarre des cloches de l'église, de l'autre côté de la rue, suffisait à réveiller tout le monde. Nous récitions l'Angélus avant de faire le lit et de voir à notre toilette. À six heures et demie, nous allions en rang à la chapelle pour la prière du matin, avant la messe de sept heures. Ensuite, après avoir déposé nos missels et nos voiles à la salle de récréation, nous allions au réfectoire pour un petit déjeuner de gruau, de pain et de beurre, et de cacao. Il fallait manger en silence. Après le repas, chacun lavait sa tasse, ses ustensiles et son bol à fruits dans une grande bassine d'eau chaude. Quelques-unes, à tour de rôle, ramassaient les bols à gruau et les assiettes.
«Quand tout était prêt, mère Saint-Alain donnait le signal avec sa claquette. Nous récitions l'Action de Grâce avant d'aller s'occuper des tâches ménagères jusqu'à 8h45. Avec deux autres filles, je nettoyais le dortoir. Il fallait passer la vadrouille autour et sous les lits, puis récurer les lavabos, les baignoires et les toilettes. Je pouvais ensuite passer quelques moments sur la véranda, d'où l'on pouvait voir le village. À 8h45, on formait les rangs dans la salle de récréation pour aller en classe. À midi tapant, les cloches sonnaient l'Angélus et nous allions au réfectoire en chantant «Malbrough s'en va-t-en guerre». Après le repas, il y avait une récréation, puis des cours de lh30 à 4h00. Dans la salle de récréation, les soeurs avaient préparé deux grands plateaux de pain blanc beurré, avec du sirop doré; c'était notre goûter de l'après-midi. Il y avait aussi une fontaine d'eau fraîche pour celles qui le désiraient. Nous allions ensuite à la promenade avec mère Herman, que nous avions surnommée «Amen». Elle fut remplacé en 1926 par mère Saint-Léon; toutes les filles l'adoraient! Elle mesurait au moins 5 pieds 10, tandis que mère Saint-Alain était très petite. En cachette, on les appelait Mutt and Jeff. Nous ne voulions pas qu'elles l'apprennent car notre intention n'était pas de leur manquer de respect. Mère Saint-Léon fut suivie de mère Sainte-Roseline, une très jeune religieuse qui parlait peu. Il y avait étude de 4h30 à 6h00. Mère Saint-Alain nous donnait alors des instructions avant le souper à 6h30. Après le repas, nous étions libres jusqu'à huit heures; les filles du secondaire pouvaient étudier dans leurs classes si elles le désiraient. Après la prière du soir à la chapelle, il était temps de faire notre toilette et d'aller dormir.
«Le samedi, les repas avaient lieu à l'heure habituelle, mais après le petit déjeuner, il fallait trier le linge fraîchement lavé, repriser les bas, recoudre les boutons détachés, plier soigneusement les vêtements et les placer dans notre placard, au dortoir. L'après-midi, nous prenions un bain, avec un peu d'eau douce pour se laver les cheveux. Il fallait préparer notre costume pour le lendemain, repasser les plis et polir les chaussures. Nous étions ensuite libres de lire ou de jouer dans la salle de récréation ou à l'extérieur jusque vers quatre heures. Jusqu'à l'heure du souper, les soeurs nous enseignaient la broderie, le crochet et le tricot. Elles nous montraient aussi la couture et nous pouvions nous servir d'une machine à coudre.
«Le dimanche, une fois les tâches terminées à neuf heures, nous allions nous asseoir dans la salle de récréation pour apprendre par coeur l'évangile du jour; il fallait ensuite le réciter à tour de rôle. Les «petites», elles, n'étaient pas tenues de l'apprendre par coeur, mais elles devaient conserver le silence. La messe avait lieu à dix heures à l'église paroissiale. Après le repas du midi, si la température était clémente, nous allions prendre une longue marche; sinon, une soeur ouvrait les fenêtres et nous avions trente minutes de gymnastique. Nous étions ensuite libres de faire ce que bon nous semblait: jouer, lire ou chanter en groupe autour du piano.
«C'était tout un événement lorsque, une journée où la température était idéale, la soeur annonçait : «Allez mettre vos souliers les plus confortables!» Les «grandes» et les «moyennes» se préparaient pour une marche. Nous prenions une direction inhabituelle: d'abord vers le sud à travers le village, puis vers l'est, jusqu'à une maison blanche un peu en recul du chemin. Une dame aux cheveux blancs nous accueillait gentiment et nous invitait à nous asseoir sur la véranda. Elle nous apportait un plein seau de limonade et de grandes assiettes de biscuits. C'était la résidence des Guinament. Au moins deux fois par année, les pensionnaires étaient invitées à passer la journée à la ferme. À cinq heures, nous revenions au couvent, fatiguées mais heureuses.
«Notre garde-robe était simple. Les dimanches et les jours de fête, nous avions un voile blanc pour la chapelle. Le reste du temps, nous portions un voile noir. Pour la messe à l'église du village, nous avions un chapeau et un manteau. L'uniforme du dimanche était en serge noire, avec une jupe plissée, un col en celluloïde blanc et des manchettes de trois pouces faites du même matériel. Un ruban de soie noire, formant un noeuf papillon, garnissait le col. Le costume était simple et joli. La semaine, nous portions des robes ordinaires ou une jupe et un chemisier, à condition d'avoir des manches longues et un col boutonné. La robe devait tomber à mi-jambes. Mais c'était les années 1920 et la mode était aux jupes courtes et aux décolletés plongeants; l'uniforme n'était pas pour plaire à quelques-unes des pensionnaires plus évoluées!
«L'année scolaire 1929-1930 était une année d'élections. Les conservateurs sous Anderson remportèrent les élections. Ils s'empressèrent de remplir leur promesse de séculariser le système scolaire, de bannir la religion et le français des écoles: les crucifix et les images religieuses devaient être enlevés des salles de classe, et les soeurs devaient changer leur costume. Cette loi touchait tous les catholiques: Hongrois, Français, Polonais, Ukrainiens, etc... tous les groupes ethniques. Durant la campagne électorale, quelques conservateurs adressèrent même des lettres promettant de se débarrasser des «Chattes Noires et Blanches», c'est-à-dire des religieuses.
«Le premier dimanche après l'ouverture de l'école, l'abbé Baudoux organisa une cérémonie. Ayant revêtu ses vêtements sacerdotaux et accompagné de six servants de messe en surplis, il mena une procession jusqu'à l'école élémentaire. Là, il décrocha quatre crucifix qu'il déposa sur des coussins de velours rouge, placés dans une voiturette d'enfant. Puis, il se rendit au couvent, pour prendre deux autres crucifix. La voiturette demeura devant l'autel durant la messe et les crucifix furent ensuite accrochés au mur de l'église. Dans son sermon, l'abbé Baudoux parla de la discrimination contre une race et une religion dans un pays qui se disait une démocratie.
«Je n'oublierai jamais le premier jour de classe; mère M. Berchmans portait un petit chapeau, un voile court et une robe noire ressemblant à une tunique d'avocat. Elle avait l'air embarrassée mais elle sentit bientôt notre sympathie à son endroit et notre colère envers un gouvernement élu qui nous privait de nos droits. Il fallait trouver un moyen de contourner les règlements sur l'enseignement de la religion et du français. Notre leçon de catéchisme avait lieu à 8h30. Et comme il y avait des élèves de trois années différentes dans notre classe, chaque groupe descendait à tour de rôle dans la salle de récréation pour la leçon de français. Le gouvernement fédéral ne pouvait apparemment rien faire pour nous aider. L'Acte de l'Amérique du Nord britannique ne protégeait pas les droits des minorités.»
(tiré de Life As It Was, Prud'homme History Committee. pp. 77-84, 102-107)
«Nous n'avions pas d'excuse pour faire la grasse matinée : il fallait être debout à six heures du matin. Le tintamarre des cloches de l'église, de l'autre côté de la rue, suffisait à réveiller tout le monde. Nous récitions l'Angélus avant de faire le lit et de voir à notre toilette. À six heures et demie, nous allions en rang à la chapelle pour la prière du matin, avant la messe de sept heures. Ensuite, après avoir déposé nos missels et nos voiles à la salle de récréation, nous allions au réfectoire pour un petit déjeuner de gruau, de pain et de beurre, et de cacao. Il fallait manger en silence. Après le repas, chacun lavait sa tasse, ses ustensiles et son bol à fruits dans une grande bassine d'eau chaude. Quelques-unes, à tour de rôle, ramassaient les bols à gruau et les assiettes.
«Quand tout était prêt, mère Saint-Alain donnait le signal avec sa claquette. Nous récitions l'Action de Grâce avant d'aller s'occuper des tâches ménagères jusqu'à 8h45. Avec deux autres filles, je nettoyais le dortoir. Il fallait passer la vadrouille autour et sous les lits, puis récurer les lavabos, les baignoires et les toilettes. Je pouvais ensuite passer quelques moments sur la véranda, d'où l'on pouvait voir le village. À 8h45, on formait les rangs dans la salle de récréation pour aller en classe. À midi tapant, les cloches sonnaient l'Angélus et nous allions au réfectoire en chantant «Malbrough s'en va-t-en guerre». Après le repas, il y avait une récréation, puis des cours de lh30 à 4h00. Dans la salle de récréation, les soeurs avaient préparé deux grands plateaux de pain blanc beurré, avec du sirop doré; c'était notre goûter de l'après-midi. Il y avait aussi une fontaine d'eau fraîche pour celles qui le désiraient. Nous allions ensuite à la promenade avec mère Herman, que nous avions surnommée «Amen». Elle fut remplacé en 1926 par mère Saint-Léon; toutes les filles l'adoraient! Elle mesurait au moins 5 pieds 10, tandis que mère Saint-Alain était très petite. En cachette, on les appelait Mutt and Jeff. Nous ne voulions pas qu'elles l'apprennent car notre intention n'était pas de leur manquer de respect. Mère Saint-Léon fut suivie de mère Sainte-Roseline, une très jeune religieuse qui parlait peu. Il y avait étude de 4h30 à 6h00. Mère Saint-Alain nous donnait alors des instructions avant le souper à 6h30. Après le repas, nous étions libres jusqu'à huit heures; les filles du secondaire pouvaient étudier dans leurs classes si elles le désiraient. Après la prière du soir à la chapelle, il était temps de faire notre toilette et d'aller dormir.
«Le samedi, les repas avaient lieu à l'heure habituelle, mais après le petit déjeuner, il fallait trier le linge fraîchement lavé, repriser les bas, recoudre les boutons détachés, plier soigneusement les vêtements et les placer dans notre placard, au dortoir. L'après-midi, nous prenions un bain, avec un peu d'eau douce pour se laver les cheveux. Il fallait préparer notre costume pour le lendemain, repasser les plis et polir les chaussures. Nous étions ensuite libres de lire ou de jouer dans la salle de récréation ou à l'extérieur jusque vers quatre heures. Jusqu'à l'heure du souper, les soeurs nous enseignaient la broderie, le crochet et le tricot. Elles nous montraient aussi la couture et nous pouvions nous servir d'une machine à coudre.
«Le dimanche, une fois les tâches terminées à neuf heures, nous allions nous asseoir dans la salle de récréation pour apprendre par coeur l'évangile du jour; il fallait ensuite le réciter à tour de rôle. Les «petites», elles, n'étaient pas tenues de l'apprendre par coeur, mais elles devaient conserver le silence. La messe avait lieu à dix heures à l'église paroissiale. Après le repas du midi, si la température était clémente, nous allions prendre une longue marche; sinon, une soeur ouvrait les fenêtres et nous avions trente minutes de gymnastique. Nous étions ensuite libres de faire ce que bon nous semblait: jouer, lire ou chanter en groupe autour du piano.
«C'était tout un événement lorsque, une journée où la température était idéale, la soeur annonçait : «Allez mettre vos souliers les plus confortables!» Les «grandes» et les «moyennes» se préparaient pour une marche. Nous prenions une direction inhabituelle: d'abord vers le sud à travers le village, puis vers l'est, jusqu'à une maison blanche un peu en recul du chemin. Une dame aux cheveux blancs nous accueillait gentiment et nous invitait à nous asseoir sur la véranda. Elle nous apportait un plein seau de limonade et de grandes assiettes de biscuits. C'était la résidence des Guinament. Au moins deux fois par année, les pensionnaires étaient invitées à passer la journée à la ferme. À cinq heures, nous revenions au couvent, fatiguées mais heureuses.
«Notre garde-robe était simple. Les dimanches et les jours de fête, nous avions un voile blanc pour la chapelle. Le reste du temps, nous portions un voile noir. Pour la messe à l'église du village, nous avions un chapeau et un manteau. L'uniforme du dimanche était en serge noire, avec une jupe plissée, un col en celluloïde blanc et des manchettes de trois pouces faites du même matériel. Un ruban de soie noire, formant un noeuf papillon, garnissait le col. Le costume était simple et joli. La semaine, nous portions des robes ordinaires ou une jupe et un chemisier, à condition d'avoir des manches longues et un col boutonné. La robe devait tomber à mi-jambes. Mais c'était les années 1920 et la mode était aux jupes courtes et aux décolletés plongeants; l'uniforme n'était pas pour plaire à quelques-unes des pensionnaires plus évoluées!
«L'année scolaire 1929-1930 était une année d'élections. Les conservateurs sous Anderson remportèrent les élections. Ils s'empressèrent de remplir leur promesse de séculariser le système scolaire, de bannir la religion et le français des écoles: les crucifix et les images religieuses devaient être enlevés des salles de classe, et les soeurs devaient changer leur costume. Cette loi touchait tous les catholiques: Hongrois, Français, Polonais, Ukrainiens, etc... tous les groupes ethniques. Durant la campagne électorale, quelques conservateurs adressèrent même des lettres promettant de se débarrasser des «Chattes Noires et Blanches», c'est-à-dire des religieuses.
«Le premier dimanche après l'ouverture de l'école, l'abbé Baudoux organisa une cérémonie. Ayant revêtu ses vêtements sacerdotaux et accompagné de six servants de messe en surplis, il mena une procession jusqu'à l'école élémentaire. Là, il décrocha quatre crucifix qu'il déposa sur des coussins de velours rouge, placés dans une voiturette d'enfant. Puis, il se rendit au couvent, pour prendre deux autres crucifix. La voiturette demeura devant l'autel durant la messe et les crucifix furent ensuite accrochés au mur de l'église. Dans son sermon, l'abbé Baudoux parla de la discrimination contre une race et une religion dans un pays qui se disait une démocratie.
«Je n'oublierai jamais le premier jour de classe; mère M. Berchmans portait un petit chapeau, un voile court et une robe noire ressemblant à une tunique d'avocat. Elle avait l'air embarrassée mais elle sentit bientôt notre sympathie à son endroit et notre colère envers un gouvernement élu qui nous privait de nos droits. Il fallait trouver un moyen de contourner les règlements sur l'enseignement de la religion et du français. Notre leçon de catéchisme avait lieu à 8h30. Et comme il y avait des élèves de trois années différentes dans notre classe, chaque groupe descendait à tour de rôle dans la salle de récréation pour la leçon de français. Le gouvernement fédéral ne pouvait apparemment rien faire pour nous aider. L'Acte de l'Amérique du Nord britannique ne protégeait pas les droits des minorités.»
(tiré de Life As It Was, Prud'homme History Committee. pp. 77-84, 102-107)