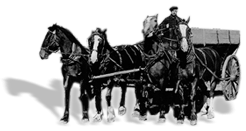Mon premier hiver au Manitoba
Dans les pays chauds ou simplement tempérés, l'on s'imagine facilement que les pays réputés froids sont des régions horribles, inhabitables; passe encore d'y passer l'été, mais l'hiver, jamais!
J'étais si rempli de ce préjugé, qu'en débarquant au Canada, je voulais constater sur le visage de ceux que je rencontrais les traces des souffrances endurées en hiver: mais plus je regardais, moins je voyais. Pourtant mon préjugé restait; il ne devait tomber totalement que dans ma propre expérience.
Aussi, ce ne fut pas sans une vague terreur, que je vis venir mon mystérieux inconnu, l'hiver du Nord-Ouest canadien.
J'avais voulu être prudent: toutefois, les premières neiges me surprirent avec les derniers apprêts. Vers la fin de novembre seulement, je pus faire mes derniers voyages d'affaires à Brandon et à Winnipeg. Maintenant je suis prêt. Rien en somme ne me manque des choses strictement nécessaires à la vie; un fourneau-cuisine chauffe l'unique pièce de mon logis, et cette pièce, longue de 5 mètres et large de 4, comprend deux divisions: la première me sert de cuisine, de salle à manger, la deuxième fait l'office de chambre à coucher; une sorte d'armoire fixée fait la séparation des deux pièces. Deux lits remplissent l'arrière-chambre; celui de mon domestique et le mien. Une latte clouée au plafond, ou plutôt sous la toiture, supporte une large couverture qui en descend déployée; cette couverture est toute la cloison entre deux lits. Nos pieds foulent un plancher, mais en haut nous avons la toiture pour plafond. Cette toiture est faite de planches avec des bardeaux cloués dessus; en France, on appellerait cela vivre sous la tuile. Mais que le lecteur ne tremble pas trop fort pour nous: notre toiture est parfaitement étanche et imperméable à l'eau, au vent et à la neige. À la cave se trouve une petite réserve de 'patates', pommes de terre; dans un placard sont rangés des paquets de denrées coloniales; un gros quartier de boeuf pend au hangar, et quoique maigre et osseux, il donne cependant une certaine confiance, que complète la présence d'un porc fraîchement tué. Ces viandes sont gelées dur, et elles resteront dans cet état jusque la fin de mars; c'est près d'elles que, la scie à la main, j'irai chercher le morceau quotidien. Le pain ne nous manque pas non plus; quelques sacs de farine sont mis en réserve. La vaisselle rudimentaire est là à côté de l'élémentaire batterie de cuisine; fourchettes, couteaux, tout est prêt pour faire les honneurs de ma table. Les chaises, les fauteuils, et les milles merveilles du confort contemporain, manquent totalement. Mais des tabourets grossiers, des bouts de banc branlants, des petites caisses à marchandises, qui portent encore leurs étiquettes rutilantes, remplacent pittoresquement le luxe de la civilisation. Ces sièges peu moelleux fatiguent vite; mais quand je suis las d'être assis, je me tiens debout, ou je vais marcher et m'agiter dehors.
Je ne puis raconter en détail ici les différentes péripéties de ce premier hiver; comment je vécus dans la société de mes bons métis; comment ils me régalèrent des récits de leurs chasses d'autrefois, de leurs rudes combats avec les sauvages, avec les terribles Sioux notamment.
L'origine de la nation métisse remonte à un siècle environ. De hardis traiteurs canadiens, au service de deux compagnies, celle de la Baie d'Hudson et celle du Nord-Ouest, arrivèrent dans ces plaines pour y trafiquer avec les sauvages; ils établirent des forts un peu partout, soit pour s'y défendre à l'occasion contre les sauvages, toujours portés à quelque retour offensif, soit pour acheter les produits de chasse de ces indigènes. Plusieurs trouvant le pays à leur goût s'y établirent: ils épousèrent des sauvagesses, et fondèrent ainsi les premières familles métisses. Ces familles, d'abord peu nombreuses, se multiplièrent dans la suite. Ce peuple compte maintenant environ 30,000 âmes répandues un peu partout dans les immenses plaines sur les frontières du Canada et des États-Unis. Mais c'est surtout au Manitoba, autour de Saint-Boniface, qu'ils se sont fortement concentrés. Les premiers métis, nés en quelque sorte au milieu des sauvages, en adoptèrent le genre de vie; ils devinrent tous chasseurs. La chasse au buffalo devint leur unique industrie; mais cette n'était pas une simple tournée autour des habitations. Le buffalo n'avait pas la simplicité confiante du lièvre; il vivait loin de la société de l'homme, son mortel ennemi. Pour atteindre le buffalo, il fallait organiser de véritables expéditions. On s'organisait par bandes nombreuses: hommes, femmes, enfants, tout le monde en était; les hommes à cheval, les femmes et les enfants sur de grossiers chariots à deux roues. Ces partis de chasse reconnaissaient une discipline; ils avaient des capitaines qui décidaient des marches et des haltes. Des éclaireurs précédaient la colonne soit pour découvrir les buffalos, soit pour signaler la présence de quelque parti de sauvages hostiles. Le soir venu, les voitures se disposaient en cercle; l'intérieur du cercle devenait ainsi une sorte de camp retranché. Des sentinelles veillaient tout autour en avant du camp, prêts à donner l'alarme en cas d'attaque. Les métis ont dû soutenir parfois de rudes combats. Se tenant habituellement sur une sage défensive, ils ont pu infliger de grosses pertes à l'ennemi, et éviter pour eux-mêmes de graves désastres; et en cela aussi les conseils de leurs missionnaires les ont grandement aidés.
Lors des beaux temps de chasse, les buffalos étaient innombrables; il n'était pas rare d'en rencontrer des bandes de plus de mille individus. Les chasseurs tâchaient d'envelopper le malheureux troupeau signalé; puis le massacre commençait, les coups partaient de tous côtés, les balles sifflaient, les animaux blessés roulaient sur le sol: c'était un vrai carnage.
Ces chasses offraient bien leurs palpitantes émotions; parfois une bête affolée se précipitait tête baissée sur le cavalier qui l'avait blessée; d'un coup de corne le cheval pouvait être éventré et son cavalier renversé, puis écrasé. Le chasseur prudent savait se garder dans ces circonstances redoutables, il luttait d'habileté et d'adresse. Habituellement, les buffalos attaqués hâtaient leur fuite dans toutes les directions, laissant leurs morts et mourants aux mains des vainqueurs. Le dépouillement des bêtes commençait alors; les hommes éventraient et pelaient les victimes, les femmes les dépeçaient. Quand le carnage était grand, on ne prenait de la bête que la peau, les meilleurs morceaux et les graisses de choix plus faciles à conserver: le reste devenait la proie des corbeaux et des loups de prairie. Des malheureux buffalos il ne restait bientôt que les os qui allaient ensuite blanchissant de plus en plus avec le temps.
Maintenant il ne reste plus de buffalos: pourchassés, massacrés partout, ils sont tous disparus, c'est à peine s'il en reste quelques-uns dans les solitudes inexplorées.
Pourtant leurs os sont partout épars dans la plaine. Près des coulées profondes, l'on distingue encore les traces qu'ils suivaient en allant se désaltérer. Les squelettes de buffalos sont devenus l'objet d'une nouvelle industrie: les fils des vieux chasseurs vont ramasser ces os, qu'ils transportent ensuite aux stations lointaines, les accumulant en immenses ossuaires, énigme et surprise pour le touriste du Nord-Ouest. Voilà seulement quinze ans que les buffalos ont disparut: avec eux s'est évanoui le siècle d'or des métis.
Questionnez le premier venu d'entre eux sur les chasses d'autrefois, et il vous répondra par un soupir. Parmi les métis, certains se sont assez bien pliés au genre de vie sédentaire; les autres continuent leur courses à travers la prairie, campant par-ci par-là un jour, un mois, une année; puis s'envolant sous d'autres cieux qu'ils quitteront encore pour continuer la vie errante du désert: ils paraissent inconsolables d'un passé à jamais fini.
Une paroisse nouvelle se fonde-t-elle: l'amour du changement y conduit ces braves gens. Ils vinrent à moi de tous les points de l'horizon. Foncièrement brouillés avec les lois de l'économie, ils accoururent naturellement sans argent, chassant devant eux un troupeau fort restreint, composé bien plus de poneys coureurs peu utiles que de vaches nourricières, et riches au moins du fusil sur lequel ils comptent sans souci, pour trouver la nourriture de chaque jour.
Ils n'étaient donc pas fortunés ces enfants du désert, quand ils accoururent à moi: je ne pouvais compter sur leur bourse, je puisai uniquement dans la mienne que remplissait sans compter, au premier signal de détresse, ma pauvre vieille mère laissée là-bas au fond d'une vallée d'Alsace, le doux pays de mon enfance! Pourtant je ne voulus pas abuser du dévouement maternel. J'aimais mieux me priver de beaucoup que d'exposer ma mère à se dépouiller plus qu'elle ne pouvait. Elle eût fait cela, si elle avait tout su; mais soigneusement, je lui cachais le côté le plus violent de mes privations peu communes. Bien volontiers, tout d'abord, je me contentai d'un de ces pauvres réduits qu'on appelle ici 'chantiers'. Le rudimentaire appartement ne laissait voir aucun ornement ni meuble digne de ce nom; je m'en tenais au stricte nécessaire. Le jour, avec le feu de mon foyer, j'étais trop heureux de pouvoir contrebalancer, tout juste assez, les froidures du dehors, et la nuit, enfoncé sous mes couvertures épaisses, je défiais assez bien les froids hyperboréens des plus rigoureuses nuits, que des cloisons mal jointes laissaient facilement entrer. L'impression était vive, quand certains matins, à mon réveil, je lisais 20 à 25 centigrades à glace au thermomètre qui pendait au chevet de mon lit, mais n'exagérons rien: ces froids énormes, dans ma chambre à coucher, se sont vus quelquefois seulement. Assez souvent la température de nuit, dans ma chambre, variait entre 10 et 20 à glace. Avec quelle rapidité j'allumais alors le feu, on le comprendra facilement, et ce feu peu ordinaire mettait une heure de grands efforts pour vaincre les froidures accumulées de la nuit. Les choses allaient ainsi, du moins en temps ordinaire; mais il en était tout autrement les jours de grandes 'poudreries'. Je n'oublierai jamais que, certaines matinées, mon malheureux thermomètre ne put indiquer que 5 degrés à glace dans ma chambre; mais je dois l'avouer, dehors la 'poudrerie' était alors formidable.
Mais ne créons pas d'impressions fâcheuses et fausses. J'ajouterai donc que toutes les maisons du Nord-Ouest canadien n'en sont pas là: loin de moi cette pensée. Pendant que ma maison restait une vraie glacière, celles de mes bons voisins les métis maintenaient une douce et vivifiante température. Quant à moi, l'argent et l'expérience m'avaient manqué en face de mon premier hiver, et je tâchais de ne pas payer trop cher mon apprentissage du pays.
Toutefois ma santé se maintint excellente; le froid très réel mais sec, relativement combattu, comme je l'ai dit, parut me procurer une nouvelle énergie. Chose incroyable, cet hiver, où tout sembla me manquer, fut pour moi un des plus agréables, et certainement le plus pittoresque de ma vie.
Tous les dimanches, mon petit peuple avait soin de se rendre chez moi: une petite chambre séparée, et bien imparfaite, nous servait d'église. Il y eût fait un froid énorme, sans la présence d'un gros fourneau, où un superbe feu ne cessait de flamber pendant tout l'office. L'autel était tout ce qu'il y a de pauvre, il était formé d'une table à peine dégrossie, avec deux ou trois planches par-dessus en forme de gradins. Une tenture fort simple, jetée sur ces planches, essayait d'en cacher l'extrême pauvreté; mon vieux missel, mon antique chasuble et l'aube: tout était à l'avenant. Deux simples bougies éclairaient seules le divin sacrifice. Il serait bien difficile, n'est-il pas vrai, d'imaginer quelque chose de plus pauvre!
D'autre part, ce dénûment avait bien aussi ses charmes: quand on est pauvre, mais en même temps qu'on a l'espérance, on jouit en quelque sorte de sa pauvreté, on en est fier, on se sent conquérant, on voit d'avance les succès et les joies du triomphe. Et puis comme il parlait délicieusement à mon âme, ce spectacle de mes dix pauvres familles groupées pieusement autour de cet autel! j'avais là l'image vivante de l'étable de Bethléem; que dis-je? j'en avais la réalité complète. Nous avions le divin Enfant dans l'Eucharistie. Marie et Joseph étaient là en esprit; les anges s'y trouvaient aussi planant au-dessus du sacrifice et chantant silencieusement leur cantique éternel; et nous avions la troupe des bergers agrandie dans la personne de mes chers métis, ces ineffables nomades.
Je ne laissais passer aucun dimanche sans leur adresser la parole. Mes instructions étaient éminemment simples. Autant que je le pouvais, je voulais me mettre à la place de mes auditeurs: j'étais heureux de leur parler ainsi, et eux m'écoutaient avec respect et bonheur.
La messe finie, mes gens n'étaient pas pressés de s'en aller. Pour moi, je déposais les ornements sacerdotaux, et j'éteignais les deux luminaires. Nous faisions alors un grand cercle autour du foyer, puis la conversation commençait. Elle roulait tout d'abord sur les quelques nouvelles locales, puis nous abordions nos deux grands sujets favoris. Moi je parlais des choses de France, et eux ne tarissaient pas dans les récits de leurs chasses d'autrefois.
Le métis aime la France, il sait parfaitement, que son aïeul blanc vient de là. Il a appris cela sur les genoux de sa mère, les missionnaires français sont venus le lui répéter, et vous pouvez y compter, jamais il ne l'oubliera. La France et la prairie voilà bien les deux patries du métis; il voit la première dans un mystérieux vague, qu'il ne peut démêler; mais il connaît à merveille tous les secrets de la seconde, et c'est celle-ci qui procure au métis des pensées à son esprit, et des sentiments à son coeur. Abordez un métis. Vous le trouverez tout d'abord d'une grande réserve: une certaine timidité, une certaine conscience de son infériorité l'arrête; mais enhardissez-le, et alors vous lui verrez beaucoup d'expression et de volubilité. Volontiers, il vous posera quelques questions sur les choses de France, et pour peu que vous vous y prêtiez, il se lancera à fond de train dans les récits des chasses d'autrefois. En général la narration du métis est loin d'être ennuyeuse. Elle charme par la simplicité et le bon sens. Dans les pays civilisés, on s'imagine facilement que l'homme, qui tient de si près du sauvage, doit être excessivement borné: c'est une erreur absolue. Croyez-le: la civilisation matérielle gâte bien des gens; et nos métis, en une foule de choses, raisonnent autrement juste que bien des paysans d'Europe, que bien des ouvriers des grandes villes. Mais ce qui frappe surtout chez eux, c'est la rapidité du coup d'oeil: déjà ils ont tout vu, tout jugé, lorsque vous, à leur côté, vous commencez seulement à voir.
Ce peuple métis si remarquable, si plein de foi, si moral, si solide, si sain de corps et d'esprit, remarquons-le en passant, c'est la religion qui l'a fait ainsi: tels les Jésuites avaient formé leurs sauvages du Paraguay, tels les Pères Oblats ont élevé nos métis dans les plaines du Nord-Ouest. Ces derniers, jusqu'en 1870, ont vécu séparés, en quelque sorte, du reste de l'humanité: ç'a été leur salut. Maintenant ils sont pleinement en contact avec les blancs, et déjà l'on voit clairement les conséquences fâcheuses de cet état de choses. Comment cela finira-t-il? Je n'en sais rien, toujours est-il que les vingt dernières années sont loin de marquer un progrès moral et matériel du peuple métis. Il conserve toujours sa croyance simple; mais sa vertu, sa sobriété et sa bonne simplicité d'autrefois sont en baisse.
Nous voilà aux confins de la sauvagerie. Un mot sur les pauvres tribus indiennes ne sera donc pas ici, je le crois, déplacé.
Il reste quelques sauvages dans les vieilles provinces orientales du Canada; mais c'est surtout dans les vastes plaines du Nord-Ouest qu'on les rencontre plus nombreux. Innombrables dans les siècles précédents, ils n'ont cessé de diminuer jusqu'à nos jours. Maintenant toutes les tribus sauvages réunies ne donnent pas plus de 100,000 individus, plus ou moins groupés dans les différentes provinces canadiennes. Ces tribus sont loin de former une seule langue; elles paraissent venir au contraire de races très différentes. Citons parmi beaucoup d'autres les Hurons et les Iroquois dans les provinces orientales; les Crys, les Assiniboines, les Sauteaux et les Sioux dans les plaines du centre; et plus loin, vers le pied des Rocheuses: les Gros-Ventres, les Pieds-Noirs et les Montagnais. Là, encore, la terre s'est peuplée par des migrations successives de peuples: les derniers refoulant les premiers. Les sauvages ne sont pas les esclaves des blancs, ils continuent de vivre d'une vie à part. Leur genre de vie n'a pas changé; ils continuent de courir la prairie dans tous les sens, pour le plaisir de courir, chassant et pêchant, suivant les circonstances. Outre cette liberté de courir la prairie, le gouvernement leur a octroyé certaines étendues de terrains, un peu partout. Ces terres s'appellent réserves. On en compte une centaine environ dans l'immense région du Nord-Ouest, elles sont de toute étendue, depuis 12 jusqu'à 2000 kilomètres carrés. Dans ces réserves les sauvages vivent soumis comme autrefois à leurs chefs naturels; mais ceci, c'est pour la forme seulement; car en réalité la loi des blancs pèse sur ces indigènes. Le chef sauvage est simplement chargé de la faire observer, sous le regard vigilant d'un agent du gouvernement, qui est là pour surveiller et le chef et ses sujets, et les faire marcher tout juste comme le veut le gouvernement des blancs. En cas de complication, la police montée n'est pas loin, toujours prête à faire usage de ses bonnes carabines. Le sauvage le sait bien, et se le tient pour dit; les quelques mouvements qu'il a essayés ne lui ayant pas réussi, il a renoncé facilement à sa fierté d'autrefois. Du reste, le gouvernement central, à la place de grouper tout ce monde sauvage en quelques réserves énormes, l'a éparpillé sur une multitude de petites, généralement très distantes les unes des autres. De cette façon les soulèvements généraux sont devenus matériellement impossibles, or tout est là pour le gouvernement central.
Du reste les sauvages jouissent de la plus grande liberté. Nous l'avons vu; il peuvent courir la prairie, comme bon leur semble; ils peuvent chasser et pêcher partout, tout comme les blancs; ils ont en outre la jouissance exclusive de leurs réserves; ils en peuvent cultiver la terre, ou la laisser en friche; s'ils se décident à la cultiver, ils disposent de leurs récoltes comme ils l'entendent, absolument comme peut le faire tout autre fermier. Toutefois cette terre dont ils disposent, ils n'en ont que la jouissance, ils peuvent en tirer tous les fruits possibles, qu'ils peuvent consommer, vendre ou détruire; mais la terre reste inaliénable. Si le sauvage pouvait vendre ses terres, il y a longtemps qu'il ne resterait plus une seule réserve: tout serait vendu depuis des années! Ajoutons, afin d'être complet, que le gouvernement a institué un grand nombre d'écoles primaires pour les sauvages; il a fait plus encore; il a établi plusieurs écoles dites industrielles. Là on procure aux enfants des sauvages une culture intellectuelle plus grande, et en même temps on leur apprend un métier. Mais le sauvage n'a pas encore l'ambition des blancs; il ne voit guère les avantages de l'instruction; la connaissance d'un métier le laisse d'ordinaire très indifférent. Aussi est-il rare qu'il laisse ses enfants profiter des avantages de l'école. Pour lui rien ne vaut les plaisirs de la vie nomade.
On se figure peut-être que le petit du sauvage est trop grossier pour saisir les choses de la culture intellectuelle: gardez-vous de le croire; l'intelligence d'un petit sauvage vaut l'intelligence d'un petit blanc; et il est aussi apte à apprendre un métier que n'importe quel adolescent blanc que l'on voudra. Toutefois, une chose essentielle manque au sauvage, comme elle manque aussi au métis: c'est la fixité, c'est l'esprit de suite. Ce sauvage qui apprend un métier, vous pouvez croire qu'il n'en fera rien ou à peu près. Ces gens n'entendent absolument rien dans l'art de l'économie; jamais on n'en a vu devenir riches; ils sont tout au présent comme l'oiseau des champs. Le passé ne compte plus pour eux, ils ne se le raisonnent jamais, ils n'en tireront jamais de déductions pratiques pour la conduite de la vie. Quant à l'avenir, ils ne s'en inquiètent pas davantage; s'ils ont beaucoup un jour, ils mangeront beaucoup, ils feront joyeusement de grands gaspillages, sans se demander jamais si peut-être ils ne mourront pas de faim le lendemain. Combien de temps faudra-t-il pour transformer ces idées des Indiens? Des siècles probablement. Voilà plus de deux cents ans que les Iroquois sont en contact continuel avec les Canadiens français dans les provinces orientales, et pourtant, c'est à peine s'ils ont modifié légèrement leurs idées primitives. La civilisation est comme une seconde nature: et il lui faut des siècles pour naître et se développer.
Chez le sauvage le sort de la femme paraît dégradant, elle n'est guère que l'esclave de l'homme; elle travaille et porte les fardeaux plus qu'à son tour: l'homme ne paraît guère comprendre qu'elle est la plus faible, que pour lui faire sentir que lui est le plus fort, qu'il est son maître, et qu'elle est sa servante. La taille du sauvage est au-dessus de la moyenne, son visage n'a rien de repoussant, il respire le calme, sa tête est large, ses traits n'ont rien de fin et son fortement accusés; l'homme paraît généralement solide et bien bâti; l'obésité est inconnue dans cette race, le teint n'est ni jeune ni noir; il est une sorte de brun jaunâtre qu'on a bien voulu appeler rouge cuivré. Et pourtant ce sauvage, qui paraît maintenant si calme, était terrible il n'y a pas encore bien longtemps, le Sioux surtout, s'était acquis entre tous une triste renommée, pour ses cruautés et son humeur belliqueuse indomptable à l'égard de tout le monde. Ses excès devinrent sa perte: métis et sauvages s'unirent pour l'écraser et réussirent assez bien.
Depuis 30 ans, ces horribles carnages ont cessé: la civilisation a si bien percé la prairie de part en part, dans tous les sens, que les sauvages, se voyant bien enlacés, ne se sentent plus la moindre velléité d'égorger personne. Le blanc peut voyager partout, en sécurité, dans l'immense prairie: s'il lui arrive malheur, ce ne sera pas de la main d'un sauvage qui l'aura frappé, ce sera celle d'un autre blanc. Mais, en cela spécialement, le Canada est encore très heureux. les assassinats y sont rares, surtout dans les régions peu habitées de l'Ouest.
Outre leurs réserves, nos sauvages reçoivent de l'État une pension annuelle de quelques piastres, faible dédommagement pour ces immenses étendues que le gouvernement s'est adjugées, comme étant inoccupées! Le jour de la paye est le jour ardemment désiré des sauvages. Ils n'oublient jamais d'en faire un grand jour de fête. Les marchands des villes voisines ne se le font guère dire: ils savent bien trouver ce jour-là les sauvages au chef-lieu de leur district; ils peuvent apporter sans crainte toutes leurs réserves de vains bibelots et parures; tout est acheté, sans compter, du moment que les couleurs seront d'un rouge bien voyant. Et le soir arrivé, il ne restera plus rien de la paye: l'argent venu le matin dans la sacoche des agents, s'en retournera 12 heures plus tard, soigneusement enfoncé dans les poches des marchands. Et le lendemain, le sauvage pauvre comme l'avant-veille, n'aura aucun regret, il aura passé une fois encore un beau jour; ça lui suffit, il n'y pensera plus; il se réservera tout entier à l'espérance de la paye suivante. À cela, peut-être, y a-t-il quelques exceptions, c'est possible; mais elles doivent être très rares, assurément.
Quand on a dit du sauvage qu'il est chasseur et pêcheur, mais surtout voyageur et flâneur, on en a résumé toute la vie. Une législation spéciale le régit. Entre autre chose, l'usage des boissons enivrantes lui est strictement interdit. La sévérité de la loi poursuit surtout celui qui procure ces boissons aux sauvages. Plus encore que le blanc, le sauvage a la passion innée de l'alcool, à tel point que la nation entière périrait en quelques années, si l'usage lui en était concédé.
Pour voir et étudier nos sauvages, point n'est besoin de se rendre à leurs réserves. L'amour des voyages et l'attrait du spectacle de la civilisation des blancs les font sortir sans cesse de leurs campements. Ils aiment venir planter leurs tentes aux abords des stations et des villes; et là, nonchalamment assis ou couchés pêle-mêle, ils regardent circuler le monde et paraissent goûter un plaisir extrême à voir les blancs s'agiter si fort. Quand la faim devient pressante, les femmes quittent leurs marmots pour quelque temps, vont chercher une heure ou deux d'ouvrage aux maisons voisines, puis s'en reviennent avec quelques restes d'une nourriture parfois déjà décomposée et presque toujours rebutante. Comment se fait le partage? Je n'en sais trop rien. Mais il y a apparence que le plus fort s'adjuge la part du lion. Si la faim augmente et que le travail manque, on n'hésite pas: la tente est enlevée, on attelle les poneys, et déjà l'on est en route. Les apprêts du départ ont pris tout juste cinq minutes, et voilà qu'on chemine dans la plaine. Si le nombre des poneys le comporte, les hommes montent des chevaux, tandis que les femmes et les enfants se laissent traîner sur le grossier chariot à deux roues, tout en bois à peine dégrossi; si les chevaux ne sont pas en nombre, tout le monde s'entasse dans l'étroit véhicule.
Le plus souvent, on marche au petit bonheur, tuant par-ci, par-là, soit un faisan, soit un lièvre, soit plus rarement un chevreuil ou un cerf. Des buffalos incomparables il ne faut plus parler, il n'y en a plus. Le soir on tâchera d'arriver à un endroit où l'on pourra trouver un peu d'eau, avec un peu de bois; on s'arrêtera là. Si une sécheresse trop persistante a tari l'eau de la coulée ou celle du lac éphémère, hommes et bêtes se passeront de boire ce soir-là et le lendemain matin encore. On dressera la tente, on allumera un feu, et pendant que les hommes mangeront le gibier tué dans la journée, les chevaux, laissés à eux-mêmes, pâtureront en liberté autour du campement, c'est leur affaire habituelle chaque soir; ils ne se sauveront pas. Le lendemain le voyage continuera comme la veille, et ainsi de suite jusqu'au moment où un heureux hasard aura conduit la petite bande à quelque endroit fortuné où le gibier se rencontrera abondant, ainsi que le bois et l'eau. On campera là, plus ou moins longtemps, jusqu'au moment qu'une sorte de nostalgie s'emparant de nos sauvages, il leur prendra l'idée d'aller revoir leurs connaissances de la réserve, dans quelque ville ou village, pour y flâner au milieu des blancs, aussi longtemps que la chose leur sourira. Et cette ardeur des voyages, rien ne pourra l'arrêter, ni les chaleurs de l'été, ni les rigueurs de l'hiver.
Il n'est donc pas rare de rencontrer le sauvage à travers la prairie. Parfois la chasse ne lui a pas réussi, alors il va frapper aux fermes qu'il rencontre sur son chemin, il entre sans plus de façon, s'assied sur un siège, sans en avoir demandé la permission. Il ne dira pas un mot, restera immobile, paraissant plongé dans des méditations philosophiques profondes. Il se tiendra ainsi pendant une heure, une journée, s'il le faut. Il n'est pas pressé et il est patient. Le jeter à la porte, il sait bien qu'on ne le fera pas; il sait que de guerre lasse on finira bien par lui donner quelque chose, sans compter le dîner que parfois il trouve en attendant. Et le voilà regagnant sa charrette et les siens, qui l'ont attendu sans broncher aucunement. Alors naturellement, il partage, et s'il a bien dîné, facilement il se montre généreux. La marche reprend, elle continuera le lendemain, et ainsi de suite, pour chacun, jusqu'à son dernier jour!
Ce pauvre sauvage a-t-il quelque religion? Certainement; et l'idée qu'il se fait de la divinité est remarquable. Il n'adore pas une infinité de dieux, comme le faisaient autrefois ces princes tant vantés de la civilisation: les Grecs et les Romains; il n'admet qu'un dieu qu'il appelle 'Manitou' c'est-à-dire 'Grand-Esprit'; il admet en outre un mauvais Esprit en opposition et inférieur à Manitou. Notre sauvage a ses prêtres qu'il appelle sorciers, et son culte consiste surtout en danses sacrées, en musique et en chant, ou mieux en certains cris tantôt gutturaux, tantôt aigus. Le tambour est l'instrument sacré préféré, il joue le rôle principal dans les cérémonies du culte, soit quand quelqu'un est malade pour le rappeler à la santé, soit aux jours de fêtes traditionnelles.
Disons immédiatement que le 'Manitou' est en baisse parmi les sauvages. Comme nous l'avons dit plus haut, ces gens sont au nombre de 100,000 individus, habitant le Canada, soit exactement 99,717.
Sur ce nombre 31,349 sont catholiques, 25,275 sont protestants, 21,112 sont païens.
Ainsi donc près des trois-quarts des sauvages sont passés au christianisme, et parmi ces chrétiens sauvages ce sont les catholiques qui en comptent le plus. Certains sauvages deviennent de bons chrétiens; quelquefois même des chrétiens admirables; mais un grand nombre se relâchent facilement, quand ils restent longtemps sans voir le missionnaire. Les ministres protestants avilissent un peu trop facilement les motifs de conversion, en accordant leurs dons généreux aux sauvages qu'ils convertissent. Cela se faisant sur un large pied, il est hors de doute que l'argent et d'autres choses ont trop part à la conversion des sauvages au protestantisme.
Au point de vue moral, les sauvages païens voient assez clairement tout ce qu'il y a de différence entre le missionnaire catholique et le ministre protestant. Toutefois, presque invariablement, ils font observer au missionnaire catholique qu'il ne donne ni argent ni habits comme le ministre protestant. La 'robe noire' est toujours plus respectée; mais assez souvent les pièces sonnantes sont plus aimées.
Une autre misère entrave le mouvement des conversions: ce sont les vices de beaucoup de blancs. Cela démoralise les nouveaux convertis et détourne les païens de la conversion; leur raison peu formée ne leur permet pas de bien distinguer la religion et les vices des hommes, ils méprisent une religion qui paraît produire de tels hommes.
Dès l'été précédent déjà, j'avais pu étudier sur le vif nos bons sauvages: je les avais vus innombrables à Piguis, sur les bords du lac Winnipeg, au grand jour de la paye; je les avais vus, ensuite, bien des fois encore, et de très près, dans les magasins d'Oak Lake, où mes affaires m'appelaient souvent. Le 2 décembre, j'eus plus de bonheur encore: ce jour-là, deux sauvages me firent le plaisir d'entrer chez moi, tout à fait à l'improviste. C'était un dimanche matin, vers onze heures, ma messe était dite et tout mon monde retiré; mon domestique ouvrait la porte pour se mettre en voyage pour un jour, quand mes deux Sioux entrèrent. Mon domestique, qui put les voir encore, eut sans doute peur pour moi; car passant devant la maison de Thomas Breland, il le pria d'aller voir ce qui se passait chez moi.
Voilà donc mes deux sauvages entrés; ils procèdent à leur façon; ils oublient de saluer, naturellement. Une demi-seconde leur suffit pour se rendre compte de l'état des choses chez moi. La présence de la 'robe noire' dans une maison si pauvre et aux confins de la solitude a dû les surprendre; rien pourtant ne paraît sur leur visage calme. Un sauvage ne s'émeut pas pour si peu. J'étais encore à table, quand mes deux visiteurs sont entrés; c'est mon tour de ne pas m'émouvoir et je continue tranquillement mon pauvre repas, pendant que mes deux Sioux s'asseyent bonnement sur un long banc, à côté l'un de l'autre, en face et à deux pieds du foyer incandescent. Ce banc très primitif n'a pas de dossier, mais il s'appuie contre la muraille qui fournit ainsi un dossier très solide. À ce moment Thomas, mon bon voisin, fait son entrée, c'est on ne peut mieux; il connaît la langue des sauvages, il pourra donc me servir d'interprète. Thomas, en bon métis, me salue du regard; puis s'assied près du feu, non loin des sauvages, qu'en un-dixième de seconde il les a déjà toisés du haut en bas. Sur un mot de moi, l'interview commence. J'apprends alors que mes deux sauvages sont des fils des terribles Sioux; ils ont quitté, disent-ils, le lac du Diable (États-Unis) il y a cinq jours, et depuis ce moment ils n'ont plus rien mangé. Le sauvage, paraît-il, est capable de jeûnes aussi rigoureux.
Toutefois pour le présent cas, Thomas, qui s'y connaît en sauvages, me dit que nos hommes mentent; il est convaincu qu'ils ont bel et bien mangé, chacun de ces cinq jours, tout comme ils mangent en ce moment chez moi; ils savent parfaitement s'arrêter aux fermes quand ils ont faim. Nous en avions en effet une preuve bien claire sous les yeux. Mais déjà le lecteur a compris que nos deux sauvages reçurent à manger chez moi, j'eus même la chance peu commune de les servir moi-même. Cela me fut du reste très facile: il me restait énormément de potage au riz cuit avec du lard; le pain et le thé ne manquaient pas non plus, nos deux sauvages s'en régalèrent comme ils voulurent, je crus remarquer qu'ils ne mangeaient pas comme des hommes écrasés sous un jeûne de 5 jours. Il est vrai que le lard cuit avec l'eau et du riz n'est pas leur plat habituel, ils préfèrent les bonnes viandes saignantes de ce beau gibier qu'ils tuent à la chasse. Détail à noter: quand ils n'eurent plus faim, ils remirent soigneusement dans le plat ce qu'ils avaient pris dans leur assiette, en plus de leur appétit. À part cela, ils s'étaient tenus 'correctement' à table. Quoique fort dispos, ils tenaient l'échine raide: et nos deux hommes, aussi vite mangé aussi vite debout. Évidemment pour eux la table est faite pour y manger, et rien que cela: et les voici qui reviennent prendre leurs places de tout à l'heure en face du feu. La conversation, un moment interrompue entre Thomas et eux, reprend de plus belle. Ne croyez pas que cela coulait comme un torrent rapide: point du tout. Une question était posée par l'un ou l'autre des interlocuteurs; la réponse suivait immédiatement, puis venait une pause plus ou moins longue, servant sans doute de réflexion; puis jaillissait une nouvelle question suivie d'une réponse qui ne se laissait jamais attendre.
C'est alors seulement que je pus me convaincre que ma soutane n'avait pas été sans piquer la curiosité de mes hôtes, car à leur question 'd'où je venais', Thomas put leur répondre 'd'au-delà de la Grande-Eau'. L'entretien fut peu long: nos sauvages avaient quelque chose de plus important à faire en ce moment. L'un d'eux plonge sa main dans sa poche et je le vois en sortir une pipe: elle n'était pas le calumet légendaire des grandes cérémonies; j'avais sous les yeux une petite pipe rouge, assez bien façonnée, mais qui me frappa assez peu, toutefois il n'en fut pas ainsi pour Thomas; il reconnut, dans cette pipe, un objet de grande valeur, et il aurait donné beaucoup pour en devenir l'heureux propriétaire. Il paraît que cette pipe était due à l'industrie des sauvages, elle aurait été ciselée dans une belle pierre rouge, très rare dans le pays, puis polie avec un soin extrême, à vrai dire cette pipe me parut reluire comme un beau marbre fin.
À peine le sauvage a-t-il sorti sa pipe, que je le vois la remplir de tabac, puis l'allumer, et aussi vite la porter à la bouche; il en tire gravement trois bouffées de fumée. À ce moment il me regarde vivement, réfléchit une seconde, avec beaucoup de force, apparemment; puis tout d'un coup se retourne vivement vers Thomas, lui tend la pipe; et celui-ci en tire trois bouffées avec la solennité de son devancier. C'est alors le tour du deuxième sauvage qui en fait autant, la pipe revient ensuite entre les mains de son propriétaire pour de là continuer la série des mêmes tournées jusqu'à complète extinction. C'était pourtant la pipe de la fraternité, qui se fumait là, suivant les règles: toutefois le sauvage n'osa pas me la présenter; il comprit que sa politesse à lui pouvait être tout autre chose pour moi; et le lecteur peut le croire, il le comprit vivement. Je crois que bien des blancs n'auraient pas compris ni si bien, ni si vite, qu'il faut parfois savoir se raisonner les idées reçues.
Cela fait, nos deux sauvages se lèvent d'un bond, enveloppent plusieurs fois leur cou de leur long châle noir, et, sans plus de cérémonie, prennent bonnement la porte, nous annonçant la visite probable de leurs deux femmes. Ils avaient dû les laisser en arrière, pour marcher plus vite, et arriver ce même jour à la réserve de Pipestone (pipe de pierre), au milieu de leurs parents sauvages. Je suivis mes hommes du regard; ils n'avaient qu'un cheval à eux deux. L'un des hommes le monta, tandis que l'autre se mit à marcher à côté: naturellement, de temps en temps les rôles devaient changer. Bientôt nos deux sauvages eurent disparu à nos yeux sur la plaine couverte d'une légère couche de neige. J'attendis vainement tout l'après-dîner les deux femmes annoncées. Elles ne vinrent pas, elles durent prendre une autre direction, un peu plus à l'ouest. Il est inutile de supposer que ces femmes se perdirent: jamais un sauvage ne s'est perdu dans la prairie: l'Indien la connaît mieux que le paysan ne connaît les rues de son village.
Ce premier hiver je fus réellement chanceux du côté des sauvages, car 15 jours plus tard, un heureux hasard me remettait face à face avec un Indien. Voici comment. Un matin de très bonne heure, le soleil n'étant pas encore levé, mon domestique venait de sortir, pour donner leur ration aux bêtes de mon étable: il rentre tout à coup vivement et m'annonce, essouflé, qu'un sauvage au petit trot. En effet, presque au même moment, j'entends la première porte s'ouvrir; j'attends ensuite que la deuxième s'ouvre à son tour; j'attends vainement. Dix secondes plus tard, la première porte se referme et, au même instant, je vois par la fenêtre mon sauvage qui continue son chemin. Fortement intrigué, je me précipite vers la porte, pour mieux me rendre compte de ce qui s'est passé; mais en passant par ma chambre-chapelle, je constate que les deux uniques chandeliers de mon autel sont disparus. Point de doute, c'est ce sauvage qui me les a volés, et voilà pourquoi il se sauve si vite. Je n'étais ni habillé, ni surtout chaussé pour courir dans la neige, n'importe je me précipite comme je suis. À la porte je ramasse en courant un gros gourdin, et me voilà commençant une course homérique, sus au sauvage, mais je n'ai pas fait vingt pas que la réflexion venant, je me dis que je fais là une chose insensée. Ce sauvage qui court devant moi est mon voleur, ou bien il ne l'est pas: s'il est mon voleur pourquoi m'attendrait-il? il a cheval et traîneau, c'est-à-dire tout ce qu'il faut pour me distancer facilement. Au surplus il doit avoir un fusil tout chargé avec lui, rien de plus facile pour lui de m'envoyer une balle à distance. S'il n'est pas voleur, et s'il veut bien ensuite m'attendre, je vais être ridiculement embarrassé tout à l'heure, et je me serai donné en plus une peine bien inutile. Pourtant, je m'étais si bien lancé, que je me dis: Eh bien, tant pis! Courons quand même. Au fond, je voulais jouir du pittoresque de la chose, et donner à mon domestique, trop peureux, une bonne leçon de courage. Pendant tout ce temps, mon sauvage, voulant sans doute se réchauffer les pieds, courait toujours à côté de son cheval, ne se doutant nullement que quelqu'un courait après lui. Cela eût pu durer longtemps de la sorte. Fort heureusement, voilà que par hasard mon sauvage jette un regard en arrière; il me voit. Aussitôt je lui fais un grand signe d'arrêter; il comprend à merveille; il s'arrête immédiatement avec son cheval et son traîneau. La chose devenait claire, il n'était pas coupable. Maintenant je n'ai plus qu'une pensée: comment me tirerai-je de mon coup de tête, sans paraître trop ridicule à ce sauvage? Et tout en pensant à cela, voilà que j'arrive à mon homme. Ma course insensée paraît l'intriguer fortement. Je me place bien en face de lui, et voilà que je commence devant ses yeux grands ouverts une mimique incroyable. Ne trouvant rien de mieux, je dessine dans l'air, avec mon doigt, une forme de chandelier, et pour être bien compris, je décris de même une forme de bougie, et afin que rien ne manque à la description, je fais le mouvement spécial pour la mise d'une bougie dans un chandelier; je complète le tout, par le simulacre d'une allumette qu'on allume et que l'on porte ensuite au haut de la bougie qu'on veut allumer. Comme mimique, c'était superbe et j'etais tout fier de mon succès, par-devers moi; mais mon sauvage qui probablement n'avait jamais vu un chandelier, n'y comprit absolument rien. À un moment donné, il pousse une exclamation bisyllabique, voulant sans doute dire que nous ne pouvions pas nous entendre. Là-dessus je lui indiquai du geste que notre entrevue était finie. Il ne se le fit pas dire deux fois, une seconde plus tard il reprenait son trot à côté de son traîneau; et moi, tout heureux de mon demi-succès, je reprenais fièrement le chemin de ma maison. Je rencontrai en route mon domestique, qui se hâtait lentement, je lui souris avec une légère malice. Quant à lui, voyant le sauvage déjà très loin, il rentra au logis pleinement rassuré!
Restait pourtant à éclaircir le mystère de mes chandeliers disparus. En regardant bien, je les trouvai renversés derrière le gradin de l'autel. Comment la chose s'était-elle faite? Je suis encore à me le demander; et ne trouvant pas d'autre explication, j'ai toujours remis l'exploit sur le compte de mon chat. Je ne le punis point cependant; comment aurais-je pu le faire? Il m'avait procuré, si à point, un quart d'heure d'un pittoresque achevé.
Quelques jours après, la note comique le cédait aux choses graves: j'étais appelé auprès d'un pauvre père de famille; c'était un métis, jeune encore mais à l'extrémité, que je devais préparer à la mort. Cela m'impressionnait d'autant plus, que c'était la première fois que j'avais à exercer ce lugubre ministère. Je confessai ce brave métis, lui adressai, de mon mieux, les douces paroles de consolation et de sainte espérance. Il reçut en même temps le Saint-Viatique et l'Extrême-Onction, dans des sentiments admirables de foi vive et d'ardente piété. Rentré chez moi, j'attendis ensuite, d'heure en heure, l'annonce de sa mort. Quelques jours se passent ainsi, quand un soir, vers minuit, quelqu'un vient frapper à ma porte. Ce soir-là nous avions fait le levain, et, comme il faisait froid, il nous fallait entretenir un feu continuel, de peur que le levain ne vînt à geler dans le pétrin. Je m'étais chargé de ce soin; comme le nouvel-an était proche, je profitais du temps libre pour écrire mes nombreuses lettres. Vers minuit, après avoir bien attisé le feu, vaincu par le sommeil, je me jetai, pour un instant, tout habillé, sur mon lit. J'en étais là, quand soudain quelqu'un frappe à ma porte, et, presque aussitôt, je vis entrer un grand et solide jeune homme. C'était Gaspard Lafontaine qui venait me dire que le malade me demandait. A l'instant je suis debout; j'ai vite revêtu mes vêtements d'hiver. D'un bond me voilà en voiture, et aussitôt nous partons au grand trot. Un vent très piquant vient nous glacer la figure. Peu importe! Nous nous couvrons de notre mieux, et nous ne nous portons pas plus mal, quand un quart d'heure plus tard, nous arrivons chez le malade. Grand est mon étonnement de voir à cette heure la vaste chambre bondée de monde. Je vois là unis le père et la mère du malade, ses frères, ses soeurs, son beau-père, sa belle-mère, des beaux-frères, des oncles, des tantes, des cousins, des cousines; presque tous les métis de l'endroit sont là s'acquittant du devoir de la veillée charitable.
Le lit du malade est placé dans un coin de la chambre, et sa femme tient la place du devoir à son chevet. À ce moment, elle se lève respectueusement: c'est à mon tour, de me tenir auprès de mon pauvre James! Pensant qu'il lui reste quelques scrupules de conscience, je lui demande avec douceur s'il voudrait se confesser encore une fois. 'Non, me répond-il de sa voix défaillante mais paisible; seulement j'aime que vous soyez ici.' Ces paroles de foi vive me ravissent et les paroles du Christ: 'En vérité, je vous le dis, je n'ai point rencontré une telle foi dans Israël', me reviennent spontanément à l'esprit, et pendant que je m'humilie en moi-même, je cherche de mon mieux à me mettre à la hauteur de l'auguste circonstance; car elle est grande en tout temps la valeur d'une âme, mais elle est surtout grande au moment de la mort! Cette âme fut-elle celle d'un pauvre métis, que l'univers ignore et qu'il ignorera toujours. Pour Dieu, elles n'existent pas ces différences boiteuses que les hommes insensés et aveugles ne peuvent s'empêcher de voir, malgré tous les démentis, malgré l'épouvantable anéantissement du tombeau!
Ces réflexions venaient en foule à mon esprit, en ce moment solennel, et doucement penché sur le malade je lui redisais les bonnes paroles de soumission à Dieu, et de consolation dans la foi et la sainte charité du Christ.
Après cela je voulus réciter les prières des agonisants: tout le monde s'était précipité à genoux, et pendant que je priais, je voyais les yeux du malade s'illuminer d'espérance et de bonheur.
Deux heures du matin sonnèrent au moment où je finissais; j'étais en droit de m'en retourner, mais le spectacle que j'avais sous les yeux était pour moi si nouveau et si beau, que je voulus en profiter plus longtemps. J'engageai donc une conversation appropriée à la circonstance; j'espérais que tous y prendraient part: c'eût été délicieux comme étude des moeurs. Mes calculs échouèrent: le respect et la crainte arrêtaient leurs paroles prêtes à sortir de la bouche; devant moi ils refoulaient en eux-mêmes leurs pensées, leurs sentiments et leurs impressions.
Vers 5 heures, j'invitai tout ce monde à la récitation du chapelet. Tous se précipitèrent à genoux; pour moi, je dirigeais la prière et eux me répondaient avec une simplicité et une foi incroyables.
Quand la prière fut terminée, j'attendis encore quelque temps que quelqu'un me donnât l'exemple du départ, mais pas une des 30 personnes, qui se trouvaient là, ne bougea. Après quelques bonnes paroles adressées au malade, je me décidai donc à partir le premier. On voulut me reconduire en voiture, on insista même; mais je refusai absolument, et je gagnai ma maison à pied, vers 6 heures du matin, tout heureux d'une veillée fatigante, il est vrai, mais toute remplie des plus douces émotions.
Quatre jours plus tard, James avait doucement quitté cette terre, et, chose étrange, c'était la phtisie qui tuait cet enfant des prairies.
Aussitôt les apprêts mortuaires commencent; on vient me demander des cierges bénis. Je n'en ai pas, mais je bénis quelques bougies que je donne avec les deux uniques chandeliers de l'autel. Dans la journée, je m'acquitte du devoir de la visite mortuaire. Le mort est sur son lit, complètement couvert d'une tenture noire qu'encadre un ruban blanc du plus bel effet. A côté du lit, contre la muraille, pend une autre tenture noire qui porte au milieu un crucifix noir et cuivre. Cette décoration funèbre produit un effet saisissant.
Au milieu de la chambre, un grand feu pétille dans un énorme fourneau de cuisine, et autour de la chambre se tiennent assis les parents et amis du défunt, plus de 20 personnes.
Une grave question est à résoudre. Où sera inhumé le défunt. Grande-Clairière n'a encore ni église, ni cimetière. James sera-t-il enterré ici ou conduit au cimetière d'Oak Lake, à 34 kilomètres de distance? Après une mûre délibération, le père et le beau-père du défunt viennent me donner leur décision: James sera inhumé à Grande-Clairière. Je conduis alors les deux hommes vers la place de l'église projetée, et où s'aligneront plus tard les tombes des morts. Ils choisissent une place, et, un peu plus tard, un ami y vient creuser une fosse. Le lendemain matin une longue file de traîneaux quittent la maison mortuaire, on les voit s'avancer lentement dans la plaine: les voici maintenant qui s'arrêtent devant notre chambre-chapelle. Le premier traîneau porte le cercueil, et c'est le propre père du défunt qui tient les guides des chevaux. Les autres traîneaux amènent la multitude des parents et amis. La porte de la chambre-chapelle s'ouvre; on y introduit le cercueil que l'on place devant l'autel. Je le bénis, je chante l'hymne Subvenite, puis la messe. N'ayant encore ni chantres, ni servants de messe, je suis forcé de me suffire tout seul.
La messe est finie, je dépose ma chasuble sur l'autel, puis me retourne vers le cercueil, sur lequel je chante le 'Libera me, Domine', dont les accents inspirés me frappent alors comme jamais cela m'est arrivé. Les dernières prières dites en face de l'autel, nous prenons tous ensemble le chemin de la tombe; je bénis la fosse, le cercueil y est descendu, je récite les dernières prières, je bénis une dernière fois le cher défunt. Puis tous, parents et amis, me suivent pour rendre à leur tour leurs derniers devoirs. Une heure plus tard la tombe était comblée et sur le petit tertre une croix de bois était plantée qui annonçait aux passants qu'un chrétien reposait là. Neuf années se sont écoulées depuis, et déjà 75 autres croix sont rangées autour de la première. Oh! comme la mort fait vite sa moisson!
Quelques jours plus tard nous célébrions Noël. Il faisait froid la nuit de la veillée; mais les 22 degrés de froid n'arrêtèrent aucun de mes métis: tous se trouvèrent réunis pour l'office de minuit. Quinze voulurent se confesser et communier. Oh! qu'elle fut simple mais délicieuse, cette soirée de Noël! Quelles espérances elle évoqua! À la même place, un an auparavant, se trouvait le désert; pas une âme n'était là, et moins d'une année après, douze familles s'y trouvaient réunies, heureuses et contentes, entourant l'autel, chantant, puis chantant encore les vieux noëls de France, que les métis avaient appris autrefois de la bouche même de leurs premiers missionnaires.
Thomas Breland eut l'heureuse idée de chanter le cantique si populaire 'Il est né...' et traduit en langue sauvage avec la mélodie bien connue. Thomas n'eut pas plus tôt entonné son cantique, qu'un vrai enthousiasme s'empara de l'assistance; tous s'en mêlèrent, hommes, femmes et enfants s'unirent dans une harmonie dure, sans doute, mais véritablement entraînante.
Tel fut le premier Noël célébré à Grande-Clairière; plusieurs autres ont suivi, plus illuminés, plus célébrés, mais aucun n'a renouvelé les suaves émotions du premier. Les quatre luminaires qui éclairèrent cette nuit me parurent plus imposants dans leur pauvreté que mille clartés.
Le dimanche suivant, deux jeunes métis faisaient leur première communion devant les paroissiens ravis. Et aussitôt commençaient les apprêts du nouvel-an, la grande fête profane de nos Canadiens français et de nos métis.
Jusqu'au premier janvier, chaque beau jour, – et ils avaient été nombreux ce premier hiver, – je n'avais pas manqué de faire quelque bonne excursion à travers la prairie, tantôt dans un sens, et tantôt dans un autre. Je voulais ainsi reconnaître les bons lots, un peu partout, afin de pouvoir les indiquer l'été suivant aux courageux colons que nous attendions nombreux de France et de Belgique. Ces courses, que je faisais à pied, tantôt à travers les foins, les joncs et les roseaux séchés debout, tantôt sur les étangs glacés, tantôt à travers les taillis et les bosquets, ces courses, dis-je, m'étaient devenues à ce point agréables, qu'à la fin j'y allais, non seulement par devoir, mais encore par goût et par entraînement. Je chaussais alors une chaussure en cuir mou, spéciale au pays, je marchais ainsi d'un pas alerte; et c'était pour moi un plaisir incroyable de fouler la couche de neige fine et friable, épaisse seulement de un ou deux centimètres.
Le 31 décembre, je faisais pour la trentième fois une de ces séduisantes excursions. Le temps était si beau et mon ardeur si grande, que je me surpassai de beaucoup, ce jour-là. Il était tard quand je m'aperçus que le soleil baissait fortement à l'occident. Je pressai aussitôt le retour. Mais à la tombée de la nuit, j'étais seulement en vue de la maison de Jean Léveillé. Il me restait encore huit kilomètres à franchir pour rentrer au logis. La vue de cette maison, qui m'était bien connue, et dont le toit fumant annonçait l'hospitalité, fit jaillir en moi une idée. Allons là, me dis-je; quelle vive et douce surprise je vais procurer à ces braves gens! J'ai vite franchi les quelques buttes de sable et les quelques fourrés qui me séparent de la maison. On ne m'attendait pas, surtout à cette heure. L'émoi est immense. On court appeler M. Léveillé qui était encore à ses étables, et aussitôt il arrive. M. Léveillé est un métis d'une stature superbe, chose du reste assez ordinaire chez les gens de sa race; il mesure 6 pieds de haut, et est large en proportion; sa femme, elle aussi, est remarquablement grande et forte. Autour d'eux s'agite tout un petit monde alerte de dix enfants, dont l'aînée compte seulement 16 années révolues. Le rez-de-chaussée de la maison comprend deux chambres. La première, celle où je viens d'entrer, est la chambre commune. On y fait la cuisine et on y mange. Un peu plus loin, vers le fond, est une chambre-salon au coin de laquelle un lit est placé. Cette chambre est très proprette; on y voit un canapé, des fauteuils, des chaises et une table ronde, le tout du plus bel effet. C'est là qu'on introduit les visiteurs quand on veut les soustraire au va-et-vient continuel de la nombreuse famille. C'est là que M. Léveillé m'introduit aussitôt. Tout en causant, nous prenons place près du feu que déjà l'on a vigoureusement attisé et que l'on entend brûler à ravir. Nous causons tranquillement, et pour mon compte, je ne suis à la conversation qu'à moitié. Par la porte de la chambre entr'ouverte, je suis du coin de l'oeil le mouvement de la cuisine. Mme Léveillé et son aînée s'y agitent fiévreusement. Je vois dans un coin un énorme quartier de boeuf qui pend là pour la fête du lendemain. Vous avez bien lu, lecteur, il s'agit d'un quartier de 180 livres. Ici les repas homériques sont encore de mode, l'ère des grands buffalos n'est pas bien éloignée; et pour le moment encore, il est si facile d'élever de grands troupeaux de boeufs, sans qu'il n'en coûte rien pour l'entretien; il suffit de les laisser croître et se multiplier. Assurément ni le pain ni la viande ne manquent dans nos plaines, et longtemps encore il en sera ainsi.
Cependant Mme Léveillé s'est attaquée au quartier de boeuf. Je vois d'énormes tranches s'en détacher; on les rapproche dans la marmite et je les entends frire. Je vois les armoires s'ouvrir et toutes les douceurs imaginables en sortir. La table se dresse; une vaisselle éclatante s'y entasse; tout est prêt. Une douce enfant, la figure épanouie, vient nous le dire en langue cry, la langue maternelle des métis. M. Léveillé me le répète en français. Nous nous levons, et maintenant nous voilà à table. Deux couverts seulement ont été mis; celui du maître de la maison et le mien. Nous mangerons seuls. Ainsi le veut un certain respect mêlé d'une certaine timidité. Je regrette beaucoup cette réserve sévère devant moi, et pourtant il me faut la subir.
Je venais de faire à pied une course de plus de douze kilomètres à travers la prairie, les bois, les broussailles et des dunes, et parfois par des terrains littéralement couverts de troncs d'arbre et de branches desséchées. Rien n'avait manqué pour aiguiser mon appétit. Nous ouvrons le repas par des boules de viandes hachées, grosses comme des boules de billard, et baignant à peine leur pied dans un peu de sauce. Tout en mangeant, je suis curieux de connaître le nom de ce plat, nouveau pour moi, et mon hôte avec un fin sourire me le nomme une soupe de métis. Après cela, voici venir tout d'abord d'excellents pruneaux, cuits dans leur jus, puis pommes, cuites en purée, puis du riz, cuit avec un mélange de raisins de Corynthe, c'est le plum-pudding des Anglais, avec cela un pain excellent, des beignets et l'assiette au beurre: le tout en abondance. Notre boisson est invariablement le thé, mais un thé de premier choix, bien sucré, proprement servi, avec du lait bien pur et bien frais.
Vraiment mon vigoureux appétit était plus que satisfait. Je me lève de table songeant déjà à payer en compliments le tribut de ma reconnaissance, quand Madame Léveillé, presque les larmes aux yeux, se confond en excuses pour m'avoir si mal reçu; elle invoque, il est vrai, la circonstance atténuante pour elle, de ma visite absolument subite et imprévue. Je réponds par des dénégations, qui paraissent contenter fort le légitime amour-propre de mon hôtesse.
Cela fait M. Léveillé et moi nous allons nous asseoir au coin du feu, et reprenons un 'petit brin' de conversation. Mais à ce moment j'entends un branle-bas formidable. Ce sont nos dix enfants, qui viennent de prendre la table d'assaut; et les voilà qui se servent à qui mieux mieux.
Je mets un plaisir extrême à contempler cet entrain charmant, et ces moeurs si patriarcales par tant de côtés. Mais déjà il se fait tard, il me faut rentrer. Je me lève pour partir, mais aussitôt l'on me dit d'attendre un instant. Deux jeunes gens courent à l'étable, d'où ils amènent en un clin d'oeil deux des meilleurs coureurs. Ils sont attelés à l'instant à un vrai bijou de voiture, pendant que M. Léveillé revêt ses habits de fourrures. Tout est prêt. Je donne des poignées de main à tout le monde, suivant l'habitude du pays, et d'un bond nous voilà en voiture, M. Léveillé et moi. Nous partons au grand trot. Il fait un temps superbe, le ciel est incomparable, les étoiles brillent de mille feux, sur un fond bleu transparent. Sur la terre il fait un froid de -8 centigrades; mais si sec, si velouté, qu'on le sent à peine. Vingt-cinq minutes plus tard, huit kilomètres étaient parcourus. Je descendais de voiture, et M. Léveillé, après m'avoir remercié pour le plaisir et l'honneur que je venais de lui faire, s'en retournait au grand trot de ses chevaux.
Huit heures du soir sont sonnées, quand je rentre chez moi. Je suis ravi, et en même temps, je puis le dire, fatigué, je n'ai qu'une pensée, celle d'aller me reposer au plus tôt. Mais je n'ai pas compté avec mon plus proche voisin. À la tombée de la nuit, mon bon Thomas Breland est venu chez moi et il a dit bonnement à mon domestique, qu'il nous attendait tous deux sans faute pour souper avec lui. Mon premier mot est un non bien motivé; puis je me ravise. Puis-je chagriner ainsi Thomas le 1er jour de l'an? Sans doute, je viens de manger pour un mois; mais ce soir même, ne puis-je pas souper sans souper? Et sans même m'être assis, nous partons aussitôt. Dix minutes plus tard nous entrions chez Thomas.
Toute la maison est dans un ordre parfait: une nappe d'une blancheur de neige couvre la table. Sur cette nappe sont rangées des assiettes et des tasses blanches, très ordinaires, mais éclatantes de propreté. Les cuillères, les fourchettes et les couteaux brillent du plus bel éclat métallique. L'assiette au beurre, les confitures, les gâteaux sont disposés là avec ordre et en abondance, au centre se trouve le morceau principal, une belle langue de boeuf froide, appétissante sur son plat long. À cette vue, je sens mon appétit presque revenir. Je commence par expliquer à Thomas, que je viens de souper copieusement chez son beau-frère, Jean Léveillé. Mais je m'aperçois que Thomas veut être sourd ce soir. Il commence par apporter avec une certaine appréhension le flacon illicite. Que faire? Dois-je refuser? Dois-je accepter ce whiskey qui m'est offert? Refuser, ce sera humilier mon hôte; accepter, ce sera en quelque sorte autoriser ces horribles excès, auxquels se livrent les hommes du Nord, une fois qu'ils ont goûté à la terrible liqueur.
Mon parti est vite pris; je prends ma tasse, et j'y laisse couler quelques gouttes d'alcool. De cette façon je n'humilie personne, et du même coup, je donne une bonne leçon de modération. Thomas et mon domestique s'en servent plus généreusement. Nous avons alors soin de trinquer comme de bons Français; puis mes hommes boivent d'un trait: c'est de règle absolue ici, paraît-il.
Cela fait, nous nous mettons à table. Breland, mon domestique et moi, Mme Breland, une sauvagesse pur sang, nous sert, et ses trois enfants nous regardent. Je présume qu'ils ont déjà soupé. Nous commençons par l'appétissante langue de boeuf, et nous continuons par les délicates friandises. Pour moi, ma décision est bien prise: je toucherai à peine à tout cela. Mais mon hôte malin me prend par surprise, et tranches de gâteaux glacés, morceaux de tarte, petits gâteaux secs, beignets de toutes sortes: tout cela tombe dru dans mon assiette, et avec une rapidité telle, que je ne puis rien éviter. Je m'exécute, et j'admire ce bon Thomas, qui, malgré sa pauvreté, a su se procurer cette abondance du nouvel an. Mais je parierais fort qu'il ne lui reste plus un seul centin dans sa poche.
Après le repas, nous allons nous asseoir auprès du feu, un vrai feu des grandes solennités; et pendant que la maîtresse mange avec ses trois enfants, nous engageons une conversation douce et intime. Je raconte mes premières impressions, en arrivant au pays, et je dis avec quelle bienveillance je fus accueilli, il y a 5 mois, dans le même logement où nous sommes maintenant réunis. À ce moment, Thomas s'émeut et il me dit avec coeur, qu'il n'oubliera jamais que je lui ai fait l'honneur de descendre chez lui, et que je n'ai pas méprisé sa pauvreté. Oh! que voilà bien le métis avec sa touchante sensibilité et sa noble fierté!
Et dire que ce pauvre Thomas aurait pu être riche... Son père, qui a été durant de nombreuses années membre du parlement de Régina, ne possède guère moins de 250,000 francs de fortune. Et ce père très bon n'a cessé d'aider ses enfants. Mais Thomas est si bon, si franchement métis, qu'il n'a jamais voulu se conserver un centin. Il a pour toute fortune sa pauvre cabane et son homestead, qu'il ne cultive pas, qu'il ne cultivera probablement jamais.
Quelques patates (pommes de terre), quelques oignons, quelques choux de Siam lui suffisent. Quand la nécessité l'y oblige, il va travailler quelques jours, gagne vite son argent, et le voilà ensuite heureux pour un mois. Ah! si la prairie pouvait rester déserte, comme les métis vivraient heureux! Mais le désert se peuple, et la lutte pour la vie a commencé pour le pauvre peuple métis.
Telle fut ma première veillée de nouvel an dans la prairie. Je dois maintenant raconter comment nos métis passèrent entre eux la grande fête du lendemain. O muse! prête-moi ton puissant appui!
Les métis se souhaitent le nouvel an avec force démonstrations. Dès l'aurore du grand jour les familles s'ébranlent: hommes, femmes, enfants, tous partent emportés dans des traîneaux. Chaudement habillés, couverts de fourrures de toutes sortes, les pieds et les jambes bien gardés par de chaudes couvertures, rien ne les arrête: ni les froids rigoureux, ni les épouvantables 'poudreries'. Leur élan est supérieur et irrésistible à tout.
Ce sont les inférieurs qui s'ébranlent les premiers: ils vont en bon ordre saluer les anciens, et ceux-ci ne manquent jamais de leur rendre leur visite. En s'abordant, les hommes se serrent la main et les femmes s'embrassent. Une femme qui refuserait ce jour-là l'accolade à une autre femme, lui ferait un sanglant affront: une réparation solennelle deviendrait nécessaire. Ce jour-là les haines doivent tomber, c'est le jour du grand pardon. On verra le lendemain si l'on doit les reprendre.
Les politesses échangées, l'on se met à table avec ardeur. Le jour de l'an, dans chaque maison, le festin est en permanence; les tables sont continuellement couvertes d'aliments succulents, et de boissons séductrices. Le communisme le plus réel règne alors: le riche donne plus, le pauvre moins, tout en donnant pourtant, comme s'il était très riche. La quantité de choses que font dévorer ces festins, est incroyable. Si 50 familles vivent dans une même localité, c'est en somme 50 bons repas que chaque individu devra faire. Et qui pourra nombrer tous les 'filets' de whiskey, qui s'y boivent? Ce ne sera pas moi, assurément. Le riche se procure assez facilement l'énorme substance de ces festins, le pauvre ne le peut sans recourir aux grands moyens. Il vendra sa dernière vache, sa charrue, son crible, n'importe quoi; s'il le faut absolument, il hypothéquera ce bon poney, l'inséparable compagnon de ses courses. Et quand l'argent de la vente ou de l'hypothèque sera dans sa main, il ira l'échanger tout droit contre ces douces choses, qui font la joie du jour de l'an.
Oh! qu'elle fut animée la solitude de Grande-Clairière le premier de l'an 1889! Le temps se mit de la partie: une splendide aurore éclaira les plus pressés, puis le soleil vint briller comme il sait briller ici. Le ciel était diapha
J'étais si rempli de ce préjugé, qu'en débarquant au Canada, je voulais constater sur le visage de ceux que je rencontrais les traces des souffrances endurées en hiver: mais plus je regardais, moins je voyais. Pourtant mon préjugé restait; il ne devait tomber totalement que dans ma propre expérience.
Aussi, ce ne fut pas sans une vague terreur, que je vis venir mon mystérieux inconnu, l'hiver du Nord-Ouest canadien.
J'avais voulu être prudent: toutefois, les premières neiges me surprirent avec les derniers apprêts. Vers la fin de novembre seulement, je pus faire mes derniers voyages d'affaires à Brandon et à Winnipeg. Maintenant je suis prêt. Rien en somme ne me manque des choses strictement nécessaires à la vie; un fourneau-cuisine chauffe l'unique pièce de mon logis, et cette pièce, longue de 5 mètres et large de 4, comprend deux divisions: la première me sert de cuisine, de salle à manger, la deuxième fait l'office de chambre à coucher; une sorte d'armoire fixée fait la séparation des deux pièces. Deux lits remplissent l'arrière-chambre; celui de mon domestique et le mien. Une latte clouée au plafond, ou plutôt sous la toiture, supporte une large couverture qui en descend déployée; cette couverture est toute la cloison entre deux lits. Nos pieds foulent un plancher, mais en haut nous avons la toiture pour plafond. Cette toiture est faite de planches avec des bardeaux cloués dessus; en France, on appellerait cela vivre sous la tuile. Mais que le lecteur ne tremble pas trop fort pour nous: notre toiture est parfaitement étanche et imperméable à l'eau, au vent et à la neige. À la cave se trouve une petite réserve de 'patates', pommes de terre; dans un placard sont rangés des paquets de denrées coloniales; un gros quartier de boeuf pend au hangar, et quoique maigre et osseux, il donne cependant une certaine confiance, que complète la présence d'un porc fraîchement tué. Ces viandes sont gelées dur, et elles resteront dans cet état jusque la fin de mars; c'est près d'elles que, la scie à la main, j'irai chercher le morceau quotidien. Le pain ne nous manque pas non plus; quelques sacs de farine sont mis en réserve. La vaisselle rudimentaire est là à côté de l'élémentaire batterie de cuisine; fourchettes, couteaux, tout est prêt pour faire les honneurs de ma table. Les chaises, les fauteuils, et les milles merveilles du confort contemporain, manquent totalement. Mais des tabourets grossiers, des bouts de banc branlants, des petites caisses à marchandises, qui portent encore leurs étiquettes rutilantes, remplacent pittoresquement le luxe de la civilisation. Ces sièges peu moelleux fatiguent vite; mais quand je suis las d'être assis, je me tiens debout, ou je vais marcher et m'agiter dehors.
Je ne puis raconter en détail ici les différentes péripéties de ce premier hiver; comment je vécus dans la société de mes bons métis; comment ils me régalèrent des récits de leurs chasses d'autrefois, de leurs rudes combats avec les sauvages, avec les terribles Sioux notamment.
L'origine de la nation métisse remonte à un siècle environ. De hardis traiteurs canadiens, au service de deux compagnies, celle de la Baie d'Hudson et celle du Nord-Ouest, arrivèrent dans ces plaines pour y trafiquer avec les sauvages; ils établirent des forts un peu partout, soit pour s'y défendre à l'occasion contre les sauvages, toujours portés à quelque retour offensif, soit pour acheter les produits de chasse de ces indigènes. Plusieurs trouvant le pays à leur goût s'y établirent: ils épousèrent des sauvagesses, et fondèrent ainsi les premières familles métisses. Ces familles, d'abord peu nombreuses, se multiplièrent dans la suite. Ce peuple compte maintenant environ 30,000 âmes répandues un peu partout dans les immenses plaines sur les frontières du Canada et des États-Unis. Mais c'est surtout au Manitoba, autour de Saint-Boniface, qu'ils se sont fortement concentrés. Les premiers métis, nés en quelque sorte au milieu des sauvages, en adoptèrent le genre de vie; ils devinrent tous chasseurs. La chasse au buffalo devint leur unique industrie; mais cette n'était pas une simple tournée autour des habitations. Le buffalo n'avait pas la simplicité confiante du lièvre; il vivait loin de la société de l'homme, son mortel ennemi. Pour atteindre le buffalo, il fallait organiser de véritables expéditions. On s'organisait par bandes nombreuses: hommes, femmes, enfants, tout le monde en était; les hommes à cheval, les femmes et les enfants sur de grossiers chariots à deux roues. Ces partis de chasse reconnaissaient une discipline; ils avaient des capitaines qui décidaient des marches et des haltes. Des éclaireurs précédaient la colonne soit pour découvrir les buffalos, soit pour signaler la présence de quelque parti de sauvages hostiles. Le soir venu, les voitures se disposaient en cercle; l'intérieur du cercle devenait ainsi une sorte de camp retranché. Des sentinelles veillaient tout autour en avant du camp, prêts à donner l'alarme en cas d'attaque. Les métis ont dû soutenir parfois de rudes combats. Se tenant habituellement sur une sage défensive, ils ont pu infliger de grosses pertes à l'ennemi, et éviter pour eux-mêmes de graves désastres; et en cela aussi les conseils de leurs missionnaires les ont grandement aidés.
Lors des beaux temps de chasse, les buffalos étaient innombrables; il n'était pas rare d'en rencontrer des bandes de plus de mille individus. Les chasseurs tâchaient d'envelopper le malheureux troupeau signalé; puis le massacre commençait, les coups partaient de tous côtés, les balles sifflaient, les animaux blessés roulaient sur le sol: c'était un vrai carnage.
Ces chasses offraient bien leurs palpitantes émotions; parfois une bête affolée se précipitait tête baissée sur le cavalier qui l'avait blessée; d'un coup de corne le cheval pouvait être éventré et son cavalier renversé, puis écrasé. Le chasseur prudent savait se garder dans ces circonstances redoutables, il luttait d'habileté et d'adresse. Habituellement, les buffalos attaqués hâtaient leur fuite dans toutes les directions, laissant leurs morts et mourants aux mains des vainqueurs. Le dépouillement des bêtes commençait alors; les hommes éventraient et pelaient les victimes, les femmes les dépeçaient. Quand le carnage était grand, on ne prenait de la bête que la peau, les meilleurs morceaux et les graisses de choix plus faciles à conserver: le reste devenait la proie des corbeaux et des loups de prairie. Des malheureux buffalos il ne restait bientôt que les os qui allaient ensuite blanchissant de plus en plus avec le temps.
Maintenant il ne reste plus de buffalos: pourchassés, massacrés partout, ils sont tous disparus, c'est à peine s'il en reste quelques-uns dans les solitudes inexplorées.
Pourtant leurs os sont partout épars dans la plaine. Près des coulées profondes, l'on distingue encore les traces qu'ils suivaient en allant se désaltérer. Les squelettes de buffalos sont devenus l'objet d'une nouvelle industrie: les fils des vieux chasseurs vont ramasser ces os, qu'ils transportent ensuite aux stations lointaines, les accumulant en immenses ossuaires, énigme et surprise pour le touriste du Nord-Ouest. Voilà seulement quinze ans que les buffalos ont disparut: avec eux s'est évanoui le siècle d'or des métis.
Questionnez le premier venu d'entre eux sur les chasses d'autrefois, et il vous répondra par un soupir. Parmi les métis, certains se sont assez bien pliés au genre de vie sédentaire; les autres continuent leur courses à travers la prairie, campant par-ci par-là un jour, un mois, une année; puis s'envolant sous d'autres cieux qu'ils quitteront encore pour continuer la vie errante du désert: ils paraissent inconsolables d'un passé à jamais fini.
Une paroisse nouvelle se fonde-t-elle: l'amour du changement y conduit ces braves gens. Ils vinrent à moi de tous les points de l'horizon. Foncièrement brouillés avec les lois de l'économie, ils accoururent naturellement sans argent, chassant devant eux un troupeau fort restreint, composé bien plus de poneys coureurs peu utiles que de vaches nourricières, et riches au moins du fusil sur lequel ils comptent sans souci, pour trouver la nourriture de chaque jour.
Ils n'étaient donc pas fortunés ces enfants du désert, quand ils accoururent à moi: je ne pouvais compter sur leur bourse, je puisai uniquement dans la mienne que remplissait sans compter, au premier signal de détresse, ma pauvre vieille mère laissée là-bas au fond d'une vallée d'Alsace, le doux pays de mon enfance! Pourtant je ne voulus pas abuser du dévouement maternel. J'aimais mieux me priver de beaucoup que d'exposer ma mère à se dépouiller plus qu'elle ne pouvait. Elle eût fait cela, si elle avait tout su; mais soigneusement, je lui cachais le côté le plus violent de mes privations peu communes. Bien volontiers, tout d'abord, je me contentai d'un de ces pauvres réduits qu'on appelle ici 'chantiers'. Le rudimentaire appartement ne laissait voir aucun ornement ni meuble digne de ce nom; je m'en tenais au stricte nécessaire. Le jour, avec le feu de mon foyer, j'étais trop heureux de pouvoir contrebalancer, tout juste assez, les froidures du dehors, et la nuit, enfoncé sous mes couvertures épaisses, je défiais assez bien les froids hyperboréens des plus rigoureuses nuits, que des cloisons mal jointes laissaient facilement entrer. L'impression était vive, quand certains matins, à mon réveil, je lisais 20 à 25 centigrades à glace au thermomètre qui pendait au chevet de mon lit, mais n'exagérons rien: ces froids énormes, dans ma chambre à coucher, se sont vus quelquefois seulement. Assez souvent la température de nuit, dans ma chambre, variait entre 10 et 20 à glace. Avec quelle rapidité j'allumais alors le feu, on le comprendra facilement, et ce feu peu ordinaire mettait une heure de grands efforts pour vaincre les froidures accumulées de la nuit. Les choses allaient ainsi, du moins en temps ordinaire; mais il en était tout autrement les jours de grandes 'poudreries'. Je n'oublierai jamais que, certaines matinées, mon malheureux thermomètre ne put indiquer que 5 degrés à glace dans ma chambre; mais je dois l'avouer, dehors la 'poudrerie' était alors formidable.
Mais ne créons pas d'impressions fâcheuses et fausses. J'ajouterai donc que toutes les maisons du Nord-Ouest canadien n'en sont pas là: loin de moi cette pensée. Pendant que ma maison restait une vraie glacière, celles de mes bons voisins les métis maintenaient une douce et vivifiante température. Quant à moi, l'argent et l'expérience m'avaient manqué en face de mon premier hiver, et je tâchais de ne pas payer trop cher mon apprentissage du pays.
Toutefois ma santé se maintint excellente; le froid très réel mais sec, relativement combattu, comme je l'ai dit, parut me procurer une nouvelle énergie. Chose incroyable, cet hiver, où tout sembla me manquer, fut pour moi un des plus agréables, et certainement le plus pittoresque de ma vie.
Tous les dimanches, mon petit peuple avait soin de se rendre chez moi: une petite chambre séparée, et bien imparfaite, nous servait d'église. Il y eût fait un froid énorme, sans la présence d'un gros fourneau, où un superbe feu ne cessait de flamber pendant tout l'office. L'autel était tout ce qu'il y a de pauvre, il était formé d'une table à peine dégrossie, avec deux ou trois planches par-dessus en forme de gradins. Une tenture fort simple, jetée sur ces planches, essayait d'en cacher l'extrême pauvreté; mon vieux missel, mon antique chasuble et l'aube: tout était à l'avenant. Deux simples bougies éclairaient seules le divin sacrifice. Il serait bien difficile, n'est-il pas vrai, d'imaginer quelque chose de plus pauvre!
D'autre part, ce dénûment avait bien aussi ses charmes: quand on est pauvre, mais en même temps qu'on a l'espérance, on jouit en quelque sorte de sa pauvreté, on en est fier, on se sent conquérant, on voit d'avance les succès et les joies du triomphe. Et puis comme il parlait délicieusement à mon âme, ce spectacle de mes dix pauvres familles groupées pieusement autour de cet autel! j'avais là l'image vivante de l'étable de Bethléem; que dis-je? j'en avais la réalité complète. Nous avions le divin Enfant dans l'Eucharistie. Marie et Joseph étaient là en esprit; les anges s'y trouvaient aussi planant au-dessus du sacrifice et chantant silencieusement leur cantique éternel; et nous avions la troupe des bergers agrandie dans la personne de mes chers métis, ces ineffables nomades.
Je ne laissais passer aucun dimanche sans leur adresser la parole. Mes instructions étaient éminemment simples. Autant que je le pouvais, je voulais me mettre à la place de mes auditeurs: j'étais heureux de leur parler ainsi, et eux m'écoutaient avec respect et bonheur.
La messe finie, mes gens n'étaient pas pressés de s'en aller. Pour moi, je déposais les ornements sacerdotaux, et j'éteignais les deux luminaires. Nous faisions alors un grand cercle autour du foyer, puis la conversation commençait. Elle roulait tout d'abord sur les quelques nouvelles locales, puis nous abordions nos deux grands sujets favoris. Moi je parlais des choses de France, et eux ne tarissaient pas dans les récits de leurs chasses d'autrefois.
Le métis aime la France, il sait parfaitement, que son aïeul blanc vient de là. Il a appris cela sur les genoux de sa mère, les missionnaires français sont venus le lui répéter, et vous pouvez y compter, jamais il ne l'oubliera. La France et la prairie voilà bien les deux patries du métis; il voit la première dans un mystérieux vague, qu'il ne peut démêler; mais il connaît à merveille tous les secrets de la seconde, et c'est celle-ci qui procure au métis des pensées à son esprit, et des sentiments à son coeur. Abordez un métis. Vous le trouverez tout d'abord d'une grande réserve: une certaine timidité, une certaine conscience de son infériorité l'arrête; mais enhardissez-le, et alors vous lui verrez beaucoup d'expression et de volubilité. Volontiers, il vous posera quelques questions sur les choses de France, et pour peu que vous vous y prêtiez, il se lancera à fond de train dans les récits des chasses d'autrefois. En général la narration du métis est loin d'être ennuyeuse. Elle charme par la simplicité et le bon sens. Dans les pays civilisés, on s'imagine facilement que l'homme, qui tient de si près du sauvage, doit être excessivement borné: c'est une erreur absolue. Croyez-le: la civilisation matérielle gâte bien des gens; et nos métis, en une foule de choses, raisonnent autrement juste que bien des paysans d'Europe, que bien des ouvriers des grandes villes. Mais ce qui frappe surtout chez eux, c'est la rapidité du coup d'oeil: déjà ils ont tout vu, tout jugé, lorsque vous, à leur côté, vous commencez seulement à voir.
Ce peuple métis si remarquable, si plein de foi, si moral, si solide, si sain de corps et d'esprit, remarquons-le en passant, c'est la religion qui l'a fait ainsi: tels les Jésuites avaient formé leurs sauvages du Paraguay, tels les Pères Oblats ont élevé nos métis dans les plaines du Nord-Ouest. Ces derniers, jusqu'en 1870, ont vécu séparés, en quelque sorte, du reste de l'humanité: ç'a été leur salut. Maintenant ils sont pleinement en contact avec les blancs, et déjà l'on voit clairement les conséquences fâcheuses de cet état de choses. Comment cela finira-t-il? Je n'en sais rien, toujours est-il que les vingt dernières années sont loin de marquer un progrès moral et matériel du peuple métis. Il conserve toujours sa croyance simple; mais sa vertu, sa sobriété et sa bonne simplicité d'autrefois sont en baisse.
Nous voilà aux confins de la sauvagerie. Un mot sur les pauvres tribus indiennes ne sera donc pas ici, je le crois, déplacé.
Il reste quelques sauvages dans les vieilles provinces orientales du Canada; mais c'est surtout dans les vastes plaines du Nord-Ouest qu'on les rencontre plus nombreux. Innombrables dans les siècles précédents, ils n'ont cessé de diminuer jusqu'à nos jours. Maintenant toutes les tribus sauvages réunies ne donnent pas plus de 100,000 individus, plus ou moins groupés dans les différentes provinces canadiennes. Ces tribus sont loin de former une seule langue; elles paraissent venir au contraire de races très différentes. Citons parmi beaucoup d'autres les Hurons et les Iroquois dans les provinces orientales; les Crys, les Assiniboines, les Sauteaux et les Sioux dans les plaines du centre; et plus loin, vers le pied des Rocheuses: les Gros-Ventres, les Pieds-Noirs et les Montagnais. Là, encore, la terre s'est peuplée par des migrations successives de peuples: les derniers refoulant les premiers. Les sauvages ne sont pas les esclaves des blancs, ils continuent de vivre d'une vie à part. Leur genre de vie n'a pas changé; ils continuent de courir la prairie dans tous les sens, pour le plaisir de courir, chassant et pêchant, suivant les circonstances. Outre cette liberté de courir la prairie, le gouvernement leur a octroyé certaines étendues de terrains, un peu partout. Ces terres s'appellent réserves. On en compte une centaine environ dans l'immense région du Nord-Ouest, elles sont de toute étendue, depuis 12 jusqu'à 2000 kilomètres carrés. Dans ces réserves les sauvages vivent soumis comme autrefois à leurs chefs naturels; mais ceci, c'est pour la forme seulement; car en réalité la loi des blancs pèse sur ces indigènes. Le chef sauvage est simplement chargé de la faire observer, sous le regard vigilant d'un agent du gouvernement, qui est là pour surveiller et le chef et ses sujets, et les faire marcher tout juste comme le veut le gouvernement des blancs. En cas de complication, la police montée n'est pas loin, toujours prête à faire usage de ses bonnes carabines. Le sauvage le sait bien, et se le tient pour dit; les quelques mouvements qu'il a essayés ne lui ayant pas réussi, il a renoncé facilement à sa fierté d'autrefois. Du reste, le gouvernement central, à la place de grouper tout ce monde sauvage en quelques réserves énormes, l'a éparpillé sur une multitude de petites, généralement très distantes les unes des autres. De cette façon les soulèvements généraux sont devenus matériellement impossibles, or tout est là pour le gouvernement central.
Du reste les sauvages jouissent de la plus grande liberté. Nous l'avons vu; il peuvent courir la prairie, comme bon leur semble; ils peuvent chasser et pêcher partout, tout comme les blancs; ils ont en outre la jouissance exclusive de leurs réserves; ils en peuvent cultiver la terre, ou la laisser en friche; s'ils se décident à la cultiver, ils disposent de leurs récoltes comme ils l'entendent, absolument comme peut le faire tout autre fermier. Toutefois cette terre dont ils disposent, ils n'en ont que la jouissance, ils peuvent en tirer tous les fruits possibles, qu'ils peuvent consommer, vendre ou détruire; mais la terre reste inaliénable. Si le sauvage pouvait vendre ses terres, il y a longtemps qu'il ne resterait plus une seule réserve: tout serait vendu depuis des années! Ajoutons, afin d'être complet, que le gouvernement a institué un grand nombre d'écoles primaires pour les sauvages; il a fait plus encore; il a établi plusieurs écoles dites industrielles. Là on procure aux enfants des sauvages une culture intellectuelle plus grande, et en même temps on leur apprend un métier. Mais le sauvage n'a pas encore l'ambition des blancs; il ne voit guère les avantages de l'instruction; la connaissance d'un métier le laisse d'ordinaire très indifférent. Aussi est-il rare qu'il laisse ses enfants profiter des avantages de l'école. Pour lui rien ne vaut les plaisirs de la vie nomade.
On se figure peut-être que le petit du sauvage est trop grossier pour saisir les choses de la culture intellectuelle: gardez-vous de le croire; l'intelligence d'un petit sauvage vaut l'intelligence d'un petit blanc; et il est aussi apte à apprendre un métier que n'importe quel adolescent blanc que l'on voudra. Toutefois, une chose essentielle manque au sauvage, comme elle manque aussi au métis: c'est la fixité, c'est l'esprit de suite. Ce sauvage qui apprend un métier, vous pouvez croire qu'il n'en fera rien ou à peu près. Ces gens n'entendent absolument rien dans l'art de l'économie; jamais on n'en a vu devenir riches; ils sont tout au présent comme l'oiseau des champs. Le passé ne compte plus pour eux, ils ne se le raisonnent jamais, ils n'en tireront jamais de déductions pratiques pour la conduite de la vie. Quant à l'avenir, ils ne s'en inquiètent pas davantage; s'ils ont beaucoup un jour, ils mangeront beaucoup, ils feront joyeusement de grands gaspillages, sans se demander jamais si peut-être ils ne mourront pas de faim le lendemain. Combien de temps faudra-t-il pour transformer ces idées des Indiens? Des siècles probablement. Voilà plus de deux cents ans que les Iroquois sont en contact continuel avec les Canadiens français dans les provinces orientales, et pourtant, c'est à peine s'ils ont modifié légèrement leurs idées primitives. La civilisation est comme une seconde nature: et il lui faut des siècles pour naître et se développer.
Chez le sauvage le sort de la femme paraît dégradant, elle n'est guère que l'esclave de l'homme; elle travaille et porte les fardeaux plus qu'à son tour: l'homme ne paraît guère comprendre qu'elle est la plus faible, que pour lui faire sentir que lui est le plus fort, qu'il est son maître, et qu'elle est sa servante. La taille du sauvage est au-dessus de la moyenne, son visage n'a rien de repoussant, il respire le calme, sa tête est large, ses traits n'ont rien de fin et son fortement accusés; l'homme paraît généralement solide et bien bâti; l'obésité est inconnue dans cette race, le teint n'est ni jeune ni noir; il est une sorte de brun jaunâtre qu'on a bien voulu appeler rouge cuivré. Et pourtant ce sauvage, qui paraît maintenant si calme, était terrible il n'y a pas encore bien longtemps, le Sioux surtout, s'était acquis entre tous une triste renommée, pour ses cruautés et son humeur belliqueuse indomptable à l'égard de tout le monde. Ses excès devinrent sa perte: métis et sauvages s'unirent pour l'écraser et réussirent assez bien.
Depuis 30 ans, ces horribles carnages ont cessé: la civilisation a si bien percé la prairie de part en part, dans tous les sens, que les sauvages, se voyant bien enlacés, ne se sentent plus la moindre velléité d'égorger personne. Le blanc peut voyager partout, en sécurité, dans l'immense prairie: s'il lui arrive malheur, ce ne sera pas de la main d'un sauvage qui l'aura frappé, ce sera celle d'un autre blanc. Mais, en cela spécialement, le Canada est encore très heureux. les assassinats y sont rares, surtout dans les régions peu habitées de l'Ouest.
Outre leurs réserves, nos sauvages reçoivent de l'État une pension annuelle de quelques piastres, faible dédommagement pour ces immenses étendues que le gouvernement s'est adjugées, comme étant inoccupées! Le jour de la paye est le jour ardemment désiré des sauvages. Ils n'oublient jamais d'en faire un grand jour de fête. Les marchands des villes voisines ne se le font guère dire: ils savent bien trouver ce jour-là les sauvages au chef-lieu de leur district; ils peuvent apporter sans crainte toutes leurs réserves de vains bibelots et parures; tout est acheté, sans compter, du moment que les couleurs seront d'un rouge bien voyant. Et le soir arrivé, il ne restera plus rien de la paye: l'argent venu le matin dans la sacoche des agents, s'en retournera 12 heures plus tard, soigneusement enfoncé dans les poches des marchands. Et le lendemain, le sauvage pauvre comme l'avant-veille, n'aura aucun regret, il aura passé une fois encore un beau jour; ça lui suffit, il n'y pensera plus; il se réservera tout entier à l'espérance de la paye suivante. À cela, peut-être, y a-t-il quelques exceptions, c'est possible; mais elles doivent être très rares, assurément.
Quand on a dit du sauvage qu'il est chasseur et pêcheur, mais surtout voyageur et flâneur, on en a résumé toute la vie. Une législation spéciale le régit. Entre autre chose, l'usage des boissons enivrantes lui est strictement interdit. La sévérité de la loi poursuit surtout celui qui procure ces boissons aux sauvages. Plus encore que le blanc, le sauvage a la passion innée de l'alcool, à tel point que la nation entière périrait en quelques années, si l'usage lui en était concédé.
Pour voir et étudier nos sauvages, point n'est besoin de se rendre à leurs réserves. L'amour des voyages et l'attrait du spectacle de la civilisation des blancs les font sortir sans cesse de leurs campements. Ils aiment venir planter leurs tentes aux abords des stations et des villes; et là, nonchalamment assis ou couchés pêle-mêle, ils regardent circuler le monde et paraissent goûter un plaisir extrême à voir les blancs s'agiter si fort. Quand la faim devient pressante, les femmes quittent leurs marmots pour quelque temps, vont chercher une heure ou deux d'ouvrage aux maisons voisines, puis s'en reviennent avec quelques restes d'une nourriture parfois déjà décomposée et presque toujours rebutante. Comment se fait le partage? Je n'en sais trop rien. Mais il y a apparence que le plus fort s'adjuge la part du lion. Si la faim augmente et que le travail manque, on n'hésite pas: la tente est enlevée, on attelle les poneys, et déjà l'on est en route. Les apprêts du départ ont pris tout juste cinq minutes, et voilà qu'on chemine dans la plaine. Si le nombre des poneys le comporte, les hommes montent des chevaux, tandis que les femmes et les enfants se laissent traîner sur le grossier chariot à deux roues, tout en bois à peine dégrossi; si les chevaux ne sont pas en nombre, tout le monde s'entasse dans l'étroit véhicule.
Le plus souvent, on marche au petit bonheur, tuant par-ci, par-là, soit un faisan, soit un lièvre, soit plus rarement un chevreuil ou un cerf. Des buffalos incomparables il ne faut plus parler, il n'y en a plus. Le soir on tâchera d'arriver à un endroit où l'on pourra trouver un peu d'eau, avec un peu de bois; on s'arrêtera là. Si une sécheresse trop persistante a tari l'eau de la coulée ou celle du lac éphémère, hommes et bêtes se passeront de boire ce soir-là et le lendemain matin encore. On dressera la tente, on allumera un feu, et pendant que les hommes mangeront le gibier tué dans la journée, les chevaux, laissés à eux-mêmes, pâtureront en liberté autour du campement, c'est leur affaire habituelle chaque soir; ils ne se sauveront pas. Le lendemain le voyage continuera comme la veille, et ainsi de suite jusqu'au moment où un heureux hasard aura conduit la petite bande à quelque endroit fortuné où le gibier se rencontrera abondant, ainsi que le bois et l'eau. On campera là, plus ou moins longtemps, jusqu'au moment qu'une sorte de nostalgie s'emparant de nos sauvages, il leur prendra l'idée d'aller revoir leurs connaissances de la réserve, dans quelque ville ou village, pour y flâner au milieu des blancs, aussi longtemps que la chose leur sourira. Et cette ardeur des voyages, rien ne pourra l'arrêter, ni les chaleurs de l'été, ni les rigueurs de l'hiver.
Il n'est donc pas rare de rencontrer le sauvage à travers la prairie. Parfois la chasse ne lui a pas réussi, alors il va frapper aux fermes qu'il rencontre sur son chemin, il entre sans plus de façon, s'assied sur un siège, sans en avoir demandé la permission. Il ne dira pas un mot, restera immobile, paraissant plongé dans des méditations philosophiques profondes. Il se tiendra ainsi pendant une heure, une journée, s'il le faut. Il n'est pas pressé et il est patient. Le jeter à la porte, il sait bien qu'on ne le fera pas; il sait que de guerre lasse on finira bien par lui donner quelque chose, sans compter le dîner que parfois il trouve en attendant. Et le voilà regagnant sa charrette et les siens, qui l'ont attendu sans broncher aucunement. Alors naturellement, il partage, et s'il a bien dîné, facilement il se montre généreux. La marche reprend, elle continuera le lendemain, et ainsi de suite, pour chacun, jusqu'à son dernier jour!
Ce pauvre sauvage a-t-il quelque religion? Certainement; et l'idée qu'il se fait de la divinité est remarquable. Il n'adore pas une infinité de dieux, comme le faisaient autrefois ces princes tant vantés de la civilisation: les Grecs et les Romains; il n'admet qu'un dieu qu'il appelle 'Manitou' c'est-à-dire 'Grand-Esprit'; il admet en outre un mauvais Esprit en opposition et inférieur à Manitou. Notre sauvage a ses prêtres qu'il appelle sorciers, et son culte consiste surtout en danses sacrées, en musique et en chant, ou mieux en certains cris tantôt gutturaux, tantôt aigus. Le tambour est l'instrument sacré préféré, il joue le rôle principal dans les cérémonies du culte, soit quand quelqu'un est malade pour le rappeler à la santé, soit aux jours de fêtes traditionnelles.
Disons immédiatement que le 'Manitou' est en baisse parmi les sauvages. Comme nous l'avons dit plus haut, ces gens sont au nombre de 100,000 individus, habitant le Canada, soit exactement 99,717.
Sur ce nombre 31,349 sont catholiques, 25,275 sont protestants, 21,112 sont païens.
Ainsi donc près des trois-quarts des sauvages sont passés au christianisme, et parmi ces chrétiens sauvages ce sont les catholiques qui en comptent le plus. Certains sauvages deviennent de bons chrétiens; quelquefois même des chrétiens admirables; mais un grand nombre se relâchent facilement, quand ils restent longtemps sans voir le missionnaire. Les ministres protestants avilissent un peu trop facilement les motifs de conversion, en accordant leurs dons généreux aux sauvages qu'ils convertissent. Cela se faisant sur un large pied, il est hors de doute que l'argent et d'autres choses ont trop part à la conversion des sauvages au protestantisme.
Au point de vue moral, les sauvages païens voient assez clairement tout ce qu'il y a de différence entre le missionnaire catholique et le ministre protestant. Toutefois, presque invariablement, ils font observer au missionnaire catholique qu'il ne donne ni argent ni habits comme le ministre protestant. La 'robe noire' est toujours plus respectée; mais assez souvent les pièces sonnantes sont plus aimées.
Une autre misère entrave le mouvement des conversions: ce sont les vices de beaucoup de blancs. Cela démoralise les nouveaux convertis et détourne les païens de la conversion; leur raison peu formée ne leur permet pas de bien distinguer la religion et les vices des hommes, ils méprisent une religion qui paraît produire de tels hommes.
Dès l'été précédent déjà, j'avais pu étudier sur le vif nos bons sauvages: je les avais vus innombrables à Piguis, sur les bords du lac Winnipeg, au grand jour de la paye; je les avais vus, ensuite, bien des fois encore, et de très près, dans les magasins d'Oak Lake, où mes affaires m'appelaient souvent. Le 2 décembre, j'eus plus de bonheur encore: ce jour-là, deux sauvages me firent le plaisir d'entrer chez moi, tout à fait à l'improviste. C'était un dimanche matin, vers onze heures, ma messe était dite et tout mon monde retiré; mon domestique ouvrait la porte pour se mettre en voyage pour un jour, quand mes deux Sioux entrèrent. Mon domestique, qui put les voir encore, eut sans doute peur pour moi; car passant devant la maison de Thomas Breland, il le pria d'aller voir ce qui se passait chez moi.
Voilà donc mes deux sauvages entrés; ils procèdent à leur façon; ils oublient de saluer, naturellement. Une demi-seconde leur suffit pour se rendre compte de l'état des choses chez moi. La présence de la 'robe noire' dans une maison si pauvre et aux confins de la solitude a dû les surprendre; rien pourtant ne paraît sur leur visage calme. Un sauvage ne s'émeut pas pour si peu. J'étais encore à table, quand mes deux visiteurs sont entrés; c'est mon tour de ne pas m'émouvoir et je continue tranquillement mon pauvre repas, pendant que mes deux Sioux s'asseyent bonnement sur un long banc, à côté l'un de l'autre, en face et à deux pieds du foyer incandescent. Ce banc très primitif n'a pas de dossier, mais il s'appuie contre la muraille qui fournit ainsi un dossier très solide. À ce moment Thomas, mon bon voisin, fait son entrée, c'est on ne peut mieux; il connaît la langue des sauvages, il pourra donc me servir d'interprète. Thomas, en bon métis, me salue du regard; puis s'assied près du feu, non loin des sauvages, qu'en un-dixième de seconde il les a déjà toisés du haut en bas. Sur un mot de moi, l'interview commence. J'apprends alors que mes deux sauvages sont des fils des terribles Sioux; ils ont quitté, disent-ils, le lac du Diable (États-Unis) il y a cinq jours, et depuis ce moment ils n'ont plus rien mangé. Le sauvage, paraît-il, est capable de jeûnes aussi rigoureux.
Toutefois pour le présent cas, Thomas, qui s'y connaît en sauvages, me dit que nos hommes mentent; il est convaincu qu'ils ont bel et bien mangé, chacun de ces cinq jours, tout comme ils mangent en ce moment chez moi; ils savent parfaitement s'arrêter aux fermes quand ils ont faim. Nous en avions en effet une preuve bien claire sous les yeux. Mais déjà le lecteur a compris que nos deux sauvages reçurent à manger chez moi, j'eus même la chance peu commune de les servir moi-même. Cela me fut du reste très facile: il me restait énormément de potage au riz cuit avec du lard; le pain et le thé ne manquaient pas non plus, nos deux sauvages s'en régalèrent comme ils voulurent, je crus remarquer qu'ils ne mangeaient pas comme des hommes écrasés sous un jeûne de 5 jours. Il est vrai que le lard cuit avec l'eau et du riz n'est pas leur plat habituel, ils préfèrent les bonnes viandes saignantes de ce beau gibier qu'ils tuent à la chasse. Détail à noter: quand ils n'eurent plus faim, ils remirent soigneusement dans le plat ce qu'ils avaient pris dans leur assiette, en plus de leur appétit. À part cela, ils s'étaient tenus 'correctement' à table. Quoique fort dispos, ils tenaient l'échine raide: et nos deux hommes, aussi vite mangé aussi vite debout. Évidemment pour eux la table est faite pour y manger, et rien que cela: et les voici qui reviennent prendre leurs places de tout à l'heure en face du feu. La conversation, un moment interrompue entre Thomas et eux, reprend de plus belle. Ne croyez pas que cela coulait comme un torrent rapide: point du tout. Une question était posée par l'un ou l'autre des interlocuteurs; la réponse suivait immédiatement, puis venait une pause plus ou moins longue, servant sans doute de réflexion; puis jaillissait une nouvelle question suivie d'une réponse qui ne se laissait jamais attendre.
C'est alors seulement que je pus me convaincre que ma soutane n'avait pas été sans piquer la curiosité de mes hôtes, car à leur question 'd'où je venais', Thomas put leur répondre 'd'au-delà de la Grande-Eau'. L'entretien fut peu long: nos sauvages avaient quelque chose de plus important à faire en ce moment. L'un d'eux plonge sa main dans sa poche et je le vois en sortir une pipe: elle n'était pas le calumet légendaire des grandes cérémonies; j'avais sous les yeux une petite pipe rouge, assez bien façonnée, mais qui me frappa assez peu, toutefois il n'en fut pas ainsi pour Thomas; il reconnut, dans cette pipe, un objet de grande valeur, et il aurait donné beaucoup pour en devenir l'heureux propriétaire. Il paraît que cette pipe était due à l'industrie des sauvages, elle aurait été ciselée dans une belle pierre rouge, très rare dans le pays, puis polie avec un soin extrême, à vrai dire cette pipe me parut reluire comme un beau marbre fin.
À peine le sauvage a-t-il sorti sa pipe, que je le vois la remplir de tabac, puis l'allumer, et aussi vite la porter à la bouche; il en tire gravement trois bouffées de fumée. À ce moment il me regarde vivement, réfléchit une seconde, avec beaucoup de force, apparemment; puis tout d'un coup se retourne vivement vers Thomas, lui tend la pipe; et celui-ci en tire trois bouffées avec la solennité de son devancier. C'est alors le tour du deuxième sauvage qui en fait autant, la pipe revient ensuite entre les mains de son propriétaire pour de là continuer la série des mêmes tournées jusqu'à complète extinction. C'était pourtant la pipe de la fraternité, qui se fumait là, suivant les règles: toutefois le sauvage n'osa pas me la présenter; il comprit que sa politesse à lui pouvait être tout autre chose pour moi; et le lecteur peut le croire, il le comprit vivement. Je crois que bien des blancs n'auraient pas compris ni si bien, ni si vite, qu'il faut parfois savoir se raisonner les idées reçues.
Cela fait, nos deux sauvages se lèvent d'un bond, enveloppent plusieurs fois leur cou de leur long châle noir, et, sans plus de cérémonie, prennent bonnement la porte, nous annonçant la visite probable de leurs deux femmes. Ils avaient dû les laisser en arrière, pour marcher plus vite, et arriver ce même jour à la réserve de Pipestone (pipe de pierre), au milieu de leurs parents sauvages. Je suivis mes hommes du regard; ils n'avaient qu'un cheval à eux deux. L'un des hommes le monta, tandis que l'autre se mit à marcher à côté: naturellement, de temps en temps les rôles devaient changer. Bientôt nos deux sauvages eurent disparu à nos yeux sur la plaine couverte d'une légère couche de neige. J'attendis vainement tout l'après-dîner les deux femmes annoncées. Elles ne vinrent pas, elles durent prendre une autre direction, un peu plus à l'ouest. Il est inutile de supposer que ces femmes se perdirent: jamais un sauvage ne s'est perdu dans la prairie: l'Indien la connaît mieux que le paysan ne connaît les rues de son village.
Ce premier hiver je fus réellement chanceux du côté des sauvages, car 15 jours plus tard, un heureux hasard me remettait face à face avec un Indien. Voici comment. Un matin de très bonne heure, le soleil n'étant pas encore levé, mon domestique venait de sortir, pour donner leur ration aux bêtes de mon étable: il rentre tout à coup vivement et m'annonce, essouflé, qu'un sauvage au petit trot. En effet, presque au même moment, j'entends la première porte s'ouvrir; j'attends ensuite que la deuxième s'ouvre à son tour; j'attends vainement. Dix secondes plus tard, la première porte se referme et, au même instant, je vois par la fenêtre mon sauvage qui continue son chemin. Fortement intrigué, je me précipite vers la porte, pour mieux me rendre compte de ce qui s'est passé; mais en passant par ma chambre-chapelle, je constate que les deux uniques chandeliers de mon autel sont disparus. Point de doute, c'est ce sauvage qui me les a volés, et voilà pourquoi il se sauve si vite. Je n'étais ni habillé, ni surtout chaussé pour courir dans la neige, n'importe je me précipite comme je suis. À la porte je ramasse en courant un gros gourdin, et me voilà commençant une course homérique, sus au sauvage, mais je n'ai pas fait vingt pas que la réflexion venant, je me dis que je fais là une chose insensée. Ce sauvage qui court devant moi est mon voleur, ou bien il ne l'est pas: s'il est mon voleur pourquoi m'attendrait-il? il a cheval et traîneau, c'est-à-dire tout ce qu'il faut pour me distancer facilement. Au surplus il doit avoir un fusil tout chargé avec lui, rien de plus facile pour lui de m'envoyer une balle à distance. S'il n'est pas voleur, et s'il veut bien ensuite m'attendre, je vais être ridiculement embarrassé tout à l'heure, et je me serai donné en plus une peine bien inutile. Pourtant, je m'étais si bien lancé, que je me dis: Eh bien, tant pis! Courons quand même. Au fond, je voulais jouir du pittoresque de la chose, et donner à mon domestique, trop peureux, une bonne leçon de courage. Pendant tout ce temps, mon sauvage, voulant sans doute se réchauffer les pieds, courait toujours à côté de son cheval, ne se doutant nullement que quelqu'un courait après lui. Cela eût pu durer longtemps de la sorte. Fort heureusement, voilà que par hasard mon sauvage jette un regard en arrière; il me voit. Aussitôt je lui fais un grand signe d'arrêter; il comprend à merveille; il s'arrête immédiatement avec son cheval et son traîneau. La chose devenait claire, il n'était pas coupable. Maintenant je n'ai plus qu'une pensée: comment me tirerai-je de mon coup de tête, sans paraître trop ridicule à ce sauvage? Et tout en pensant à cela, voilà que j'arrive à mon homme. Ma course insensée paraît l'intriguer fortement. Je me place bien en face de lui, et voilà que je commence devant ses yeux grands ouverts une mimique incroyable. Ne trouvant rien de mieux, je dessine dans l'air, avec mon doigt, une forme de chandelier, et pour être bien compris, je décris de même une forme de bougie, et afin que rien ne manque à la description, je fais le mouvement spécial pour la mise d'une bougie dans un chandelier; je complète le tout, par le simulacre d'une allumette qu'on allume et que l'on porte ensuite au haut de la bougie qu'on veut allumer. Comme mimique, c'était superbe et j'etais tout fier de mon succès, par-devers moi; mais mon sauvage qui probablement n'avait jamais vu un chandelier, n'y comprit absolument rien. À un moment donné, il pousse une exclamation bisyllabique, voulant sans doute dire que nous ne pouvions pas nous entendre. Là-dessus je lui indiquai du geste que notre entrevue était finie. Il ne se le fit pas dire deux fois, une seconde plus tard il reprenait son trot à côté de son traîneau; et moi, tout heureux de mon demi-succès, je reprenais fièrement le chemin de ma maison. Je rencontrai en route mon domestique, qui se hâtait lentement, je lui souris avec une légère malice. Quant à lui, voyant le sauvage déjà très loin, il rentra au logis pleinement rassuré!
Restait pourtant à éclaircir le mystère de mes chandeliers disparus. En regardant bien, je les trouvai renversés derrière le gradin de l'autel. Comment la chose s'était-elle faite? Je suis encore à me le demander; et ne trouvant pas d'autre explication, j'ai toujours remis l'exploit sur le compte de mon chat. Je ne le punis point cependant; comment aurais-je pu le faire? Il m'avait procuré, si à point, un quart d'heure d'un pittoresque achevé.
Quelques jours après, la note comique le cédait aux choses graves: j'étais appelé auprès d'un pauvre père de famille; c'était un métis, jeune encore mais à l'extrémité, que je devais préparer à la mort. Cela m'impressionnait d'autant plus, que c'était la première fois que j'avais à exercer ce lugubre ministère. Je confessai ce brave métis, lui adressai, de mon mieux, les douces paroles de consolation et de sainte espérance. Il reçut en même temps le Saint-Viatique et l'Extrême-Onction, dans des sentiments admirables de foi vive et d'ardente piété. Rentré chez moi, j'attendis ensuite, d'heure en heure, l'annonce de sa mort. Quelques jours se passent ainsi, quand un soir, vers minuit, quelqu'un vient frapper à ma porte. Ce soir-là nous avions fait le levain, et, comme il faisait froid, il nous fallait entretenir un feu continuel, de peur que le levain ne vînt à geler dans le pétrin. Je m'étais chargé de ce soin; comme le nouvel-an était proche, je profitais du temps libre pour écrire mes nombreuses lettres. Vers minuit, après avoir bien attisé le feu, vaincu par le sommeil, je me jetai, pour un instant, tout habillé, sur mon lit. J'en étais là, quand soudain quelqu'un frappe à ma porte, et, presque aussitôt, je vis entrer un grand et solide jeune homme. C'était Gaspard Lafontaine qui venait me dire que le malade me demandait. A l'instant je suis debout; j'ai vite revêtu mes vêtements d'hiver. D'un bond me voilà en voiture, et aussitôt nous partons au grand trot. Un vent très piquant vient nous glacer la figure. Peu importe! Nous nous couvrons de notre mieux, et nous ne nous portons pas plus mal, quand un quart d'heure plus tard, nous arrivons chez le malade. Grand est mon étonnement de voir à cette heure la vaste chambre bondée de monde. Je vois là unis le père et la mère du malade, ses frères, ses soeurs, son beau-père, sa belle-mère, des beaux-frères, des oncles, des tantes, des cousins, des cousines; presque tous les métis de l'endroit sont là s'acquittant du devoir de la veillée charitable.
Le lit du malade est placé dans un coin de la chambre, et sa femme tient la place du devoir à son chevet. À ce moment, elle se lève respectueusement: c'est à mon tour, de me tenir auprès de mon pauvre James! Pensant qu'il lui reste quelques scrupules de conscience, je lui demande avec douceur s'il voudrait se confesser encore une fois. 'Non, me répond-il de sa voix défaillante mais paisible; seulement j'aime que vous soyez ici.' Ces paroles de foi vive me ravissent et les paroles du Christ: 'En vérité, je vous le dis, je n'ai point rencontré une telle foi dans Israël', me reviennent spontanément à l'esprit, et pendant que je m'humilie en moi-même, je cherche de mon mieux à me mettre à la hauteur de l'auguste circonstance; car elle est grande en tout temps la valeur d'une âme, mais elle est surtout grande au moment de la mort! Cette âme fut-elle celle d'un pauvre métis, que l'univers ignore et qu'il ignorera toujours. Pour Dieu, elles n'existent pas ces différences boiteuses que les hommes insensés et aveugles ne peuvent s'empêcher de voir, malgré tous les démentis, malgré l'épouvantable anéantissement du tombeau!
Ces réflexions venaient en foule à mon esprit, en ce moment solennel, et doucement penché sur le malade je lui redisais les bonnes paroles de soumission à Dieu, et de consolation dans la foi et la sainte charité du Christ.
Après cela je voulus réciter les prières des agonisants: tout le monde s'était précipité à genoux, et pendant que je priais, je voyais les yeux du malade s'illuminer d'espérance et de bonheur.
Deux heures du matin sonnèrent au moment où je finissais; j'étais en droit de m'en retourner, mais le spectacle que j'avais sous les yeux était pour moi si nouveau et si beau, que je voulus en profiter plus longtemps. J'engageai donc une conversation appropriée à la circonstance; j'espérais que tous y prendraient part: c'eût été délicieux comme étude des moeurs. Mes calculs échouèrent: le respect et la crainte arrêtaient leurs paroles prêtes à sortir de la bouche; devant moi ils refoulaient en eux-mêmes leurs pensées, leurs sentiments et leurs impressions.
Vers 5 heures, j'invitai tout ce monde à la récitation du chapelet. Tous se précipitèrent à genoux; pour moi, je dirigeais la prière et eux me répondaient avec une simplicité et une foi incroyables.
Quand la prière fut terminée, j'attendis encore quelque temps que quelqu'un me donnât l'exemple du départ, mais pas une des 30 personnes, qui se trouvaient là, ne bougea. Après quelques bonnes paroles adressées au malade, je me décidai donc à partir le premier. On voulut me reconduire en voiture, on insista même; mais je refusai absolument, et je gagnai ma maison à pied, vers 6 heures du matin, tout heureux d'une veillée fatigante, il est vrai, mais toute remplie des plus douces émotions.
Quatre jours plus tard, James avait doucement quitté cette terre, et, chose étrange, c'était la phtisie qui tuait cet enfant des prairies.
Aussitôt les apprêts mortuaires commencent; on vient me demander des cierges bénis. Je n'en ai pas, mais je bénis quelques bougies que je donne avec les deux uniques chandeliers de l'autel. Dans la journée, je m'acquitte du devoir de la visite mortuaire. Le mort est sur son lit, complètement couvert d'une tenture noire qu'encadre un ruban blanc du plus bel effet. A côté du lit, contre la muraille, pend une autre tenture noire qui porte au milieu un crucifix noir et cuivre. Cette décoration funèbre produit un effet saisissant.
Au milieu de la chambre, un grand feu pétille dans un énorme fourneau de cuisine, et autour de la chambre se tiennent assis les parents et amis du défunt, plus de 20 personnes.
Une grave question est à résoudre. Où sera inhumé le défunt. Grande-Clairière n'a encore ni église, ni cimetière. James sera-t-il enterré ici ou conduit au cimetière d'Oak Lake, à 34 kilomètres de distance? Après une mûre délibération, le père et le beau-père du défunt viennent me donner leur décision: James sera inhumé à Grande-Clairière. Je conduis alors les deux hommes vers la place de l'église projetée, et où s'aligneront plus tard les tombes des morts. Ils choisissent une place, et, un peu plus tard, un ami y vient creuser une fosse. Le lendemain matin une longue file de traîneaux quittent la maison mortuaire, on les voit s'avancer lentement dans la plaine: les voici maintenant qui s'arrêtent devant notre chambre-chapelle. Le premier traîneau porte le cercueil, et c'est le propre père du défunt qui tient les guides des chevaux. Les autres traîneaux amènent la multitude des parents et amis. La porte de la chambre-chapelle s'ouvre; on y introduit le cercueil que l'on place devant l'autel. Je le bénis, je chante l'hymne Subvenite, puis la messe. N'ayant encore ni chantres, ni servants de messe, je suis forcé de me suffire tout seul.
La messe est finie, je dépose ma chasuble sur l'autel, puis me retourne vers le cercueil, sur lequel je chante le 'Libera me, Domine', dont les accents inspirés me frappent alors comme jamais cela m'est arrivé. Les dernières prières dites en face de l'autel, nous prenons tous ensemble le chemin de la tombe; je bénis la fosse, le cercueil y est descendu, je récite les dernières prières, je bénis une dernière fois le cher défunt. Puis tous, parents et amis, me suivent pour rendre à leur tour leurs derniers devoirs. Une heure plus tard la tombe était comblée et sur le petit tertre une croix de bois était plantée qui annonçait aux passants qu'un chrétien reposait là. Neuf années se sont écoulées depuis, et déjà 75 autres croix sont rangées autour de la première. Oh! comme la mort fait vite sa moisson!
Quelques jours plus tard nous célébrions Noël. Il faisait froid la nuit de la veillée; mais les 22 degrés de froid n'arrêtèrent aucun de mes métis: tous se trouvèrent réunis pour l'office de minuit. Quinze voulurent se confesser et communier. Oh! qu'elle fut simple mais délicieuse, cette soirée de Noël! Quelles espérances elle évoqua! À la même place, un an auparavant, se trouvait le désert; pas une âme n'était là, et moins d'une année après, douze familles s'y trouvaient réunies, heureuses et contentes, entourant l'autel, chantant, puis chantant encore les vieux noëls de France, que les métis avaient appris autrefois de la bouche même de leurs premiers missionnaires.
Thomas Breland eut l'heureuse idée de chanter le cantique si populaire 'Il est né...' et traduit en langue sauvage avec la mélodie bien connue. Thomas n'eut pas plus tôt entonné son cantique, qu'un vrai enthousiasme s'empara de l'assistance; tous s'en mêlèrent, hommes, femmes et enfants s'unirent dans une harmonie dure, sans doute, mais véritablement entraînante.
Tel fut le premier Noël célébré à Grande-Clairière; plusieurs autres ont suivi, plus illuminés, plus célébrés, mais aucun n'a renouvelé les suaves émotions du premier. Les quatre luminaires qui éclairèrent cette nuit me parurent plus imposants dans leur pauvreté que mille clartés.
Le dimanche suivant, deux jeunes métis faisaient leur première communion devant les paroissiens ravis. Et aussitôt commençaient les apprêts du nouvel-an, la grande fête profane de nos Canadiens français et de nos métis.
Jusqu'au premier janvier, chaque beau jour, – et ils avaient été nombreux ce premier hiver, – je n'avais pas manqué de faire quelque bonne excursion à travers la prairie, tantôt dans un sens, et tantôt dans un autre. Je voulais ainsi reconnaître les bons lots, un peu partout, afin de pouvoir les indiquer l'été suivant aux courageux colons que nous attendions nombreux de France et de Belgique. Ces courses, que je faisais à pied, tantôt à travers les foins, les joncs et les roseaux séchés debout, tantôt sur les étangs glacés, tantôt à travers les taillis et les bosquets, ces courses, dis-je, m'étaient devenues à ce point agréables, qu'à la fin j'y allais, non seulement par devoir, mais encore par goût et par entraînement. Je chaussais alors une chaussure en cuir mou, spéciale au pays, je marchais ainsi d'un pas alerte; et c'était pour moi un plaisir incroyable de fouler la couche de neige fine et friable, épaisse seulement de un ou deux centimètres.
Le 31 décembre, je faisais pour la trentième fois une de ces séduisantes excursions. Le temps était si beau et mon ardeur si grande, que je me surpassai de beaucoup, ce jour-là. Il était tard quand je m'aperçus que le soleil baissait fortement à l'occident. Je pressai aussitôt le retour. Mais à la tombée de la nuit, j'étais seulement en vue de la maison de Jean Léveillé. Il me restait encore huit kilomètres à franchir pour rentrer au logis. La vue de cette maison, qui m'était bien connue, et dont le toit fumant annonçait l'hospitalité, fit jaillir en moi une idée. Allons là, me dis-je; quelle vive et douce surprise je vais procurer à ces braves gens! J'ai vite franchi les quelques buttes de sable et les quelques fourrés qui me séparent de la maison. On ne m'attendait pas, surtout à cette heure. L'émoi est immense. On court appeler M. Léveillé qui était encore à ses étables, et aussitôt il arrive. M. Léveillé est un métis d'une stature superbe, chose du reste assez ordinaire chez les gens de sa race; il mesure 6 pieds de haut, et est large en proportion; sa femme, elle aussi, est remarquablement grande et forte. Autour d'eux s'agite tout un petit monde alerte de dix enfants, dont l'aînée compte seulement 16 années révolues. Le rez-de-chaussée de la maison comprend deux chambres. La première, celle où je viens d'entrer, est la chambre commune. On y fait la cuisine et on y mange. Un peu plus loin, vers le fond, est une chambre-salon au coin de laquelle un lit est placé. Cette chambre est très proprette; on y voit un canapé, des fauteuils, des chaises et une table ronde, le tout du plus bel effet. C'est là qu'on introduit les visiteurs quand on veut les soustraire au va-et-vient continuel de la nombreuse famille. C'est là que M. Léveillé m'introduit aussitôt. Tout en causant, nous prenons place près du feu que déjà l'on a vigoureusement attisé et que l'on entend brûler à ravir. Nous causons tranquillement, et pour mon compte, je ne suis à la conversation qu'à moitié. Par la porte de la chambre entr'ouverte, je suis du coin de l'oeil le mouvement de la cuisine. Mme Léveillé et son aînée s'y agitent fiévreusement. Je vois dans un coin un énorme quartier de boeuf qui pend là pour la fête du lendemain. Vous avez bien lu, lecteur, il s'agit d'un quartier de 180 livres. Ici les repas homériques sont encore de mode, l'ère des grands buffalos n'est pas bien éloignée; et pour le moment encore, il est si facile d'élever de grands troupeaux de boeufs, sans qu'il n'en coûte rien pour l'entretien; il suffit de les laisser croître et se multiplier. Assurément ni le pain ni la viande ne manquent dans nos plaines, et longtemps encore il en sera ainsi.
Cependant Mme Léveillé s'est attaquée au quartier de boeuf. Je vois d'énormes tranches s'en détacher; on les rapproche dans la marmite et je les entends frire. Je vois les armoires s'ouvrir et toutes les douceurs imaginables en sortir. La table se dresse; une vaisselle éclatante s'y entasse; tout est prêt. Une douce enfant, la figure épanouie, vient nous le dire en langue cry, la langue maternelle des métis. M. Léveillé me le répète en français. Nous nous levons, et maintenant nous voilà à table. Deux couverts seulement ont été mis; celui du maître de la maison et le mien. Nous mangerons seuls. Ainsi le veut un certain respect mêlé d'une certaine timidité. Je regrette beaucoup cette réserve sévère devant moi, et pourtant il me faut la subir.
Je venais de faire à pied une course de plus de douze kilomètres à travers la prairie, les bois, les broussailles et des dunes, et parfois par des terrains littéralement couverts de troncs d'arbre et de branches desséchées. Rien n'avait manqué pour aiguiser mon appétit. Nous ouvrons le repas par des boules de viandes hachées, grosses comme des boules de billard, et baignant à peine leur pied dans un peu de sauce. Tout en mangeant, je suis curieux de connaître le nom de ce plat, nouveau pour moi, et mon hôte avec un fin sourire me le nomme une soupe de métis. Après cela, voici venir tout d'abord d'excellents pruneaux, cuits dans leur jus, puis pommes, cuites en purée, puis du riz, cuit avec un mélange de raisins de Corynthe, c'est le plum-pudding des Anglais, avec cela un pain excellent, des beignets et l'assiette au beurre: le tout en abondance. Notre boisson est invariablement le thé, mais un thé de premier choix, bien sucré, proprement servi, avec du lait bien pur et bien frais.
Vraiment mon vigoureux appétit était plus que satisfait. Je me lève de table songeant déjà à payer en compliments le tribut de ma reconnaissance, quand Madame Léveillé, presque les larmes aux yeux, se confond en excuses pour m'avoir si mal reçu; elle invoque, il est vrai, la circonstance atténuante pour elle, de ma visite absolument subite et imprévue. Je réponds par des dénégations, qui paraissent contenter fort le légitime amour-propre de mon hôtesse.
Cela fait M. Léveillé et moi nous allons nous asseoir au coin du feu, et reprenons un 'petit brin' de conversation. Mais à ce moment j'entends un branle-bas formidable. Ce sont nos dix enfants, qui viennent de prendre la table d'assaut; et les voilà qui se servent à qui mieux mieux.
Je mets un plaisir extrême à contempler cet entrain charmant, et ces moeurs si patriarcales par tant de côtés. Mais déjà il se fait tard, il me faut rentrer. Je me lève pour partir, mais aussitôt l'on me dit d'attendre un instant. Deux jeunes gens courent à l'étable, d'où ils amènent en un clin d'oeil deux des meilleurs coureurs. Ils sont attelés à l'instant à un vrai bijou de voiture, pendant que M. Léveillé revêt ses habits de fourrures. Tout est prêt. Je donne des poignées de main à tout le monde, suivant l'habitude du pays, et d'un bond nous voilà en voiture, M. Léveillé et moi. Nous partons au grand trot. Il fait un temps superbe, le ciel est incomparable, les étoiles brillent de mille feux, sur un fond bleu transparent. Sur la terre il fait un froid de -8 centigrades; mais si sec, si velouté, qu'on le sent à peine. Vingt-cinq minutes plus tard, huit kilomètres étaient parcourus. Je descendais de voiture, et M. Léveillé, après m'avoir remercié pour le plaisir et l'honneur que je venais de lui faire, s'en retournait au grand trot de ses chevaux.
Huit heures du soir sont sonnées, quand je rentre chez moi. Je suis ravi, et en même temps, je puis le dire, fatigué, je n'ai qu'une pensée, celle d'aller me reposer au plus tôt. Mais je n'ai pas compté avec mon plus proche voisin. À la tombée de la nuit, mon bon Thomas Breland est venu chez moi et il a dit bonnement à mon domestique, qu'il nous attendait tous deux sans faute pour souper avec lui. Mon premier mot est un non bien motivé; puis je me ravise. Puis-je chagriner ainsi Thomas le 1er jour de l'an? Sans doute, je viens de manger pour un mois; mais ce soir même, ne puis-je pas souper sans souper? Et sans même m'être assis, nous partons aussitôt. Dix minutes plus tard nous entrions chez Thomas.
Toute la maison est dans un ordre parfait: une nappe d'une blancheur de neige couvre la table. Sur cette nappe sont rangées des assiettes et des tasses blanches, très ordinaires, mais éclatantes de propreté. Les cuillères, les fourchettes et les couteaux brillent du plus bel éclat métallique. L'assiette au beurre, les confitures, les gâteaux sont disposés là avec ordre et en abondance, au centre se trouve le morceau principal, une belle langue de boeuf froide, appétissante sur son plat long. À cette vue, je sens mon appétit presque revenir. Je commence par expliquer à Thomas, que je viens de souper copieusement chez son beau-frère, Jean Léveillé. Mais je m'aperçois que Thomas veut être sourd ce soir. Il commence par apporter avec une certaine appréhension le flacon illicite. Que faire? Dois-je refuser? Dois-je accepter ce whiskey qui m'est offert? Refuser, ce sera humilier mon hôte; accepter, ce sera en quelque sorte autoriser ces horribles excès, auxquels se livrent les hommes du Nord, une fois qu'ils ont goûté à la terrible liqueur.
Mon parti est vite pris; je prends ma tasse, et j'y laisse couler quelques gouttes d'alcool. De cette façon je n'humilie personne, et du même coup, je donne une bonne leçon de modération. Thomas et mon domestique s'en servent plus généreusement. Nous avons alors soin de trinquer comme de bons Français; puis mes hommes boivent d'un trait: c'est de règle absolue ici, paraît-il.
Cela fait, nous nous mettons à table. Breland, mon domestique et moi, Mme Breland, une sauvagesse pur sang, nous sert, et ses trois enfants nous regardent. Je présume qu'ils ont déjà soupé. Nous commençons par l'appétissante langue de boeuf, et nous continuons par les délicates friandises. Pour moi, ma décision est bien prise: je toucherai à peine à tout cela. Mais mon hôte malin me prend par surprise, et tranches de gâteaux glacés, morceaux de tarte, petits gâteaux secs, beignets de toutes sortes: tout cela tombe dru dans mon assiette, et avec une rapidité telle, que je ne puis rien éviter. Je m'exécute, et j'admire ce bon Thomas, qui, malgré sa pauvreté, a su se procurer cette abondance du nouvel an. Mais je parierais fort qu'il ne lui reste plus un seul centin dans sa poche.
Après le repas, nous allons nous asseoir auprès du feu, un vrai feu des grandes solennités; et pendant que la maîtresse mange avec ses trois enfants, nous engageons une conversation douce et intime. Je raconte mes premières impressions, en arrivant au pays, et je dis avec quelle bienveillance je fus accueilli, il y a 5 mois, dans le même logement où nous sommes maintenant réunis. À ce moment, Thomas s'émeut et il me dit avec coeur, qu'il n'oubliera jamais que je lui ai fait l'honneur de descendre chez lui, et que je n'ai pas méprisé sa pauvreté. Oh! que voilà bien le métis avec sa touchante sensibilité et sa noble fierté!
Et dire que ce pauvre Thomas aurait pu être riche... Son père, qui a été durant de nombreuses années membre du parlement de Régina, ne possède guère moins de 250,000 francs de fortune. Et ce père très bon n'a cessé d'aider ses enfants. Mais Thomas est si bon, si franchement métis, qu'il n'a jamais voulu se conserver un centin. Il a pour toute fortune sa pauvre cabane et son homestead, qu'il ne cultive pas, qu'il ne cultivera probablement jamais.
Quelques patates (pommes de terre), quelques oignons, quelques choux de Siam lui suffisent. Quand la nécessité l'y oblige, il va travailler quelques jours, gagne vite son argent, et le voilà ensuite heureux pour un mois. Ah! si la prairie pouvait rester déserte, comme les métis vivraient heureux! Mais le désert se peuple, et la lutte pour la vie a commencé pour le pauvre peuple métis.
Telle fut ma première veillée de nouvel an dans la prairie. Je dois maintenant raconter comment nos métis passèrent entre eux la grande fête du lendemain. O muse! prête-moi ton puissant appui!
Les métis se souhaitent le nouvel an avec force démonstrations. Dès l'aurore du grand jour les familles s'ébranlent: hommes, femmes, enfants, tous partent emportés dans des traîneaux. Chaudement habillés, couverts de fourrures de toutes sortes, les pieds et les jambes bien gardés par de chaudes couvertures, rien ne les arrête: ni les froids rigoureux, ni les épouvantables 'poudreries'. Leur élan est supérieur et irrésistible à tout.
Ce sont les inférieurs qui s'ébranlent les premiers: ils vont en bon ordre saluer les anciens, et ceux-ci ne manquent jamais de leur rendre leur visite. En s'abordant, les hommes se serrent la main et les femmes s'embrassent. Une femme qui refuserait ce jour-là l'accolade à une autre femme, lui ferait un sanglant affront: une réparation solennelle deviendrait nécessaire. Ce jour-là les haines doivent tomber, c'est le jour du grand pardon. On verra le lendemain si l'on doit les reprendre.
Les politesses échangées, l'on se met à table avec ardeur. Le jour de l'an, dans chaque maison, le festin est en permanence; les tables sont continuellement couvertes d'aliments succulents, et de boissons séductrices. Le communisme le plus réel règne alors: le riche donne plus, le pauvre moins, tout en donnant pourtant, comme s'il était très riche. La quantité de choses que font dévorer ces festins, est incroyable. Si 50 familles vivent dans une même localité, c'est en somme 50 bons repas que chaque individu devra faire. Et qui pourra nombrer tous les 'filets' de whiskey, qui s'y boivent? Ce ne sera pas moi, assurément. Le riche se procure assez facilement l'énorme substance de ces festins, le pauvre ne le peut sans recourir aux grands moyens. Il vendra sa dernière vache, sa charrue, son crible, n'importe quoi; s'il le faut absolument, il hypothéquera ce bon poney, l'inséparable compagnon de ses courses. Et quand l'argent de la vente ou de l'hypothèque sera dans sa main, il ira l'échanger tout droit contre ces douces choses, qui font la joie du jour de l'an.
Oh! qu'elle fut animée la solitude de Grande-Clairière le premier de l'an 1889! Le temps se mit de la partie: une splendide aurore éclaira les plus pressés, puis le soleil vint briller comme il sait briller ici. Le ciel était diapha