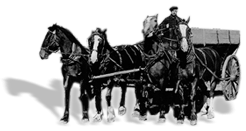Revue historique: volume 5 numéro 1
Les chômeurs itinérants
par Roland Piché
Vol. 5 - no 1, octobre 1994
Vol. 5 - no 1, octobre 1994
C’est aujourd’hui le 4 août 1933. Deux étrangers interrogent les passants sur le trottoir.
— Pardon, Monsieur! On se cherche une job. Connaissez-vous quelqu’un qui a besoin d’hommes pour travailler dans les champs?
Plusieurs répondent qu’ils n’ont pas rencontré de gens qui désiraient embaucher. Enfin, un monsieur Roy leur dit de s’informer auprès du maire. Il en connaîtrait peut-être.
Ils se rendent donc chez le maire. Il est dix heures. Monsieur le maire termine la lecture du journal du jour qui annonce encore un taux de chômage élevé. Tout à coup, on sonne à la porte.
— Voyons! Qui est-ce? chuchote le maire à son épouse. Il ouvre la porte et aperçoit deux individus habillés pauvrement. L’un porte des salopettes bleues, sales et est coiffé d’une casquette à palette, l’autre porte des vêtements de travail et un béret malpropres et troués.
— Bonjour. Que puis-je faire pour vous?
— On vient d’arriver sur le train qui mène ici. On est du Québec. Ça fait trois jours qu’on voyage dans un wagon avec une dizaine d’hommes, eux aussi chômeurs. On a mangé des sandwichs de beurre de peanut et bu un peu d’eau tiède. On a bien faim, monsieur le maire. Pourriez-vous nous donner un peu à manger? Quelques croûtes de pain et un fruit? Seulement pour la journée, monsieur le maire. On va essayer de se trouver une job dès aujourd’hui.
— Venez à la cuisine. Je crois que mon épouse trouvera bien quelque chose.
Les deux aventuriers suivent le maire. Après les introductions sommaires d’usage, son épouse, du nom de Justine, met le couvert et place sur la table quelques tranches de mortadelle (baloney), une miche de pain, deux verres de lait et un peu de compote de pommes.
Justine, pour faire conversation, leur pose quelques questions :
— Comment vous appelez-vous?
— Je m’appelle Jean-Luc Paradis, dit l’un.
— Et moi, Joseph Racicot, dit l’autre.
— De quelle ville ou de quel village venez-vous?
— Joseph vient de Saint-Ursule et moi de Saint-Lambert de la province de Québec, de répondre Jean-Luc. (Il continue dans le langage de sa région.) Il n’y a pas moyen de trouver une job chez-nous. On est tous les deux manoeuvres et on a pensé que ce serait plus facile de se trouver une job dans l’ouest. Mais je crois qu’on s’est trompé. Apparemment, il n’y a personne qui a besoin de gars comme nous autres. On ne parle pas l’anglais. C’est pour ça que, lorsqu’on a entendu dire qu’à Gravelbourg, les gens parlaient français, on a décidé de venir ici. Parce qu’on n’a pas d’argent, on s’est vu obligé de voyager sur wagons. On a ramassé notre p’tit bagage et puis on a embarqué ensemble à Saint-Ursule dans un char à grain.
— Mais où et sur quoi couchiez-vous?
— Il y avait un peu de paille sur le plancher du char et puis on s’était apporté une petite couverture. Le long de la route, d’autres gars sont entrés dans le char avec nous autres. Je vous assure que je les ai surveillés. On n’en menait pas large. On ne les connaît pas et eux non plus ne nous connaissent pas. On ne sait pas à qui on a affaire. Est-ce que c’est du monde fiable? Est-ce qu’on a affaire à des voleurs? On se regarde les uns les autres du coin de l’oeil. Chacun se tasse dans son coin.
On mange les quelques sandwiches de beurre de peanut qu’on s’est apportés. On n’a pas pu en apporter plus; on n’a pas de valises. Tout au plus, une poche, avec un peu de linge et quelques sandwiches. On se demande si c’est une bonne idée de partir comme ça avec si peu.
Puis, il n’y a pas de lumière dans le char. On ne pouvait pas se permettre d’apporter une lampe de poche. On laisse donc la porte entr’ouverte. Après le coucher du soleil, on sait qu’il y a d’autres personnes mais, on ne sait pas qui elles sont et où elles sont installées. Ils peuvent nous frapper sur la
margoulette et on ne s’en apercevrait même pas. Ils peuvent tout nous prendre même si ce n’est pas grand’chose. On croise nos bras sur notre sac. En tout cas, le premier soir, il n’y a pas trop de complications et c’est assez tranquille. Je suppose qu’ils sont tous aussi énervés, peureux et fatigués que nous autres.
— Vous avez quand même dormi, je suppose?
— Monsieur le maire, dit Jean-Luc, moi, je n’ai pas fermé l’oeil de la nuit, et Joseph non plus. Comment voulez-vous qu’on dorme? On ne sait pas qui est assis à côté de nous. À mes côtés, il y a un gros homme avec une moustache. Il me donne la frousse. Je me déplace et je vais de l’autre côté du char. Joseph se place à côté de moi. Je me sens déjà plus en sécurité. Il y en a qui gueulent et font du bruit toute la nuit. On se rend finalement à Sudbury sans trop de chamailleries.
Et Joseph continue le récit du voyage.
— Vous savez, Monsieur le maire, dit Joseph, si ce sont là tous les problèmes qu’on a, on peut dire que le voyage se fait sans trop de misère. Il y a quand même des inconvénients sérieux ... Qu’est-ce qu’on fait, par exemple, quand on est pris avec sept ou huit autres personnes dans un espace où il n’y a pas de toilettes? Ensuite, comment faire pour se raser alors qu’il n’y a pas d’eau dans le char? J’essaye de me faire la barbe lorsqu’on s’arrête. Mais il n’y a pas d’eau chaude et je me coupe la figure à trois endroits.
Évidemment, Joseph se laisse impressionner par ces péripéties du voyage et avec raison! Il ne cesse de répéter : J’ai mon voyage! J’ai mon voyage!
Il continue.
— À Sudbury, on sort du wagon pour se dégourdir et respirer un peu d’air frais! Les gens du train sympathisent avec nous autres et nous offrent des fruits, mais ne s’occupent guère de nous. On comprend pourquoi. La mine que nous avons n’est guère rassurante. Plusieurs tentent de se débarbouiller et de se raser. Mais impossible de faire quoi que ce soit avec les cheveux qui restent nattés et sales.
Les conversations d’hommes que la misère a unies s’engagent ou continuent. D’aucuns parlent de leur région d’origine, leur dernière job, leur mise à pied, leurs parents, d’autres des jobs qui les attendent dans l’Ouest. La plupart d’entre eux sont du Québec ou de l’Ontario. Les gens de l’Ontario parlent l’anglais uniquement. Mais chacun a fini par se présenter et tous se connaissent au moins de nom.
—Aviez-vous des activités quelconques pour vous divertir ou pour passer le temps? demande le maire. Jean-Luc lui répond :
— Il y en a qui ont des cartes. Le jour on joue à des jeux bien simples comme, par exemple, la poule, le whist et le 21. Et, tout en jouant, on pose des questions. Les réponses que nous donnent nos compagnons nous renseignent sur eux. Il y en a qui ont quelques cennes et qui jouent au poker. D’autres ont des p’tits instruments de musique, une flûte ou une musique à bouche. Il y en a même un qui a une petite guitare. Les musiciens pratiquent pendant des heures. Ça devient ennuyant. Toujours les mêmes ritournelles! Et puis, il y en a qui n’ont pas d’instruments mais des bonnes voix. On organise des p’tits concerts. Joseph est bon pour chanter «Alouette, gentille alouette». Les Anglais connaissent une chanson qui s’appelle «You are My Sunshine» qu’ils répètent sans cesse et qu’on a finalement tous appris. Yves nous donne quelques chansons sur sa guitare. Au bout de deux jours, on se connaît suffisamment pour blaguer et se taquiner.
Arrivé à Winnipeg, un groupe nous quitte pour se rendre sur des fermes au sud du Manitoba faire du stookage. On n’est plus que quatre. On se rend jusqu’à Regina. Là, on s’informe où se trouve Gravelbourg et puis on prend le train pour cet endroit-là. C’est comme ça qu’on est rendu ici.
— Il n’y a pas beaucoup de travail ici non plus, leur dit le maire. Toutefois, à ce temps-ci de l’année, le temps des maigres récoltes, les fermiers ont besoin de travailleurs. Je vais tenter de vous mettre en contact avec un fermier qui pourrait vous engager. Dieudonné Piché m’a dit qu’il cherchait deux travailleurs pour le stookage. Vous en avez déjà fait?
— Non, pas du tout!
— Vous voulez vous essayer?
— On a rien à perdre à essayer ça!
— Je vous mets sous l’égide de Dieudonné. Si vous avez des questions, ne vous gênez pas. Posez-les-lui. Je lui téléphone tout de suite.
Le Maire appelle mon père qui accepte de les prendre à la ferme. Il vient les chercher immédiatement. Au début de la récession de 1930, mon père a encore son automobile. En un rien de temps, car la ferme n’est qu’à six milles de Gravelbourg, il est de retour à la maison avec les deux hommes. Il leur offre $2.50 par jour en plus de la pension. Jean-Luc et Joseph acceptent allègrement.
Il est tard quand ils arrivent à la ferme. Après les présentations d’usage aux membres de la famille et le souper, mon père les conduit au fourgon où ils doivent dormir. Le lendemain, très tôt, il les éveille. Ma mère leur offre un copieux déjeuner de gruau, d’oeufs, de bacon et de café. Pendant qu’ils mangent, mon père leur donne quelques informations sur les opérations de la ferme et répond à leurs questions.
— Quelle grandeur a votre terrain?
— Une section.
— C’est combien d’arpents une section?
— Six-cents-quarante acres.
— Chez nous, ça serait une très grosse ferme!
margoulette et on ne s’en apercevrait même pas. Ils peuvent tout nous prendre même si ce n’est pas grand’chose. On croise nos bras sur notre sac. En tout cas, le premier soir, il n’y a pas trop de complications et c’est assez tranquille. Je suppose qu’ils sont tous aussi énervés, peureux et fatigués que nous autres.
— Vous avez quand même dormi, je suppose?
— Monsieur le maire, dit Jean-Luc, moi, je n’ai pas fermé l’oeil de la nuit, et Joseph non plus. Comment voulez-vous qu’on dorme? On ne sait pas qui est assis à côté de nous. À mes côtés, il y a un gros homme avec une moustache. Il me donne la frousse. Je me déplace et je vais de l’autre côté du char. Joseph se place à côté de moi. Je me sens déjà plus en sécurité. Il y en a qui gueulent et font du bruit toute la nuit. On se rend finalement à Sudbury sans trop de chamailleries.
Et Joseph continue le récit du voyage.
— Vous savez, Monsieur le maire, dit Joseph, si ce sont là tous les problèmes qu’on a, on peut dire que le voyage se fait sans trop de misère. Il y a quand même des inconvénients sérieux ... Qu’est-ce qu’on fait, par exemple, quand on est pris avec sept ou huit autres personnes dans un espace où il n’y a pas de toilettes? Ensuite, comment faire pour se raser alors qu’il n’y a pas d’eau dans le char? J’essaye de me faire la barbe lorsqu’on s’arrête. Mais il n’y a pas d’eau chaude et je me coupe la figure à trois endroits.
Évidemment, Joseph se laisse impressionner par ces péripéties du voyage et avec raison! Il ne cesse de répéter : J’ai mon voyage! J’ai mon voyage!
Il continue.
— À Sudbury, on sort du wagon pour se dégourdir et respirer un peu d’air frais! Les gens du train sympathisent avec nous autres et nous offrent des fruits, mais ne s’occupent guère de nous. On comprend pourquoi. La mine que nous avons n’est guère rassurante. Plusieurs tentent de se débarbouiller et de se raser. Mais impossible de faire quoi que ce soit avec les cheveux qui restent nattés et sales.
Les conversations d’hommes que la misère a unies s’engagent ou continuent. D’aucuns parlent de leur région d’origine, leur dernière job, leur mise à pied, leurs parents, d’autres des jobs qui les attendent dans l’Ouest. La plupart d’entre eux sont du Québec ou de l’Ontario. Les gens de l’Ontario parlent l’anglais uniquement. Mais chacun a fini par se présenter et tous se connaissent au moins de nom.
—Aviez-vous des activités quelconques pour vous divertir ou pour passer le temps? demande le maire. Jean-Luc lui répond :
— Il y en a qui ont des cartes. Le jour on joue à des jeux bien simples comme, par exemple, la poule, le whist et le 21. Et, tout en jouant, on pose des questions. Les réponses que nous donnent nos compagnons nous renseignent sur eux. Il y en a qui ont quelques cennes et qui jouent au poker. D’autres ont des p’tits instruments de musique, une flûte ou une musique à bouche. Il y en a même un qui a une petite guitare. Les musiciens pratiquent pendant des heures. Ça devient ennuyant. Toujours les mêmes ritournelles! Et puis, il y en a qui n’ont pas d’instruments mais des bonnes voix. On organise des p’tits concerts. Joseph est bon pour chanter «Alouette, gentille alouette». Les Anglais connaissent une chanson qui s’appelle «You are My Sunshine» qu’ils répètent sans cesse et qu’on a finalement tous appris. Yves nous donne quelques chansons sur sa guitare. Au bout de deux jours, on se connaît suffisamment pour blaguer et se taquiner.
Arrivé à Winnipeg, un groupe nous quitte pour se rendre sur des fermes au sud du Manitoba faire du stookage. On n’est plus que quatre. On se rend jusqu’à Regina. Là, on s’informe où se trouve Gravelbourg et puis on prend le train pour cet endroit-là. C’est comme ça qu’on est rendu ici.
— Il n’y a pas beaucoup de travail ici non plus, leur dit le maire. Toutefois, à ce temps-ci de l’année, le temps des maigres récoltes, les fermiers ont besoin de travailleurs. Je vais tenter de vous mettre en contact avec un fermier qui pourrait vous engager. Dieudonné Piché m’a dit qu’il cherchait deux travailleurs pour le stookage. Vous en avez déjà fait?
— Non, pas du tout!
— Vous voulez vous essayer?
— On a rien à perdre à essayer ça!
— Je vous mets sous l’égide de Dieudonné. Si vous avez des questions, ne vous gênez pas. Posez-les-lui. Je lui téléphone tout de suite.
Le Maire appelle mon père qui accepte de les prendre à la ferme. Il vient les chercher immédiatement. Au début de la récession de 1930, mon père a encore son automobile. En un rien de temps, car la ferme n’est qu’à six milles de Gravelbourg, il est de retour à la maison avec les deux hommes. Il leur offre $2.50 par jour en plus de la pension. Jean-Luc et Joseph acceptent allègrement.
Il est tard quand ils arrivent à la ferme. Après les présentations d’usage aux membres de la famille et le souper, mon père les conduit au fourgon où ils doivent dormir. Le lendemain, très tôt, il les éveille. Ma mère leur offre un copieux déjeuner de gruau, d’oeufs, de bacon et de café. Pendant qu’ils mangent, mon père leur donne quelques informations sur les opérations de la ferme et répond à leurs questions.
— Quelle grandeur a votre terrain?
— Une section.
— C’est combien d’arpents une section?
— Six-cents-quarante acres.
— Chez nous, ça serait une très grosse ferme!
— Combien d’animaux?
— J’ai quinze vaches, dix cochons et vingt-cinq poules.
Mais ils sont venus pour stooker. Il faut donc leur montrer comment faire ce travail. Mon père les conduit dans le champs de blé et leur montre comment grouper 7 à 8 gerbes de blé, en mettre une au centre et faire pencher les autres quelque peu vers le centre, les têtes vers le haut, pour former un cône inversé. Ainsi, s’il pleut, l’eau glissera vers le bas et les têtes sécheront plus vite et ne pourriront pas. Je vous appellerai quand ce sera le temps de dîner.
Ils font donc du stookage, mais ils n’équilibrent pas très bien les gerbes, de telle sorte qu’ils doivent parfois revenir sur leurs pas pour rebâtir le stook. Ils ne sont donc pas très rapides. De plus, ils n’ont pas de gants protecteurs. la ficelle autour des gerbes leur coupe les doigts. Ils travaillent ainsi tout l’avant-midi et, à peine une heure après le début des travaux, ils ont déjà hâte au dîner. Maudit, il va nous falloir des gants. Sinon, on n’aura plus de doigts, de dire Joseph, qui montre ses doigts ensanglantés à Jean-Luc.
— T’as raison, Joseph. On va en parler à monsieur Piché.
Mon père les appelle pour le dîner. Ils racontent leurs difficultés du matin. Ce qui fait sourire mon père qui leur dit de se prendre une paire de gants dans la boutique. Puis, il leur passe une cigarette qu’ils fument comme si c’était leur dernière. Ils travaillent tout l’après-midi jusque vers six heures avec collation de tartines et de café vers quatre heures. Ils boivent des gallons d’eau et s’arrosent pour se rafraîchir. Épuisés, ils sont contents d’abandonner les champs et de venir souper. Immédiatement après, ils se rendent au fourgon où, en un rien de temps, ils sont couchés et dorment d’un sommeil profond.
Ils travaillent ainsi pendant quatre jours. La qualité du travail s’améliore au cours de ces quatre jours. Le travail n’est pas fini. Mais ils en ont assez! Ils demandent leurs gages et retournent au village. Mon père leur donne leurs gages, les conduit au village et les laisse à l’hôtel.
C’est une toute autre histoire que ce séjour au village.
Aussitôt descendus de l’automobile, Jean-Luc et Joseph entrent au salon bar et commandent six verres de bière chacun. C’est bien mérité. Ils se promettent de virer une bonne brosse. Au bout d’une heure, nos amis ne sentent pas trop leurs douleurs mais commencent à maugréer contre le stookage qu’ils jugent un peu trop tuant.
— Maudit! Je me suis quasiment arraché les doigts! dit Jean-Luc.
— Moi, j’ai de la difficulté à me tenir droit; je crois que je me suis tordu le dos d’ajouter Joseph. C’est pas pour nous autres ce type de travail-là.
Ils ont presque décidé de retourner à Saint-Ursule et à Saint-Lambert quand un habitué de l’endroit, François, qui a entendu leur conversation, les interpelle et leur demande en souriant s’ils sont disponibles pour faire un peu de stookage.
Ce fut le déclenchement d’un tollé d’injures et de revendications surtout de la part de Jean-Luc. Ça ne paye pas assez! On s’arrache les doigts à faire du stookage! J’en ai eu assez!
— Vous n’êtes pas habitués à travailler! de dire François.
Les injures pleuvent du tic au tac de part et d’autre. Ils en viennent aux poings. Pendant ce temps, le garçon du bar appelle la police. Ovila, un gros policier, s’approche d’eux et leur commande de l’accompagner à son bureau à deux pas de l’hôtel. Tandis qu’ils y marchent, ils lancent encore des injures aux gens de l’établissement qui se moquent d’eux. Maudits
Québécois! Restez-donc chez-vous, si vous ne voulez pas travailler! Ils ont certainement un peu trop bu. Le policier les met au cachot leur suggérant de dégriser. Il leur lance des couvertures et leur dit qu’il les reverra le lendemain. Les deux hurlent et jurent que c’est loin d’être fini.
Le lendemain, le policier Ovila se présente au cachot. Les deux chômeurs sont tranquilles et dorment paisiblement. Il les éveille et leur annonce qu’ils iront en cour subir leur procès. Les deux s’en défendent et jurent qu’ils ne seront pas de retour de sitôt dans ce maudit pays. Le policier les accuse d’avoir troublé la paix.
— Cinq dollars d’amende! prononce le juge Gallant.
Après cette punition, il ne leur reste pas beaucoup d’argent. Ils décident donc de retourner dans l’Est de la même façon qu’ils en sont venus.
D’autres chômeurs les suivront par la suite. Beaucoup d’autres! Ils ont à peu près les mêmes joies et les mêmes difficultés. Ils travaillent fort pendant quelques jours et repartent vers l’Est si la chance ne leur a pas souri ou s’ils s’ennuient. Ils continuent vers l’ouest jusqu’en Colombie Britannique s’ils ont amassé quelques sous.
C’est un temps de misère pour tous, les natifs comme les itinérants. Aujourd’hui, nous sommes en crise; le lendemain, nous le sommes moins. Le samedi soir est toujours quelque peu mouvementé. Les soirées à l’hôtel dégénèrent souvent en beuveries. On trouve quand même de bonnes personnes empressées d’accueillir les itinérants dans leur foyer. Certaines jeunes filles lavent, raccommodent, repassent leur linge. Il y en même certains qui deviennent plus populaires que les jeunes hommes de la ville. Tout cela crée des situations quelque peu tendues. Tous sont heureux de voir arriver la fin de l’été. Les gens de Gravelbourg se débarrassent enfin des intrus. Les chômeurs itinérants quittent le village en secouant la poussière de leurs chaussures et s’éloignent de ce pays de vent.
— Pardon, Monsieur! On se cherche une job. Connaissez-vous quelqu’un qui a besoin d’hommes pour travailler dans les champs?
Plusieurs répondent qu’ils n’ont pas rencontré de gens qui désiraient embaucher. Enfin, un monsieur Roy leur dit de s’informer auprès du maire. Il en connaîtrait peut-être.
Ils se rendent donc chez le maire. Il est dix heures. Monsieur le maire termine la lecture du journal du jour qui annonce encore un taux de chômage élevé. Tout à coup, on sonne à la porte.
— Voyons! Qui est-ce? chuchote le maire à son épouse. Il ouvre la porte et aperçoit deux individus habillés pauvrement. L’un porte des salopettes bleues, sales et est coiffé d’une casquette à palette, l’autre porte des vêtements de travail et un béret malpropres et troués.
— Bonjour. Que puis-je faire pour vous?
— On vient d’arriver sur le train qui mène ici. On est du Québec. Ça fait trois jours qu’on voyage dans un wagon avec une dizaine d’hommes, eux aussi chômeurs. On a mangé des sandwichs de beurre de peanut et bu un peu d’eau tiède. On a bien faim, monsieur le maire. Pourriez-vous nous donner un peu à manger? Quelques croûtes de pain et un fruit? Seulement pour la journée, monsieur le maire. On va essayer de se trouver une job dès aujourd’hui.
— Venez à la cuisine. Je crois que mon épouse trouvera bien quelque chose.
Les deux aventuriers suivent le maire. Après les introductions sommaires d’usage, son épouse, du nom de Justine, met le couvert et place sur la table quelques tranches de mortadelle (baloney), une miche de pain, deux verres de lait et un peu de compote de pommes.
Justine, pour faire conversation, leur pose quelques questions :
— Comment vous appelez-vous?
— Je m’appelle Jean-Luc Paradis, dit l’un.
— Et moi, Joseph Racicot, dit l’autre.
— De quelle ville ou de quel village venez-vous?
— Joseph vient de Saint-Ursule et moi de Saint-Lambert de la province de Québec, de répondre Jean-Luc. (Il continue dans le langage de sa région.) Il n’y a pas moyen de trouver une job chez-nous. On est tous les deux manoeuvres et on a pensé que ce serait plus facile de se trouver une job dans l’ouest. Mais je crois qu’on s’est trompé. Apparemment, il n’y a personne qui a besoin de gars comme nous autres. On ne parle pas l’anglais. C’est pour ça que, lorsqu’on a entendu dire qu’à Gravelbourg, les gens parlaient français, on a décidé de venir ici. Parce qu’on n’a pas d’argent, on s’est vu obligé de voyager sur wagons. On a ramassé notre p’tit bagage et puis on a embarqué ensemble à Saint-Ursule dans un char à grain.
— Mais où et sur quoi couchiez-vous?
— Il y avait un peu de paille sur le plancher du char et puis on s’était apporté une petite couverture. Le long de la route, d’autres gars sont entrés dans le char avec nous autres. Je vous assure que je les ai surveillés. On n’en menait pas large. On ne les connaît pas et eux non plus ne nous connaissent pas. On ne sait pas à qui on a affaire. Est-ce que c’est du monde fiable? Est-ce qu’on a affaire à des voleurs? On se regarde les uns les autres du coin de l’oeil. Chacun se tasse dans son coin.
On mange les quelques sandwiches de beurre de peanut qu’on s’est apportés. On n’a pas pu en apporter plus; on n’a pas de valises. Tout au plus, une poche, avec un peu de linge et quelques sandwiches. On se demande si c’est une bonne idée de partir comme ça avec si peu.
Puis, il n’y a pas de lumière dans le char. On ne pouvait pas se permettre d’apporter une lampe de poche. On laisse donc la porte entr’ouverte. Après le coucher du soleil, on sait qu’il y a d’autres personnes mais, on ne sait pas qui elles sont et où elles sont installées. Ils peuvent nous frapper sur la
 |
| Photo: Archives de la Saskatchewan «Riding the rails» : un itinérant monte dans un wagon de chemin de fer pour se déplacer d'un endroit à un autre durant la crise des années 1930. |
margoulette et on ne s’en apercevrait même pas. Ils peuvent tout nous prendre même si ce n’est pas grand’chose. On croise nos bras sur notre sac. En tout cas, le premier soir, il n’y a pas trop de complications et c’est assez tranquille. Je suppose qu’ils sont tous aussi énervés, peureux et fatigués que nous autres.
— Vous avez quand même dormi, je suppose?
— Monsieur le maire, dit Jean-Luc, moi, je n’ai pas fermé l’oeil de la nuit, et Joseph non plus. Comment voulez-vous qu’on dorme? On ne sait pas qui est assis à côté de nous. À mes côtés, il y a un gros homme avec une moustache. Il me donne la frousse. Je me déplace et je vais de l’autre côté du char. Joseph se place à côté de moi. Je me sens déjà plus en sécurité. Il y en a qui gueulent et font du bruit toute la nuit. On se rend finalement à Sudbury sans trop de chamailleries.
Et Joseph continue le récit du voyage.
— Vous savez, Monsieur le maire, dit Joseph, si ce sont là tous les problèmes qu’on a, on peut dire que le voyage se fait sans trop de misère. Il y a quand même des inconvénients sérieux ... Qu’est-ce qu’on fait, par exemple, quand on est pris avec sept ou huit autres personnes dans un espace où il n’y a pas de toilettes? Ensuite, comment faire pour se raser alors qu’il n’y a pas d’eau dans le char? J’essaye de me faire la barbe lorsqu’on s’arrête. Mais il n’y a pas d’eau chaude et je me coupe la figure à trois endroits.
Évidemment, Joseph se laisse impressionner par ces péripéties du voyage et avec raison! Il ne cesse de répéter : J’ai mon voyage! J’ai mon voyage!
Il continue.
— À Sudbury, on sort du wagon pour se dégourdir et respirer un peu d’air frais! Les gens du train sympathisent avec nous autres et nous offrent des fruits, mais ne s’occupent guère de nous. On comprend pourquoi. La mine que nous avons n’est guère rassurante. Plusieurs tentent de se débarbouiller et de se raser. Mais impossible de faire quoi que ce soit avec les cheveux qui restent nattés et sales.
 |
| Photo: Archives de la Saskatchewan «On to Ottawa» : des milliers de chômeurs s'arrêtent à Regina en 1935. Ils sont en route pour Ottawa. Une émeute s'ensuit dans la capitale de la Saskatchewan. |
Les conversations d’hommes que la misère a unies s’engagent ou continuent. D’aucuns parlent de leur région d’origine, leur dernière job, leur mise à pied, leurs parents, d’autres des jobs qui les attendent dans l’Ouest. La plupart d’entre eux sont du Québec ou de l’Ontario. Les gens de l’Ontario parlent l’anglais uniquement. Mais chacun a fini par se présenter et tous se connaissent au moins de nom.
—Aviez-vous des activités quelconques pour vous divertir ou pour passer le temps? demande le maire. Jean-Luc lui répond :
— Il y en a qui ont des cartes. Le jour on joue à des jeux bien simples comme, par exemple, la poule, le whist et le 21. Et, tout en jouant, on pose des questions. Les réponses que nous donnent nos compagnons nous renseignent sur eux. Il y en a qui ont quelques cennes et qui jouent au poker. D’autres ont des p’tits instruments de musique, une flûte ou une musique à bouche. Il y en a même un qui a une petite guitare. Les musiciens pratiquent pendant des heures. Ça devient ennuyant. Toujours les mêmes ritournelles! Et puis, il y en a qui n’ont pas d’instruments mais des bonnes voix. On organise des p’tits concerts. Joseph est bon pour chanter «Alouette, gentille alouette». Les Anglais connaissent une chanson qui s’appelle «You are My Sunshine» qu’ils répètent sans cesse et qu’on a finalement tous appris. Yves nous donne quelques chansons sur sa guitare. Au bout de deux jours, on se connaît suffisamment pour blaguer et se taquiner.
Arrivé à Winnipeg, un groupe nous quitte pour se rendre sur des fermes au sud du Manitoba faire du stookage. On n’est plus que quatre. On se rend jusqu’à Regina. Là, on s’informe où se trouve Gravelbourg et puis on prend le train pour cet endroit-là. C’est comme ça qu’on est rendu ici.
— Il n’y a pas beaucoup de travail ici non plus, leur dit le maire. Toutefois, à ce temps-ci de l’année, le temps des maigres récoltes, les fermiers ont besoin de travailleurs. Je vais tenter de vous mettre en contact avec un fermier qui pourrait vous engager. Dieudonné Piché m’a dit qu’il cherchait deux travailleurs pour le stookage. Vous en avez déjà fait?
— Non, pas du tout!
— Vous voulez vous essayer?
— On a rien à perdre à essayer ça!
— Je vous mets sous l’égide de Dieudonné. Si vous avez des questions, ne vous gênez pas. Posez-les-lui. Je lui téléphone tout de suite.
Le Maire appelle mon père qui accepte de les prendre à la ferme. Il vient les chercher immédiatement. Au début de la récession de 1930, mon père a encore son automobile. En un rien de temps, car la ferme n’est qu’à six milles de Gravelbourg, il est de retour à la maison avec les deux hommes. Il leur offre $2.50 par jour en plus de la pension. Jean-Luc et Joseph acceptent allègrement.
Il est tard quand ils arrivent à la ferme. Après les présentations d’usage aux membres de la famille et le souper, mon père les conduit au fourgon où ils doivent dormir. Le lendemain, très tôt, il les éveille. Ma mère leur offre un copieux déjeuner de gruau, d’oeufs, de bacon et de café. Pendant qu’ils mangent, mon père leur donne quelques informations sur les opérations de la ferme et répond à leurs questions.
— Quelle grandeur a votre terrain?
— Une section.
— C’est combien d’arpents une section?
— Six-cents-quarante acres.
— Chez nous, ça serait une très grosse ferme!
margoulette et on ne s’en apercevrait même pas. Ils peuvent tout nous prendre même si ce n’est pas grand’chose. On croise nos bras sur notre sac. En tout cas, le premier soir, il n’y a pas trop de complications et c’est assez tranquille. Je suppose qu’ils sont tous aussi énervés, peureux et fatigués que nous autres.
— Vous avez quand même dormi, je suppose?
— Monsieur le maire, dit Jean-Luc, moi, je n’ai pas fermé l’oeil de la nuit, et Joseph non plus. Comment voulez-vous qu’on dorme? On ne sait pas qui est assis à côté de nous. À mes côtés, il y a un gros homme avec une moustache. Il me donne la frousse. Je me déplace et je vais de l’autre côté du char. Joseph se place à côté de moi. Je me sens déjà plus en sécurité. Il y en a qui gueulent et font du bruit toute la nuit. On se rend finalement à Sudbury sans trop de chamailleries.
Et Joseph continue le récit du voyage.
— Vous savez, Monsieur le maire, dit Joseph, si ce sont là tous les problèmes qu’on a, on peut dire que le voyage se fait sans trop de misère. Il y a quand même des inconvénients sérieux ... Qu’est-ce qu’on fait, par exemple, quand on est pris avec sept ou huit autres personnes dans un espace où il n’y a pas de toilettes? Ensuite, comment faire pour se raser alors qu’il n’y a pas d’eau dans le char? J’essaye de me faire la barbe lorsqu’on s’arrête. Mais il n’y a pas d’eau chaude et je me coupe la figure à trois endroits.
Évidemment, Joseph se laisse impressionner par ces péripéties du voyage et avec raison! Il ne cesse de répéter : J’ai mon voyage! J’ai mon voyage!
Il continue.
— À Sudbury, on sort du wagon pour se dégourdir et respirer un peu d’air frais! Les gens du train sympathisent avec nous autres et nous offrent des fruits, mais ne s’occupent guère de nous. On comprend pourquoi. La mine que nous avons n’est guère rassurante. Plusieurs tentent de se débarbouiller et de se raser. Mais impossible de faire quoi que ce soit avec les cheveux qui restent nattés et sales.
Les conversations d’hommes que la misère a unies s’engagent ou continuent. D’aucuns parlent de leur région d’origine, leur dernière job, leur mise à pied, leurs parents, d’autres des jobs qui les attendent dans l’Ouest. La plupart d’entre eux sont du Québec ou de l’Ontario. Les gens de l’Ontario parlent l’anglais uniquement. Mais chacun a fini par se présenter et tous se connaissent au moins de nom.
—Aviez-vous des activités quelconques pour vous divertir ou pour passer le temps? demande le maire. Jean-Luc lui répond :
— Il y en a qui ont des cartes. Le jour on joue à des jeux bien simples comme, par exemple, la poule, le whist et le 21. Et, tout en jouant, on pose des questions. Les réponses que nous donnent nos compagnons nous renseignent sur eux. Il y en a qui ont quelques cennes et qui jouent au poker. D’autres ont des p’tits instruments de musique, une flûte ou une musique à bouche. Il y en a même un qui a une petite guitare. Les musiciens pratiquent pendant des heures. Ça devient ennuyant. Toujours les mêmes ritournelles! Et puis, il y en a qui n’ont pas d’instruments mais des bonnes voix. On organise des p’tits concerts. Joseph est bon pour chanter «Alouette, gentille alouette». Les Anglais connaissent une chanson qui s’appelle «You are My Sunshine» qu’ils répètent sans cesse et qu’on a finalement tous appris. Yves nous donne quelques chansons sur sa guitare. Au bout de deux jours, on se connaît suffisamment pour blaguer et se taquiner.
Arrivé à Winnipeg, un groupe nous quitte pour se rendre sur des fermes au sud du Manitoba faire du stookage. On n’est plus que quatre. On se rend jusqu’à Regina. Là, on s’informe où se trouve Gravelbourg et puis on prend le train pour cet endroit-là. C’est comme ça qu’on est rendu ici.
— Il n’y a pas beaucoup de travail ici non plus, leur dit le maire. Toutefois, à ce temps-ci de l’année, le temps des maigres récoltes, les fermiers ont besoin de travailleurs. Je vais tenter de vous mettre en contact avec un fermier qui pourrait vous engager. Dieudonné Piché m’a dit qu’il cherchait deux travailleurs pour le stookage. Vous en avez déjà fait?
— Non, pas du tout!
— Vous voulez vous essayer?
— On a rien à perdre à essayer ça!
— Je vous mets sous l’égide de Dieudonné. Si vous avez des questions, ne vous gênez pas. Posez-les-lui. Je lui téléphone tout de suite.
Le Maire appelle mon père qui accepte de les prendre à la ferme. Il vient les chercher immédiatement. Au début de la récession de 1930, mon père a encore son automobile. En un rien de temps, car la ferme n’est qu’à six milles de Gravelbourg, il est de retour à la maison avec les deux hommes. Il leur offre $2.50 par jour en plus de la pension. Jean-Luc et Joseph acceptent allègrement.
Il est tard quand ils arrivent à la ferme. Après les présentations d’usage aux membres de la famille et le souper, mon père les conduit au fourgon où ils doivent dormir. Le lendemain, très tôt, il les éveille. Ma mère leur offre un copieux déjeuner de gruau, d’oeufs, de bacon et de café. Pendant qu’ils mangent, mon père leur donne quelques informations sur les opérations de la ferme et répond à leurs questions.
— Quelle grandeur a votre terrain?
— Une section.
— C’est combien d’arpents une section?
— Six-cents-quarante acres.
— Chez nous, ça serait une très grosse ferme!
— Combien d’animaux?
— J’ai quinze vaches, dix cochons et vingt-cinq poules.
Mais ils sont venus pour stooker. Il faut donc leur montrer comment faire ce travail. Mon père les conduit dans le champs de blé et leur montre comment grouper 7 à 8 gerbes de blé, en mettre une au centre et faire pencher les autres quelque peu vers le centre, les têtes vers le haut, pour former un cône inversé. Ainsi, s’il pleut, l’eau glissera vers le bas et les têtes sécheront plus vite et ne pourriront pas. Je vous appellerai quand ce sera le temps de dîner.
Ils font donc du stookage, mais ils n’équilibrent pas très bien les gerbes, de telle sorte qu’ils doivent parfois revenir sur leurs pas pour rebâtir le stook. Ils ne sont donc pas très rapides. De plus, ils n’ont pas de gants protecteurs. la ficelle autour des gerbes leur coupe les doigts. Ils travaillent ainsi tout l’avant-midi et, à peine une heure après le début des travaux, ils ont déjà hâte au dîner. Maudit, il va nous falloir des gants. Sinon, on n’aura plus de doigts, de dire Joseph, qui montre ses doigts ensanglantés à Jean-Luc.
— T’as raison, Joseph. On va en parler à monsieur Piché.
Mon père les appelle pour le dîner. Ils racontent leurs difficultés du matin. Ce qui fait sourire mon père qui leur dit de se prendre une paire de gants dans la boutique. Puis, il leur passe une cigarette qu’ils fument comme si c’était leur dernière. Ils travaillent tout l’après-midi jusque vers six heures avec collation de tartines et de café vers quatre heures. Ils boivent des gallons d’eau et s’arrosent pour se rafraîchir. Épuisés, ils sont contents d’abandonner les champs et de venir souper. Immédiatement après, ils se rendent au fourgon où, en un rien de temps, ils sont couchés et dorment d’un sommeil profond.
Ils travaillent ainsi pendant quatre jours. La qualité du travail s’améliore au cours de ces quatre jours. Le travail n’est pas fini. Mais ils en ont assez! Ils demandent leurs gages et retournent au village. Mon père leur donne leurs gages, les conduit au village et les laisse à l’hôtel.
C’est une toute autre histoire que ce séjour au village.
Aussitôt descendus de l’automobile, Jean-Luc et Joseph entrent au salon bar et commandent six verres de bière chacun. C’est bien mérité. Ils se promettent de virer une bonne brosse. Au bout d’une heure, nos amis ne sentent pas trop leurs douleurs mais commencent à maugréer contre le stookage qu’ils jugent un peu trop tuant.
— Maudit! Je me suis quasiment arraché les doigts! dit Jean-Luc.
— Moi, j’ai de la difficulté à me tenir droit; je crois que je me suis tordu le dos d’ajouter Joseph. C’est pas pour nous autres ce type de travail-là.
Ils ont presque décidé de retourner à Saint-Ursule et à Saint-Lambert quand un habitué de l’endroit, François, qui a entendu leur conversation, les interpelle et leur demande en souriant s’ils sont disponibles pour faire un peu de stookage.
Ce fut le déclenchement d’un tollé d’injures et de revendications surtout de la part de Jean-Luc. Ça ne paye pas assez! On s’arrache les doigts à faire du stookage! J’en ai eu assez!
— Vous n’êtes pas habitués à travailler! de dire François.
Les injures pleuvent du tic au tac de part et d’autre. Ils en viennent aux poings. Pendant ce temps, le garçon du bar appelle la police. Ovila, un gros policier, s’approche d’eux et leur commande de l’accompagner à son bureau à deux pas de l’hôtel. Tandis qu’ils y marchent, ils lancent encore des injures aux gens de l’établissement qui se moquent d’eux. Maudits
 |
| Photo: Archives de la Saskatchewan «Stooking» : un homme place des gerbes de blé en meulon. Collection : Saskatchewan Wheat Pool. |
Québécois! Restez-donc chez-vous, si vous ne voulez pas travailler! Ils ont certainement un peu trop bu. Le policier les met au cachot leur suggérant de dégriser. Il leur lance des couvertures et leur dit qu’il les reverra le lendemain. Les deux hurlent et jurent que c’est loin d’être fini.
Le lendemain, le policier Ovila se présente au cachot. Les deux chômeurs sont tranquilles et dorment paisiblement. Il les éveille et leur annonce qu’ils iront en cour subir leur procès. Les deux s’en défendent et jurent qu’ils ne seront pas de retour de sitôt dans ce maudit pays. Le policier les accuse d’avoir troublé la paix.
— Cinq dollars d’amende! prononce le juge Gallant.
Après cette punition, il ne leur reste pas beaucoup d’argent. Ils décident donc de retourner dans l’Est de la même façon qu’ils en sont venus.
D’autres chômeurs les suivront par la suite. Beaucoup d’autres! Ils ont à peu près les mêmes joies et les mêmes difficultés. Ils travaillent fort pendant quelques jours et repartent vers l’Est si la chance ne leur a pas souri ou s’ils s’ennuient. Ils continuent vers l’ouest jusqu’en Colombie Britannique s’ils ont amassé quelques sous.
C’est un temps de misère pour tous, les natifs comme les itinérants. Aujourd’hui, nous sommes en crise; le lendemain, nous le sommes moins. Le samedi soir est toujours quelque peu mouvementé. Les soirées à l’hôtel dégénèrent souvent en beuveries. On trouve quand même de bonnes personnes empressées d’accueillir les itinérants dans leur foyer. Certaines jeunes filles lavent, raccommodent, repassent leur linge. Il y en même certains qui deviennent plus populaires que les jeunes hommes de la ville. Tout cela crée des situations quelque peu tendues. Tous sont heureux de voir arriver la fin de l’été. Les gens de Gravelbourg se débarrassent enfin des intrus. Les chômeurs itinérants quittent le village en secouant la poussière de leurs chaussures et s’éloignent de ce pays de vent.