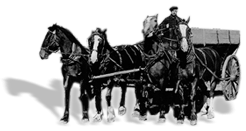Revue historique: volume 14 numéro 3
KIS-IS-KAT-CHE-WAN
Deuxième prix du Concours «UNE HISTOIRE DE CHEZ NOUS»
Une nouvelle de Estelle Bonetto
Vol. 14 - no 3, mars 2004
Une nouvelle de Estelle Bonetto
Vol. 14 - no 3, mars 2004
| Saskatchewan. Les syllabes saccadées de ce nom qui paraissait sans fin, sonnaient comme des sifflets lointains. Éloignés et pourtant si familiers. Comme si mes lèvres avaient déjà arpenté la courbure de ces lettres, et que mon esprit s’était déjà posé sur le mot qui dessinait les contours de mon imagination. Certainement mes yeux s’étaient aveuglément promenés à l’aube de mon départ, essayant de visionner les vents qui allaient rafraîchir mon âme, les soleils qui allaient conquérir mes soifs, les ciels qui allaient coucher mes sommeils, et les gens qui porteraient mes paroles. Ma jeunesse me caressait sans cesse de leurs doigts avides de retenir ma liberté, ici sans avenir. Je vais emmener avec moi la certitude de ma mort et lui montrer combien ils avaient tort de nous retenir sur ce territoire repus de guerre. |
7 avril 1919.
Mon grand-père Ernest était parti vers ces espaces qu’il croyait sans lendemain. Il disait que la vie là-bas perdait haleine dans les vents violents, que le souffle se coupait dans les froids cinglants, mais que la paix pourtant avait conquis les terres allongées de tout leur long, telles les écailles d’un lézard cuirassé. Il écrivait des monts et des merveilles sans pareil. Il m’a laissé un héritage lourd de récits et de rêveries, que j’ai soigneusement abrité dans un coin de mon esprit. Un voyage qui va paraître sans fin mais dont je dégusterai chaque découverte et dont j’apprivoiserai chaque peur pour goûter à la pleine saveur de ce labeur.
7 mai 1919.
Il est déjà trop tard pour revenir en arrière et encore trop tôt pour aller de l’avant. Pris sur ce paquebot depuis des semaines, mes propres pas ne me menaient nulle part, seul le ventre du bateau glissait son flanc sur l’eau lisse. Cette avancée m’incitait à me questionner sur mon identité; je ne suis plus qui j’étais, je ne sais pas encore qui je serai.
7 juin 1919.
Au ralenti d’un rythme pourtant haletant, le train s’échappe à la vitesse de ses moyens en sifflant de ses poumons charbonnés l’envie qui le presse lui aussi d’arriver à sa destination. La peur de l’erreur tourmentait mon cœur de palpitations.
Dans ce couloir filant qui me menait à Gravelbourg, j’attrapais ci et là des bribes d’une langue familière. Mises bout à bout elles formaient une toile de fond sur le paysage linguistique autrement anglais. Je tentais de me fondre dans cet envers du décor qui semblait vouloir m’accueillir et dont je craignais pourtant le rejet. J’entendais la résonance de la différence qui s’abattait dans mes oreilles, et s’ils ne comprenaient pas? Je n’avais toujours pas prononcé un mot lorsque je reçus en pleine face un projectile suffisamment gros qu’il me fit sursauter, bondir de mon siège et m’exclamer:
— Qui s’amuse à de pareils enfantillages?
De suite je réalisa que mon intervention était exagérée et mal venue. La nervosité que j’avais jusque là enfouie dans mes pensées intérieures avait giclé et arrosé une audience stupéfaite puis gênée. Je m’empressa de faire des excuses, je bafouillais quelques mots incompréhensibles quand un homme se leva et s’approcha de moi. Le silence déploya ses doigts subtils, suspendus au-dessus du temps qui cessa de battre dans mon cœur. La présence lourde du gaillard couvait une atmosphère de lutte et je me débattais déjà dans cet univers sans issue comme un poussin combat la cloison de sa coquille pour clamer son existence. Il éleva sa main massive dans les airs, à cet instant je n’avais plus d’espoir que son poing n’atterrisse point sur ma face apeurée. Je restais pourtant immobile dans ce temps figé qui n’en finissait plus de durer. À ma grande surprise son visage s’éclaira à la lumière d’un sourire fécondé de bonté. Ses doigts empoignèrent délicatement les bords de son chapeau en signe de salutation.
 |
— Bonjour, t’as pas l’air d’être de par chez nous, quel bon vent t’ammènes dans c’coin ci des prairies?
La candeur de mon silence surpris parut l’amuser ainsi que le reste des voyageurs qui remplirent bien vite le vide par leurs rires éclatés. Je me joignis bientôt à cette cohorte si accueillante. Nous échangeâmes maintes poignées de main, sourires tacites et articulés.
Le temps fit maintenant place à mon arrivée à Gravelbourg.
Le train, essoufflé, stoppa enfin. Je me hâta de descendre du wagon poussé par un élan de curiosité qui rendait chacun de mes gestes maladroits et imbus d’émotions.
Tandis que les gens autour s’enfuyaient rejoindre leur routine familière, je faisais un premier pas sur les territoires de ma nouvelle liberté. Mon cœur n’en croyait pas ses yeux de contempler la platitude de ces paysages et au beau milieu comme un chêne robuste et ancien planté sur une demeure abandonnée, des silos à grains. Les pyramides de la Saskatchewan, pensais-je, truffées de richesses, celles de la terre qui se donne en offrande pour le dur labeur des hommes, le symbole d’une économie ancrée de profondes racines, le secret d’une immigration florissante. Ces idées de grandeur tourbillonnaient dans la tumulte de mon esprit qui avait été tenu en haleine pendant de longues semaines. J’étais planté moi aussi, ressemblant plus à un clou qu’à un chêne solidement posé, prêt à me tordre au moindre coup du sort.
L’homme du train vint interrompre mes contemplations en apposant sa main souriante sur mon épaule:
— C’est quoi ton premier nom?
— Jasmin, répondis-je
— Tu cherches-tu quek chose à faire?
— Plutôt deux fois qu’une!
Il accueillit ma réponse avec sa bonhomie naturelle.
— Ben, y cherche un instituteur à l’école, moi j’te vois bien pour c’te job-là, j’va t’introduire à m’sieur Courcelles, pis, t’as pas d’place pour t’poser?
Je laissais son flot de paroles me bercer les oreilles de leur chant gracieux, sa voix transpirait l’honnêteté et la compassion. Était-ce son français piqué d’un accent si riant ou son être tout entier qui m’incitait à la confiance? Je n’aurais encore su le dire. Moi enseignant? Il me semblait que j’avais tant à apprendre moi-même de ce peuple, de leurs mythes, leurs peurs, leurs bonheurs et leurs labeurs. Les enfants pourraient me guider dans ma quête initiatique. Je n’attendais plus rien de la vie, c’était à mon tour de partager sans espoir d’être remercié. D’où je venais la guerre avait été trop laide pour que ma peine se souvienne. Je glissais désormais sur un lac gelé, par endroit brisé, une eau emprisonnée par les glaces éternelles de la tristesse humaine.
Je revins à la réalité qui m’avait mené sur le chemin de l’aventure. Mon nouvel ami pointa du doigt une bâtisse de taille moyenne non loin de la gare:
— Y prennent des gars à la semaine, au mois, autant d’temps q’tu veux, c’est assez cheap.
Je ne comprenais pas l’anglais mais les quelques mots éparpillés ça et là dans son langage vibraient de sens. Ayant grandi dans l’Est de la France où le français et l’allemand se côtoient, se colorent l’un à l’autre, je ne m’étonnais pas plus de cet entrelacement.
— T’es pas un gars difficile toi, c’est bon ça, faut pas être difficile par icitte, l’climat est rude et nous autre on travaille fort.
Ma nature silencieuse m’avait gagné une amitié ce dont j’étais très satisfait.
Le matin suivant, je rendais visite à M. Courcelles. Sa réception fut des plus chaleureuses. Un jeune homme célibataire, éduqué, parlant français et enthousiaste à l’idée de travailler ne devait pas cogner tous les jours à sa porte. Il m’apprit que les Franco-Canadiens avaient le plus grand mal à perpétuer leur langue, leur culture et leurs coutumes ainsi qu’à préserver le respect de leur foi catholique. Je commençais à entrevoir l’esquisse d’un peuple dévoué à ses racines, plantées au plus profond de la prairie, mère de leur immigration, qui ont vu naître leurs combats et leurs forces face à l’adversité climatique, linguistique et même politique. Je pensais en moi-même sans oser encore l’exprimer, que les Canadiens français en Saskatchewan étaient chanceux d’une certaine manière d’avoir une cause pour laquelle se battre. Je sentais leur fierté à chaque succès remporté, leur malheur à chaque espoir avorté, leur persévérance labourée de pluie séchée. Je faisais de leur destinée une richesse raréfiée. Dans mon pays les gens ne croyaient plus à la fécondité des lendemains.
Plus les mois passaient, plus je songeais qu’ici, les limites annonçaient l’étendue d’une liberté inattendue, plus vaste que la voûte d’un ciel qui berce la terre, aussi chère que la préciosité des pierres. Mon envie de participer à cette communauté ne faisait que grandir. Des graines d’engagement poussaient mes capacités à me développer à l’intérieur de cet espace propice au vice de la vertu, à la récolte des conquêtes communautaires. J’avais aussi conscience du romantisme qui semblait vouloir quelque peu colorer la réalité, cependant ses effets bienfaiteurs me faisaient croire, aux côtés de mes nouveaux compatriotes, à l’épanouissement d’une langue aussi belle que les pupilles de nos mères.
 |
Les tensions étaient pourtant palpables. Les effets de la grande guerre, que j’avais tenté de laisser derrière, revenaient à grands pas me hanter. Peut-être n’était-ce qu’un prétexte pour accélérer la domination anglophone, toujours est-il que les Franco-Canadiens étaient devenus les boucs émissaires, autant sinon plus que les autres minorités, affublés de persécutions sociales et culturelles. À cause de cette guerre à laquelle les Québécois avaient gracieusement tourné le dos, cette guerre que les Allemands avaient torturée, cette guerre avait insufflé un vent de panique dans les prairies quant à l’usage de la langue française et allemande; leur enseignement, les anglophones se donnèrent le dessein de le faire couler comme un vulgaire navire de guerre vaincu. S’attaquer à une langue va bien au-delà des limites de ses mots, elle touche à la fois et surtout le peuple qui la parle. Or, il me semblait que ni les Canadiens-allemands ni les Canadiens-français ne fussent des guerriers ou incarnent de quelque façon que ce soit l’hostilité d’un régime politique qu’ils avaient quitté depuis des générations ou bien même récemment. La guerre ne fait pas de pitié. Ainsi les échos du conflit européen devaient durer des décennies ici. À mesure que l’idée s’était infiltrée dans les esprits que l’anglais devait être la seule langue enseignée dans les écoles, on ne cessa de trouver une foule de bonnes raisons pour enfoncer le clou dans le mur de l’injustice. La Saskatchewan, à travers une quête provinciale identitaire, se cherchait «une langue, une école, un drapeau», autrement dit un besoin d’uniformité qui devait stabiliser la province. L’éducation devint le terrain privilégié de l’affaiblissement de la population de langue française. En nous étouffant à la racine, les anglophones s’assuraient que nos jeunes générations deviennent linguistiquement anémiques. Ce n’était sans compter sur la volonté vibrante des parents de transfuser leur patrimoine à leurs jeunes, seuls espoirs d’une relève vitale. En 1918, la Loi sur l’éducation était amendée pour ne plus autoriser qu’une seule heure d’enseignement du français par jour à l’école. Avant cela, me racontait-on avec des sourires nostalgiques, les écoles étaient libres de bercer leurs bambins du doux son du français. Après ce coup de masse intolérable, les Francophones durent rapidement s’organiser et mettre leurs forces à l’unisson.
La Saskatchewan affichait mille autres couleurs bigarrées d’une tapisserie filée d’incessants flots de familles venues des différents pays d’Europe et aussi parsemée des peuplades autochtones, au fond, le véritable passé patrimonial de la province. Les “sauvages” comme on les appelait ici, à qui l’on refusait même toute dignité humaine, me fascinaient. Ils s’offraient comme un mystère à mon imagination. Leur vie spirituelle semblait sacrée sous leurs chants et leurs danses comme des transes en offrande à leurs croyances. Certains parlaient français, une langue mariée aux saveurs des sons autochtones. Les Métis se trouvaient à la croisée des chemins de culture et de sang et même de langue. Je leur ressemblais.
Ma vie ici n’avançait guère plus vite qu’un bison qui broute. Et comme l’animal, je savourais chaque brin d’herbe qui se trouvait sur mon parcours. Mon esprit appréciait la lenteur des paysages qui défilaient à toute vitesse dans mon imagination. Ce coin de pays m’offrait la solitude dont j’avais besoin pour faire fourmiller mes idées. Ainsi mes contacts humains n’en étaient que plus intenses, espacés comme les distances sur les prairies. Il n’y avait pas de femme dans ma vie, non pas qu’aucune ne fut assez plaisante à mes yeux; j’avais simplement pris la décision de rester seul pour avoir la liberté de partir demain s’il le fallait. Je ressentais le caractère éphémère de mon existence, du lieu où je me trouvais, de l’humanité.
Les effets de l’hiver gardaient leurs distances sur ma condition physique et morale. Je devais être un «tough» comme le disaient les gens par ici. Les poudreries, l’immensité des bancs de neige qui se dressaient contre toute proportion humaine, le vent plus puissant qu’une armée en marche, le froid qui rendrait faible une forteresse, avaient tendance à bercer l’imaginaire qui sommeillait en moi.
Les écoliers, eux, étaient toujours doués de vie, et confortaient chacune de nos batailles quotidiennes, autrement inutiles, pour une école qui parle leur langue, pour le respect de ces jeunes citoyens qui ne demandaient pas mieux que d’appartenir à leur patrie, à leur façon, en français. Leur insouciance d’enfant nous faisait croire à une issue mature. Il me passait parfois par la tête l’idée que si on leur donnait la parole, ils exprimeraient la sagesse et la sincérité de leurs jeunes voix bien mieux que nous le faisions. Qui sommes-nous pour parler de liberté linguistique quand le reste du monde est opprimé par le désespoir?
Ces flots de pensées me quittaient pourtant bien vite, engloutis par la priorité et l’importance que je portais à mon entourage. Rien n’est plus beau qu’un sourire proche que l’on peut saisir du bout des yeux.
Crédit:
Photo 1: Village de Gravelbourg vers 1910. Collection Marcelle Verville.
Photo 2: Des élèves de l'École publique de Storthoaks avec leur instituteur et l'abbé A.-M. Ferland en 1925. Collection Georges E. Michaud, Université d'Ottawa.