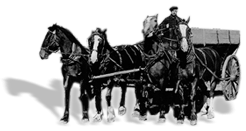Anniversaires historiques
La colonisation française au Manitoba s'est faite par étapes bien distinctes. Il y a eu les Voyageurs qui ont fondé la race métisse. Puis quelques colons venus avec Provencher, et enfin, après 1870, les paroisses de la Rivière Rouge. Jusque-là, les colons étaient presque exclusivement Canadiens. Autour de 1890 il se dessina un mouvement de colonisation faite par des Français venus de France. M. Noël Bernier a raconté dans Fannystelle comment ce mouvement a débuté. L'entreprise de Fannystelle n'est pas un fait isolé. Il y eut d'autres essais, les uns plus importants que les autres, mais tous apportèrent au groupe français du Manitoba un renfort dont il avait grandement besoin. Ces groupements de Français venus de France sont aujourd'hui des paroisses prospères où se parle le français; visitez Notre-Dame-de-Lourdes, Saint-Léon, Saint-Claude et tant d'autres de ces paroisses et vous verrez comment les descendants de ces colons sont devenus de bons ouvriers de la survivance française.
On doit célébrer cette année le cinquantenaire de la fondation de la paroisse de Saint-Hubert en Saskatchewan. La paroisse de Grande-Clairière et les paroisses filiales – Saint-Maurice et Saint-Raphaël – sont à peu près de la même époque. En plus, plus près de nous, M. l'abbé Benoît, l'infatigable curé de St-Malo, s'apprête à célébrer le cinquantenaire de sa paroisse. Là aussi il y eut un groupement de Français qui rappelle quelque peu celui de Fannystelle.
Nous avons cru bon, afin de rappeler ces souvenirs, de donner ici quelques extraits d'un livre presque oublié de Monseigneur Gaire, le fondateur de Grande-Clairière, venu ici en 1888, intitulé 'Dix années de missions au grand Nord-Ouest canadien'.
L'auteur y raconte tout d'abord ce qui l'amena à vouloir fonder une colonie au Manitoba:
'C'était un matin de l'été 1885. Je rentrais chez moi après la messe. Mon courrier venait d'arriver. Au milieu de prospectus, de lettres et de journaux, j'aperçois une brochure peu épaisse, dont la couverture bleue tranche sur tout le reste. Saisir le livre, en déchirer la bande, est pour moi l'affaire d'une seconde. Le livre a pour titre: 'Guide du colon français au Canada', et il finit par la signature d'un prêtre canadien français. Ma curiosité est piquée. Je saisis une chaise et m'y assieds; je lis attentivement la première page du livre, dévore la deuxième, puis la troisième; trois quarts d'heure plus tard, l'ouvrage tout entier y avait passé. La brochure exposait les avantages offerts aux colons canadiens, elle parlait de ces immenses lots gratuits que le gouvernement accorde à tout colon, qui veut bien les recevoir. Je comprenais facilement cela: mais il me semblait, en outre, lire entre les lignes comme un appel désespéré; il me semblait entendre comme le son de la trompette d'alarme, appelant des frères au secours d'autres frères. Je voulus relire la brochure mystérieuse; je la relus ensuite bien des fois encore, et toutes ces lectures ne firent que confirmer mes premières impressions. Les catholiques français du Canada ont là-bas de redoutables ennemis, me dis-je; eh bien, je serai de la bataille!
'Toutefois, craignant d'être en cela le jouet de sentiments enthousiastes, si naturels à trente ans, je ne voulus rien précipiter; je soumis ma vocation à l'épreuve du temps, j'accordai deux grandes années à la réflexion. Entre temps, je fis part de mes projets aux parents et amis; et, comme bien l'on pense, un sarcasme absolu et général fut la réponse de tous à mes ouvertures. Cela ne me contraria pas le moins du monde. Je m'y attendais; mais très philosophiquement je laissai les amis se moquer de mes desseins, et débiter leurs éloquents discours à l'encontre. Je continuai de sonder devant Dieu la réalité d'une vocation qui devenait tous les jours plus ardente et plus décidée.
'Et pourquoi ne pas le dire? Les attentats contre la religion, que je voyais se perpétrer en France, étaient bien faits pour me confirmer dans ma décision. J'aurais encore compris que des impies votassent pour des représentants impies; mais l'aveuglement de tant de catholiques, votant pour des sectaires ennemis, me paraissait insupportable; assurément mes paroissiens de Loisy et de Bezaumont ne m'avaient pas donné cette affligeant spectacle; mais si eux-mêmes votaient bien, trop souvent ailleurs l'on votait mal.
'Toutefois si je partais indigné contre les hommes, je restais cependant profondément attaché à mon pays; le Canada était pour moi comme un prolongement de la patrie française; j'y allais pour y combattre comme Catholique et Français; ces deux mots résument tout mon plan de campagne en Canada.
'Quand tout fut prêt, et que j'eus mis la dernière main à mes oeuvres paroissiales inachevées, je songeai à régler, avec mon évêque, l'affaire du départ. J'y allais si bonnement, que l'idée ne m'était pas même venue que de ce côté-là des obstacles pourraient surgir. Convaincu que Dieu m'appelait au Canada, et que beaucoup de bien y était à faire, je ne prévoyais pas comment mon évêque pourrait me réfuser son assentiment. Je le lui demandai donc dans une lettre courte, franche, presque ingénue. La réponse tarda longtemps; je compris alors que les choses n'iraient pas toutes seules; mais malgré ma vive ardeur, je ne bougeai pas davantage: je sentais que m'agiter serait maladroit. Enfin la lettre arriva. Cette lettre du Vicaire général, supposant sans doute une détermination chancelante de ma part, me disait comme conclusion: 'Mon seigneur vous engage donc à continuer dans son diocèse le bien que vous y avez déjà commencé.' Le mot 'son diocèse' me parut étroit: quelque chose me disait, que ni Jésus-Christ, ni les apôtres ne l'avaient connu. J'avais là une base formidable de réplique: ma réponse fut longue et vive, mais soumise et respectueuse. En terminant, je disais: 'Monseigneur, je le vois, vous avez voulu éprouver la solidité de ma vocation; vous pouvez continuer l'épreuve: mais dans un an, dans vingt ans, vous me trouverez toujours animé des mêmes intentions.' Et plus haut j'avais dit: 'Ce n'est ni l'or, ni la gloire, ni le bien-être, qui m'attirent là-bas; c'est donc Dieu qui m'y appelle.' Ma victoire fut complète. Quarante-huit heures plus tard, je tenais mon exeat dans mes mains; j'étais libre de partir.'
Voici maintenant l'arrivée à Winnipeg et à Saint-Boniface en 1888:
'Puis voilà un grand mouvement dans le train: on vient d'annoncer Winnipeg; déjà nous en longeons les premières maisons. Les voyageurs rangent fiévreusement leurs paquets: nous voilà sur le pont de la Rivière-Rouge; puis au milieu d'un pêle-mêle de maisons construites à la hâte, et le plus souvent jetées là en désordre: tant l'activité fiévreuse des débuts de la cité a été grande. Notre train s'arrête: tous descendent; je descends moi-même très perplexe. Je ne savais de quel côté me diriger. Me voilà devant une gare immense, devant moi grouille un peuple énorme de curieux, qui sont là uniquement pour voir passer le train. Quelques-uns cependant viennent au devant d'amis qu'ils attendaient, de tous côtés l'anglais résonne, sourd, nasillard: Winnipeg est presque tout entière anglaise; la ville est d'hier et elle compte déjà 30,000 âmes. Je sais que Saint-Boniface, la ville française et catholique, la cité archiépiscopale est toute proche. Mais à qui pourrais-je demander ma direction. Je dois à mon rabat mon salut; un brave Canadien français reconnaît à ce signe un prêtre de France: il m'aborde, m'offre son concours charitable. Nous traversons Winnipeg. Cette ville qui date de 1870, est déjà très opulente, ses magasins regorgent de tout le luxe et le confort américain, je suis absolument ébahi.
'Me voilà à l'extrême sud de la ville. Devant moi coule la Rivière-Rouge. Sur l'autre rive, je vois surgir un clocher élancé, et, autour de ce clocher, j'aperçois plusieurs édifices imposants. Ce clocher est la cathédrale de Saint-Boniface; ces édifices que je vois autour sont: à gauche, l'archevêché, à droite le pensionnat des filles, en arrière, le très important collège des Jésuits. Je remercie mon guide, et me voilà arpentant vivement l'interminable pont de la rivière. Enfin je suis à l'autre bout: sur la première maison à droite, je lis 'bureau de poste', en bon français; un peu plus loin à gauche, un marchand s'est donné pour enseigne le vrai drapeau français. Je tourne le bureau de poste et me voilà dans la rue qui conduit à l'archevêché. Un jardin planté d'érables s'étend devant l'édifice, auquel il donne un aspect riant; déjà je suis à la hauteur de la clôture peinte en blanc de ce jardin, quand, à trois pas devant moi, j'aperçois un bon vieux, je remarque en même temps qu'il me sourit. Pour la seconde fois mon rabat me trahissait. Ce bon vieux qui me sourit est le Frère Jean, l'inséparable compagnon de l'illustre missionnaire Taché. Et le bon Frère, tout bonnement, me prenant presque par le bras, me conduit tout droit au réfectoire de l'archevêché, me tient compagnie, pendant qu'on m'apporte des plats variés auxquels je touche à peine; mais, dévoré par une fièvre brûlante depuis plusieurs jours, je bois en trois rasades puissantes tout le contenu d'une grande cruche pleine de lait. Le Frère Jean, rempli d'effroi pour mon estomac, commence à s'agiter; mais d'un geste je le rassure; il rit de bon coeur et moi j'en fais autant.
'Un instant après, le vieil archevêque Taché me recevait avec toutes les effusions de son noble coeur. Toujours je me rappellerai cette inoubliable entrevue. Pourtant, en me voyant pour la première fois, à la fin d'un long voyage, épuisé des suites d'une traversée pénible, ayant juste assez mangé pour ne pas mourir de faim pendant près d'un mois, il dut se dire: Que pourra faire ici ce moribond? Puisse Dieu lui donner des forces!
'C'est ainsi que mon premier jour au Manitoba fut un beau jour. J'étais écrasé, le 25 avril, en quittant la France; j'étais superbe de bonheur et d'entrain le 21 mai suivant.'
L'abbé Gaire a d'abord été l'hôte de l'abbé Jolys et il a visité certains centres français. Il conçoit l'idée d'aller fonder une paroisse dans l'ouest de la province, où le pays est actuellement à se faire envahir par les colons d'autres races et d'autres religions. Il se rend en juillet au lac des Chênes (Oak Lake). C'est de là que le missionnaire colonisateur part pour aller fonder sa paroisse. On traverse des marécages sans nombre puis on arrive à un endroit plus élevé. C'est là que M. Gaire décide d'établir Grande-Clairière. Il y a dans la région trois familles de Métis. M. Gaire va à Brandon remplir les formalités nécessaires et signer les papiers. Il devient propriétaire. Puis voilà M. Gaire seul, sur son lot et en face d'une cabane.
Un combat se livre en lui devant l'immensité de l'effort. Puis voilà qu'un Canadien arrive, venu de cinquante milles pour vérifier s'il est vrai qu'un prêtre veut fonder une colonie. C'est le premier colon. Le missionnaire habite d'abord la maison de Thomas Breland, Métis de l'endroit, qui offre sa modeste demeure au prêtre.
Voici comment le courageux fondateur raconte ses débuts:
'La nuit est arrivée: Mme Breland se retire sous la tente avec ses trois enfants, et chasse les cousins, ferme hermétiquement l'ouverture, allume une lampe, puis je l'entends qui fait prier ses enfants. De son côté Thomas allume un brasier fumeux devant la maison, puis apporte deux chaises, sur lesquelles nous prenons place en facen l'un de l'autre à côté du feu. La fumée du brasier chasse les maringouins (cousins), alors Thomas et moi nous pouvons respirer tranquillement l'air pur d'une nuit fraîche et douce. Et voilà que mon pauvre métis commence à disserter en vrai philosophe chrétien. Il me parle de ces 'blancs', qui trompent dans les marchés et ne réparent jamais leurs injustices. Il cause du mariage chrétien; s'élève contre certains crimes qui le profanent; puis tout d'un coup se lance dans la narration des grandes chasses d'autrefois.
'Pour moi, je suis ravi de tout ce que je vois; je sens qu'il va faire bon vivre au milieu de si bonnes gens: il ne reste plus rien de mes appréhensions du jour. Thomas a fini de causer, nous allons nous reposer.
'Je ne suis pas douillet, pourtant, pourtant je ne puis m'empêcher de trouver dur mon lit; on y regardera demain. D'autre part, je commence à éprouver les premiers feux d'abcès qui vont bientôt me couvrir une partie du cou et de la figure. J'attribuai ces misères aux piqûres des maringouins; mais quand je donnai cette explication au bon Frère Jean, il m'arrêta en souriant: d'après lui je payais ainsi mon tribut aux privations de toutes sortes par lesquelles j'étais obligé de passer. Et maintenant je crois de plus en plus que le Frère Jean avait raison.
'Cependant le soleil du 22 juillet s'est levé: c'est dimanche, je vais dire aujourd'hui ma première messe dans la solitude qui désormais s'appellera Grande-Clairière; j'ai choisi un nom bien topique et bien français, capable de résister à tout essai d'anglicisation.
'Nous rangeons parfaitement la chaumière de Breland; une table est mise à la belle place et transformée en autel. À neuf heures, mes trois familles de métis sont là, six adultes et dix enfants. Je n'ai ni chantres ni enfants de choeur; je dis une messe basse et je me sers moi-même: entre temps je puis admirer la piété simple et franche de ces braves gens.
'Ainsi fut célébrée ma première messe à Grande-Clairière. Humbles mais délicieux débuts, je ne vous oublierai jamais!
'Le lendemain deux ouvriers constructeurs m'arrivent. Je les conduis à l'endroit où je veux élever mon 'chantier': nous nous mettons à l'oeuvre aussitôt, le carré de la maison est établi, ce jour même; le lendemain les murs en planches sont élevés; le surlendemain les planches de la toiture sont fixés. Mon chantier est dressé, mais il est loin d'être fini: le deuxième rang de planches manque aux murs, et les bardeaux à la toiture; il n'y a encore ni portes ni fenêtres, le plancher de l'intérieur manque totalement. Tel quel, mon chantier mesure 5 mètres sur 4. Mais mon porte-monnaie est vide: pour le moment, je dois m'en tenir là.
'Pourtant j'attends de l'argent; je profite de la voiture de mes ouvriers qui s'en retournent chez eux et me rends ainsi au bureau d'Oak Lake. Une lettre m'apprend que les mandats attendus sont arrivés, mais je dois aller les toucher à Winnipeg. J'y vais, je reçois mon argent, je passe ensuite à Saint-Boniface, où je suis les exercices de la retraite, tout en soignant mes abcès.
'Je me repose ainsi du 27 juillet au 9 août. Ce dernier jour, deux Alsaciens viennent me rejoindre; je pars avec eux le lendemain pour Grande-Clairière, où nous arrivons dans la nuit du 11 accompagnés de tout un attirail de ménage et de ferme. Nous venons frapper tard dans la nuit chez Breland; nous nous 'campons' au milieu de la chambre sur des couvertures, et nous dormons comme nous pouvons. Le lendemain, je dis ma deuxième messe dans la solitude; mon assistance s'est accrue des deux Alsaciens de la veille. Après le dîner, ces deux hommes vont faire une partie de chasse; ils reviennent sur le soir, tout fiers de montrer les canards sauvages qu'ils ont tués. Oh le bon pays que le Canada! Ce n'est pas l'Europe qui offre ces libertés: le gibier y est introuvable, et là n'est pas chasseur qui veut! Ainsi s'exaltent nos deux nouveaux venus. Je ne sais encore ce que je ferai de ces deux hommes; en attendant mieux, je les prends à mon service. Le lundi, de bonne heure, nous partons pour le chantier inachevé, situé à 500 mètres de là; nous travaillons dur, qui à la toiture, qui au plancher, qui à la muraille, qui au puits: le métis Breland nous donne un coup de main.
'À Grande-Clairière, le sous-sol est exclusivement le sable d'une ancienne grève de la mer, très facile à creuser, et le niveau de l'eau n'est pas bien profond. On le trouve partout à deux ou trois mètres de profondeur. L'Alsacien, qui travaille au puits, s'en donne à plaisir: il n'a jamais fait de terrassement si commode; il travaille à peine depuis deux heures et il ne comprend pas pourquoi la couche de sable devient comme humide; il donne un coup de pelle de plus et voilà l'eau qui coule de tous côtés. Il pousse un long cri d'admiration, qui attire nos regards: le puits était creusé. Toutefois, plus loin dans 1a prairie, la chose n'est pas toujours aussi facile.
'Les travaux de mon chantier, eux aussi, étaient allés si rondement, que, dès le soir du même jour, nous pouvions nous installer: c'était tant bien que mal; mais enfin nous étions chez nous.
'La saison s'avançait, il était temps de faire le foin; ce genre d'ouvrage est assurément facile ici. J'empruntai une faucheuse et un râteau mécanique; le travail dura deux jours; le matin nous fauchions, le soir nous mettions en tas. Là-bas le fanage est inconnu: le foin, coupé le matin et laissé à lui-même, est sec le soir; deux jours plus tard 30 charges de foin étaient faites, prises à volonté dans la libre prairie.
'Il fallut ensuite songer aux étables. Dans la forêt voisine des arbres sont abattus, autant qu'il en faut; nous les transportons sur place, les équarrissons grossièrement, les superposons en forme de muraille primitive. Pour rendre ce mur plus chaud pour l'hiver, nous élevons contre une deuxième muraille de gazon; sur les murs nous posons des perches en travers, et sur ces perches nous jetons un peu de foin; avant l'hiver nous en accumulerons des masses plus considérables. C'est ainsi que se font ici les étables, surtout au début. Entre temps, je me procurai quelques vaches, des poules et quelques porcs, J'étais obligé de vivre pour le moment des produits de la ferme.
'Le restant de l'automne fut employé à terminer, autant que possible, les travaux simplement ébauchés, un peu partout. Je rendis peu à peu plus habitable mon chantier: ce fut mon ouvrage à moi. J'appris alors à manier facilement le marteau, la scie et le rabot. Mon pauvre chantier ne comportait qu'une chambre: c'était bien petit pour tant d'usages auxquels il devait servir. Il était, à la fois, cuisine, salle à manger, salon, chambre à coucher et église. Dès avant l'hiver, je songeai à un agrandissement notable. Ce nouvel agrandissement me procura, pour le premier hiver suivant, une belle salle pour y dire assez convenablement la messe.
'Il ne faudrait pas croire que les choses allaient toujours d'elles-mêmes et que mes jours s'écoulaient dans les doux transports d'un ardent enthousiasme. Ce premier été eut sans doute ses beaux jours, ses jours d'énergie et de courage; mais il eut aussi ses jours terribles. L'imagination est parfois pour nous une grande force, elle peut centupler notre énergie; mais souvent, comme elle est terrible et cruelle! Elle abat, elle écrase cette énergie qu'elle devrait exciter; elle vient nous trahir parfois au plus fort de l'épreuve. Je m'appliquais bien à raisonner mes impressions; mais l'imagination profitant de ces tristes jours où l'âme alourdie, par je ne sais quelle obsession de l'extérieur, paraît vouloir se décourager sans retour. Oue de fois, ce premier été de mon établissement, j'éprouvai ces sombres impressions, quand dans mes courses longues et solitaires, la fatigue, la chaleur, le froid, les intempéries de toutes sortes venaient fondre sur moi; quand surpris par la nuit, parfois bien épaisse, au milieu des broussailles, je me demandais, accablé, si je n'allais pas mourir, épuisé de fatigue et de faim; quand encore, taciturne, dans mon sombre chantier, solitaire séquestré de la société, je considérais le passé, regardais le présent, et questionnais l'avenir. Je faisais alors de vains appels à ma raison; pendant des heures, des journées entières, l'imagination cruelle, et les pensées sombres me torturaient, me broyaient l'âme sans merci; et moi, ne voulant pas me rendre pourtant, j'attendais inerte, écrasé, l'heure de la raison, l'heure de l'énergie et du courage. Je n'oublierai jamais ces mémorables alternatives de faiblesse et de force, de lassitude et d'ardeur. Tout d'abord, je ne démêlai qu'imparfaitement ces choses; plus tard je compris à merveille ces états psychologiques contradictoires. Lancé dans l'inconnu, me fatiguant à la recherche de bases d'opération fuyant toujours devant moi, je me trouvais, pour cette raison, dans un état de surexcitation éminemment propre à me faire ressentir le choc des influences du dehors.
'Cela une fois bien compris, je pris stoïquement mon parti: les sombres imaginations purent bien encore opérer leurs douloureux retours; accablé un moment, mais sûr du lendemain; tranquillement je laissais passer l'orage.
'On dira, peut-être, que j'assombris à plaisir le tableau: qu'on lise plutôt cette page de mon journal du 21 au 27 octobre.
«Nous sommes à la porte de l'hiver; mille choses restent à faire. Je suis un peu comme Job: le 23, un de mes chevaux, trop fatigué et sans doute trop vieux, est trouvé mort dans le bois voisin. Le 24 au soir mes deux vaches avec leurs veaux ne paraissent pas. Sont-elles perdues pour toujours? C'est possible. Et pourtant je dois partir pour Oak Lake, d'où je dois voiturer la quantité de planches nécessaires avant l'hiver. Cet hiver que je ne connais pas encore est bien un peu mon cauchemar! Un de mes chevaux est mort, l'autre va périr: je dois en louer d'autres. La chose n'est pas facile. À cette saison avancée, chaque fermier a besoin de ses bêtes pour terminer les derniers travaux; enfin je trouve mon affaire. Je pars, me traînant de ci de là pendant 4 jours. Que se passe-t-il chez moi? Mon autre cheval est-il péri? mes vaches sont-elles retrouvées? les incendies de prairie n'ont-il pas dévoré ma maison? Voilà cinq jours que je me démène à voiturer des planches à mi-chemin. Nous sommes au samedi soir, je dois rentrer chez moi pour le lendemain. Je laisse à leur maître les chevaux dont je me suis servi tous ces derniers jours; j'en trouve d'autres dans une ferme lointaine; je charge une masse de planches et je pars pour Grande-Clairière. La nuit me surprend à moitié chemin, nuit ténébreuse de fin d'octobre. Mon sentier disparaît complètement; il n'est du reste qu'un faible tracé visible à peine le jour. Malheur à moi si je le perds! je passerais dehors une nuit sombre, âcre et peut-être pluvieuse. Il me faut des précautions extrêmes. Je descends de voiture et marche à côté de mes chevaux, je les arrête à chaque pas pour tâtonner de la main si le sentier est bien toujours là: cela dure des heures. Grande-Clairière paraît se sauver devant moi. Enfin j'aperçois une lumière libératrice: c'est celle de Breland: deux kilomètres restent à faire; n'importe! je sais où je suis; je n'ai plus qu'à marcher à la lumière. Je respire. Trois minutes se passent; je regarde, plus de lumière; je tâte le sol, plus de sentier. Où suis-je? ai-je une fausse direction? Je fais un énorme effort de raisonnement; je tâche de marcher au mieux. Longtemps je désespère. Enfin la malheureuse lumière disparue réapparaît. J'en suis tout près, je retrouve mon chemin près de la maison; dix minutes plus tard, je suis chez moi. Il est neuf heures du soir; depuis six heures du matin, je n'ai plus rien mangé, si ce n'est un morceau de pain sec que j'ai trouvé dans ma poche! En rentrant, j'apprends d'assez bonnes nouvelles, j'oublie toutes mes misères, j'espère des jours meilleurs pour la semaine suivante.»
Hélas! elle devait être tout aussi terrible. Voilà dans quelles angoisses et au milieu de quelles fatigues se termina mon premier été à Grande-Clairière. Depuis le mois de juillet, les choses étaient allées bon train; d'autres familles étaient venues rejoindre les trois premières; elles étaient maintenant au nombre de dix et toutes très nombreuses. J'avais beau être ingénieux, mon petit chantier, qui servait d'église le dimanche, devenait absolument trop petit. Un agrandissement s'imposait, j'étudiai la question, et il fut résolu qu'un bâtiment de 8 mètres sur 5 serait construit, àccolé au chantier primitif, avec lequel il ne ferait qu'un.
Cette construction devait se faire vers la Toussaint. Je m'étais assuré les services d'un menuisier canadien français. Celui-ci, sans même prendre la peine de m'en avertir, ne vint pas. Heureusement mes bons métis étaient là, ils s'offrent spontanément. Le 31 octobre, six d'entre eux, tous bons constructeurs, viennent au rendez-vous chargés de leurs outils. Les voilà à l'oeuvre, je suis avec eux: nous y allons à grands coups; le tas de planches est rudement mis à contribution, et le soir du premier jour, le gros des murs est en partie debout. Nous soupons heureux tous ensemble; après souper nous causons, et la chose prend si bien qu'à la fin l'on se met à chanter. Thomas Breland se surpasse: il nous chante avec esprit 'la dispute d'un ivrogne avec sa femme'', puis un chant de victoire des métis sur les stipendiés. On le voit, la poésie se rencontre partout.
Nous laissons passer la Toussaint, et les planches manquant, nous ne reprendrons nos travaux que le 6 novembre. Après bien des contre-temps, le bâtiment était assez achevé pour me permettre d'y chanter la messe dès le dimanche 25 novembre. Ce fut grande fête, et si je ne me trompe, ce fut ma première messe chantée à Grande-Clairière devant mes paroissiens réunis au grand complet; mes bons métis reçurent de moi des remerciements mérités.
À ce moment 8 familles de métis et 2 familles françaises composaient toute ma paroisse; ce chiffre était modeste sans doute, mais ma population n'en avait pas moins triplé en quatre mois. Il y avait là un beau succès qui en faisait présager de plus grands encore.
Les chiffres suivants donneront une idée de mon activité, ce premier été pendant 5 mois.
J'y ai fait 3 fois le voyage aller et retour de Winnipeg, St-Boniface 3 × 600 km 1.800 km
4 fois le voyage de Brandon 4 × 200 km 800 km
25 fois le voyage d'Oak Lake 25 × 64 km 1.600 km
2 fois le voyage de St-Pierre 2 × 175 km 350 km
voyages de St-Eustache, Ste-Agathe, Piguis, etc. 400 km
Total, dont 900 km au moins à pied 4.950 km
(Les Cloches de Saint-Boniface, vol. 39, #5, mai 1940)
On doit célébrer cette année le cinquantenaire de la fondation de la paroisse de Saint-Hubert en Saskatchewan. La paroisse de Grande-Clairière et les paroisses filiales – Saint-Maurice et Saint-Raphaël – sont à peu près de la même époque. En plus, plus près de nous, M. l'abbé Benoît, l'infatigable curé de St-Malo, s'apprête à célébrer le cinquantenaire de sa paroisse. Là aussi il y eut un groupement de Français qui rappelle quelque peu celui de Fannystelle.
Nous avons cru bon, afin de rappeler ces souvenirs, de donner ici quelques extraits d'un livre presque oublié de Monseigneur Gaire, le fondateur de Grande-Clairière, venu ici en 1888, intitulé 'Dix années de missions au grand Nord-Ouest canadien'.
L'auteur y raconte tout d'abord ce qui l'amena à vouloir fonder une colonie au Manitoba:
'C'était un matin de l'été 1885. Je rentrais chez moi après la messe. Mon courrier venait d'arriver. Au milieu de prospectus, de lettres et de journaux, j'aperçois une brochure peu épaisse, dont la couverture bleue tranche sur tout le reste. Saisir le livre, en déchirer la bande, est pour moi l'affaire d'une seconde. Le livre a pour titre: 'Guide du colon français au Canada', et il finit par la signature d'un prêtre canadien français. Ma curiosité est piquée. Je saisis une chaise et m'y assieds; je lis attentivement la première page du livre, dévore la deuxième, puis la troisième; trois quarts d'heure plus tard, l'ouvrage tout entier y avait passé. La brochure exposait les avantages offerts aux colons canadiens, elle parlait de ces immenses lots gratuits que le gouvernement accorde à tout colon, qui veut bien les recevoir. Je comprenais facilement cela: mais il me semblait, en outre, lire entre les lignes comme un appel désespéré; il me semblait entendre comme le son de la trompette d'alarme, appelant des frères au secours d'autres frères. Je voulus relire la brochure mystérieuse; je la relus ensuite bien des fois encore, et toutes ces lectures ne firent que confirmer mes premières impressions. Les catholiques français du Canada ont là-bas de redoutables ennemis, me dis-je; eh bien, je serai de la bataille!
'Toutefois, craignant d'être en cela le jouet de sentiments enthousiastes, si naturels à trente ans, je ne voulus rien précipiter; je soumis ma vocation à l'épreuve du temps, j'accordai deux grandes années à la réflexion. Entre temps, je fis part de mes projets aux parents et amis; et, comme bien l'on pense, un sarcasme absolu et général fut la réponse de tous à mes ouvertures. Cela ne me contraria pas le moins du monde. Je m'y attendais; mais très philosophiquement je laissai les amis se moquer de mes desseins, et débiter leurs éloquents discours à l'encontre. Je continuai de sonder devant Dieu la réalité d'une vocation qui devenait tous les jours plus ardente et plus décidée.
'Et pourquoi ne pas le dire? Les attentats contre la religion, que je voyais se perpétrer en France, étaient bien faits pour me confirmer dans ma décision. J'aurais encore compris que des impies votassent pour des représentants impies; mais l'aveuglement de tant de catholiques, votant pour des sectaires ennemis, me paraissait insupportable; assurément mes paroissiens de Loisy et de Bezaumont ne m'avaient pas donné cette affligeant spectacle; mais si eux-mêmes votaient bien, trop souvent ailleurs l'on votait mal.
'Toutefois si je partais indigné contre les hommes, je restais cependant profondément attaché à mon pays; le Canada était pour moi comme un prolongement de la patrie française; j'y allais pour y combattre comme Catholique et Français; ces deux mots résument tout mon plan de campagne en Canada.
'Quand tout fut prêt, et que j'eus mis la dernière main à mes oeuvres paroissiales inachevées, je songeai à régler, avec mon évêque, l'affaire du départ. J'y allais si bonnement, que l'idée ne m'était pas même venue que de ce côté-là des obstacles pourraient surgir. Convaincu que Dieu m'appelait au Canada, et que beaucoup de bien y était à faire, je ne prévoyais pas comment mon évêque pourrait me réfuser son assentiment. Je le lui demandai donc dans une lettre courte, franche, presque ingénue. La réponse tarda longtemps; je compris alors que les choses n'iraient pas toutes seules; mais malgré ma vive ardeur, je ne bougeai pas davantage: je sentais que m'agiter serait maladroit. Enfin la lettre arriva. Cette lettre du Vicaire général, supposant sans doute une détermination chancelante de ma part, me disait comme conclusion: 'Mon seigneur vous engage donc à continuer dans son diocèse le bien que vous y avez déjà commencé.' Le mot 'son diocèse' me parut étroit: quelque chose me disait, que ni Jésus-Christ, ni les apôtres ne l'avaient connu. J'avais là une base formidable de réplique: ma réponse fut longue et vive, mais soumise et respectueuse. En terminant, je disais: 'Monseigneur, je le vois, vous avez voulu éprouver la solidité de ma vocation; vous pouvez continuer l'épreuve: mais dans un an, dans vingt ans, vous me trouverez toujours animé des mêmes intentions.' Et plus haut j'avais dit: 'Ce n'est ni l'or, ni la gloire, ni le bien-être, qui m'attirent là-bas; c'est donc Dieu qui m'y appelle.' Ma victoire fut complète. Quarante-huit heures plus tard, je tenais mon exeat dans mes mains; j'étais libre de partir.'
Voici maintenant l'arrivée à Winnipeg et à Saint-Boniface en 1888:
'Puis voilà un grand mouvement dans le train: on vient d'annoncer Winnipeg; déjà nous en longeons les premières maisons. Les voyageurs rangent fiévreusement leurs paquets: nous voilà sur le pont de la Rivière-Rouge; puis au milieu d'un pêle-mêle de maisons construites à la hâte, et le plus souvent jetées là en désordre: tant l'activité fiévreuse des débuts de la cité a été grande. Notre train s'arrête: tous descendent; je descends moi-même très perplexe. Je ne savais de quel côté me diriger. Me voilà devant une gare immense, devant moi grouille un peuple énorme de curieux, qui sont là uniquement pour voir passer le train. Quelques-uns cependant viennent au devant d'amis qu'ils attendaient, de tous côtés l'anglais résonne, sourd, nasillard: Winnipeg est presque tout entière anglaise; la ville est d'hier et elle compte déjà 30,000 âmes. Je sais que Saint-Boniface, la ville française et catholique, la cité archiépiscopale est toute proche. Mais à qui pourrais-je demander ma direction. Je dois à mon rabat mon salut; un brave Canadien français reconnaît à ce signe un prêtre de France: il m'aborde, m'offre son concours charitable. Nous traversons Winnipeg. Cette ville qui date de 1870, est déjà très opulente, ses magasins regorgent de tout le luxe et le confort américain, je suis absolument ébahi.
'Me voilà à l'extrême sud de la ville. Devant moi coule la Rivière-Rouge. Sur l'autre rive, je vois surgir un clocher élancé, et, autour de ce clocher, j'aperçois plusieurs édifices imposants. Ce clocher est la cathédrale de Saint-Boniface; ces édifices que je vois autour sont: à gauche, l'archevêché, à droite le pensionnat des filles, en arrière, le très important collège des Jésuits. Je remercie mon guide, et me voilà arpentant vivement l'interminable pont de la rivière. Enfin je suis à l'autre bout: sur la première maison à droite, je lis 'bureau de poste', en bon français; un peu plus loin à gauche, un marchand s'est donné pour enseigne le vrai drapeau français. Je tourne le bureau de poste et me voilà dans la rue qui conduit à l'archevêché. Un jardin planté d'érables s'étend devant l'édifice, auquel il donne un aspect riant; déjà je suis à la hauteur de la clôture peinte en blanc de ce jardin, quand, à trois pas devant moi, j'aperçois un bon vieux, je remarque en même temps qu'il me sourit. Pour la seconde fois mon rabat me trahissait. Ce bon vieux qui me sourit est le Frère Jean, l'inséparable compagnon de l'illustre missionnaire Taché. Et le bon Frère, tout bonnement, me prenant presque par le bras, me conduit tout droit au réfectoire de l'archevêché, me tient compagnie, pendant qu'on m'apporte des plats variés auxquels je touche à peine; mais, dévoré par une fièvre brûlante depuis plusieurs jours, je bois en trois rasades puissantes tout le contenu d'une grande cruche pleine de lait. Le Frère Jean, rempli d'effroi pour mon estomac, commence à s'agiter; mais d'un geste je le rassure; il rit de bon coeur et moi j'en fais autant.
'Un instant après, le vieil archevêque Taché me recevait avec toutes les effusions de son noble coeur. Toujours je me rappellerai cette inoubliable entrevue. Pourtant, en me voyant pour la première fois, à la fin d'un long voyage, épuisé des suites d'une traversée pénible, ayant juste assez mangé pour ne pas mourir de faim pendant près d'un mois, il dut se dire: Que pourra faire ici ce moribond? Puisse Dieu lui donner des forces!
'C'est ainsi que mon premier jour au Manitoba fut un beau jour. J'étais écrasé, le 25 avril, en quittant la France; j'étais superbe de bonheur et d'entrain le 21 mai suivant.'
L'abbé Gaire a d'abord été l'hôte de l'abbé Jolys et il a visité certains centres français. Il conçoit l'idée d'aller fonder une paroisse dans l'ouest de la province, où le pays est actuellement à se faire envahir par les colons d'autres races et d'autres religions. Il se rend en juillet au lac des Chênes (Oak Lake). C'est de là que le missionnaire colonisateur part pour aller fonder sa paroisse. On traverse des marécages sans nombre puis on arrive à un endroit plus élevé. C'est là que M. Gaire décide d'établir Grande-Clairière. Il y a dans la région trois familles de Métis. M. Gaire va à Brandon remplir les formalités nécessaires et signer les papiers. Il devient propriétaire. Puis voilà M. Gaire seul, sur son lot et en face d'une cabane.
Un combat se livre en lui devant l'immensité de l'effort. Puis voilà qu'un Canadien arrive, venu de cinquante milles pour vérifier s'il est vrai qu'un prêtre veut fonder une colonie. C'est le premier colon. Le missionnaire habite d'abord la maison de Thomas Breland, Métis de l'endroit, qui offre sa modeste demeure au prêtre.
Voici comment le courageux fondateur raconte ses débuts:
'La nuit est arrivée: Mme Breland se retire sous la tente avec ses trois enfants, et chasse les cousins, ferme hermétiquement l'ouverture, allume une lampe, puis je l'entends qui fait prier ses enfants. De son côté Thomas allume un brasier fumeux devant la maison, puis apporte deux chaises, sur lesquelles nous prenons place en facen l'un de l'autre à côté du feu. La fumée du brasier chasse les maringouins (cousins), alors Thomas et moi nous pouvons respirer tranquillement l'air pur d'une nuit fraîche et douce. Et voilà que mon pauvre métis commence à disserter en vrai philosophe chrétien. Il me parle de ces 'blancs', qui trompent dans les marchés et ne réparent jamais leurs injustices. Il cause du mariage chrétien; s'élève contre certains crimes qui le profanent; puis tout d'un coup se lance dans la narration des grandes chasses d'autrefois.
'Pour moi, je suis ravi de tout ce que je vois; je sens qu'il va faire bon vivre au milieu de si bonnes gens: il ne reste plus rien de mes appréhensions du jour. Thomas a fini de causer, nous allons nous reposer.
'Je ne suis pas douillet, pourtant, pourtant je ne puis m'empêcher de trouver dur mon lit; on y regardera demain. D'autre part, je commence à éprouver les premiers feux d'abcès qui vont bientôt me couvrir une partie du cou et de la figure. J'attribuai ces misères aux piqûres des maringouins; mais quand je donnai cette explication au bon Frère Jean, il m'arrêta en souriant: d'après lui je payais ainsi mon tribut aux privations de toutes sortes par lesquelles j'étais obligé de passer. Et maintenant je crois de plus en plus que le Frère Jean avait raison.
'Cependant le soleil du 22 juillet s'est levé: c'est dimanche, je vais dire aujourd'hui ma première messe dans la solitude qui désormais s'appellera Grande-Clairière; j'ai choisi un nom bien topique et bien français, capable de résister à tout essai d'anglicisation.
'Nous rangeons parfaitement la chaumière de Breland; une table est mise à la belle place et transformée en autel. À neuf heures, mes trois familles de métis sont là, six adultes et dix enfants. Je n'ai ni chantres ni enfants de choeur; je dis une messe basse et je me sers moi-même: entre temps je puis admirer la piété simple et franche de ces braves gens.
'Ainsi fut célébrée ma première messe à Grande-Clairière. Humbles mais délicieux débuts, je ne vous oublierai jamais!
'Le lendemain deux ouvriers constructeurs m'arrivent. Je les conduis à l'endroit où je veux élever mon 'chantier': nous nous mettons à l'oeuvre aussitôt, le carré de la maison est établi, ce jour même; le lendemain les murs en planches sont élevés; le surlendemain les planches de la toiture sont fixés. Mon chantier est dressé, mais il est loin d'être fini: le deuxième rang de planches manque aux murs, et les bardeaux à la toiture; il n'y a encore ni portes ni fenêtres, le plancher de l'intérieur manque totalement. Tel quel, mon chantier mesure 5 mètres sur 4. Mais mon porte-monnaie est vide: pour le moment, je dois m'en tenir là.
'Pourtant j'attends de l'argent; je profite de la voiture de mes ouvriers qui s'en retournent chez eux et me rends ainsi au bureau d'Oak Lake. Une lettre m'apprend que les mandats attendus sont arrivés, mais je dois aller les toucher à Winnipeg. J'y vais, je reçois mon argent, je passe ensuite à Saint-Boniface, où je suis les exercices de la retraite, tout en soignant mes abcès.
'Je me repose ainsi du 27 juillet au 9 août. Ce dernier jour, deux Alsaciens viennent me rejoindre; je pars avec eux le lendemain pour Grande-Clairière, où nous arrivons dans la nuit du 11 accompagnés de tout un attirail de ménage et de ferme. Nous venons frapper tard dans la nuit chez Breland; nous nous 'campons' au milieu de la chambre sur des couvertures, et nous dormons comme nous pouvons. Le lendemain, je dis ma deuxième messe dans la solitude; mon assistance s'est accrue des deux Alsaciens de la veille. Après le dîner, ces deux hommes vont faire une partie de chasse; ils reviennent sur le soir, tout fiers de montrer les canards sauvages qu'ils ont tués. Oh le bon pays que le Canada! Ce n'est pas l'Europe qui offre ces libertés: le gibier y est introuvable, et là n'est pas chasseur qui veut! Ainsi s'exaltent nos deux nouveaux venus. Je ne sais encore ce que je ferai de ces deux hommes; en attendant mieux, je les prends à mon service. Le lundi, de bonne heure, nous partons pour le chantier inachevé, situé à 500 mètres de là; nous travaillons dur, qui à la toiture, qui au plancher, qui à la muraille, qui au puits: le métis Breland nous donne un coup de main.
'À Grande-Clairière, le sous-sol est exclusivement le sable d'une ancienne grève de la mer, très facile à creuser, et le niveau de l'eau n'est pas bien profond. On le trouve partout à deux ou trois mètres de profondeur. L'Alsacien, qui travaille au puits, s'en donne à plaisir: il n'a jamais fait de terrassement si commode; il travaille à peine depuis deux heures et il ne comprend pas pourquoi la couche de sable devient comme humide; il donne un coup de pelle de plus et voilà l'eau qui coule de tous côtés. Il pousse un long cri d'admiration, qui attire nos regards: le puits était creusé. Toutefois, plus loin dans 1a prairie, la chose n'est pas toujours aussi facile.
'Les travaux de mon chantier, eux aussi, étaient allés si rondement, que, dès le soir du même jour, nous pouvions nous installer: c'était tant bien que mal; mais enfin nous étions chez nous.
'La saison s'avançait, il était temps de faire le foin; ce genre d'ouvrage est assurément facile ici. J'empruntai une faucheuse et un râteau mécanique; le travail dura deux jours; le matin nous fauchions, le soir nous mettions en tas. Là-bas le fanage est inconnu: le foin, coupé le matin et laissé à lui-même, est sec le soir; deux jours plus tard 30 charges de foin étaient faites, prises à volonté dans la libre prairie.
'Il fallut ensuite songer aux étables. Dans la forêt voisine des arbres sont abattus, autant qu'il en faut; nous les transportons sur place, les équarrissons grossièrement, les superposons en forme de muraille primitive. Pour rendre ce mur plus chaud pour l'hiver, nous élevons contre une deuxième muraille de gazon; sur les murs nous posons des perches en travers, et sur ces perches nous jetons un peu de foin; avant l'hiver nous en accumulerons des masses plus considérables. C'est ainsi que se font ici les étables, surtout au début. Entre temps, je me procurai quelques vaches, des poules et quelques porcs, J'étais obligé de vivre pour le moment des produits de la ferme.
'Le restant de l'automne fut employé à terminer, autant que possible, les travaux simplement ébauchés, un peu partout. Je rendis peu à peu plus habitable mon chantier: ce fut mon ouvrage à moi. J'appris alors à manier facilement le marteau, la scie et le rabot. Mon pauvre chantier ne comportait qu'une chambre: c'était bien petit pour tant d'usages auxquels il devait servir. Il était, à la fois, cuisine, salle à manger, salon, chambre à coucher et église. Dès avant l'hiver, je songeai à un agrandissement notable. Ce nouvel agrandissement me procura, pour le premier hiver suivant, une belle salle pour y dire assez convenablement la messe.
'Il ne faudrait pas croire que les choses allaient toujours d'elles-mêmes et que mes jours s'écoulaient dans les doux transports d'un ardent enthousiasme. Ce premier été eut sans doute ses beaux jours, ses jours d'énergie et de courage; mais il eut aussi ses jours terribles. L'imagination est parfois pour nous une grande force, elle peut centupler notre énergie; mais souvent, comme elle est terrible et cruelle! Elle abat, elle écrase cette énergie qu'elle devrait exciter; elle vient nous trahir parfois au plus fort de l'épreuve. Je m'appliquais bien à raisonner mes impressions; mais l'imagination profitant de ces tristes jours où l'âme alourdie, par je ne sais quelle obsession de l'extérieur, paraît vouloir se décourager sans retour. Oue de fois, ce premier été de mon établissement, j'éprouvai ces sombres impressions, quand dans mes courses longues et solitaires, la fatigue, la chaleur, le froid, les intempéries de toutes sortes venaient fondre sur moi; quand surpris par la nuit, parfois bien épaisse, au milieu des broussailles, je me demandais, accablé, si je n'allais pas mourir, épuisé de fatigue et de faim; quand encore, taciturne, dans mon sombre chantier, solitaire séquestré de la société, je considérais le passé, regardais le présent, et questionnais l'avenir. Je faisais alors de vains appels à ma raison; pendant des heures, des journées entières, l'imagination cruelle, et les pensées sombres me torturaient, me broyaient l'âme sans merci; et moi, ne voulant pas me rendre pourtant, j'attendais inerte, écrasé, l'heure de la raison, l'heure de l'énergie et du courage. Je n'oublierai jamais ces mémorables alternatives de faiblesse et de force, de lassitude et d'ardeur. Tout d'abord, je ne démêlai qu'imparfaitement ces choses; plus tard je compris à merveille ces états psychologiques contradictoires. Lancé dans l'inconnu, me fatiguant à la recherche de bases d'opération fuyant toujours devant moi, je me trouvais, pour cette raison, dans un état de surexcitation éminemment propre à me faire ressentir le choc des influences du dehors.
'Cela une fois bien compris, je pris stoïquement mon parti: les sombres imaginations purent bien encore opérer leurs douloureux retours; accablé un moment, mais sûr du lendemain; tranquillement je laissais passer l'orage.
'On dira, peut-être, que j'assombris à plaisir le tableau: qu'on lise plutôt cette page de mon journal du 21 au 27 octobre.
«Nous sommes à la porte de l'hiver; mille choses restent à faire. Je suis un peu comme Job: le 23, un de mes chevaux, trop fatigué et sans doute trop vieux, est trouvé mort dans le bois voisin. Le 24 au soir mes deux vaches avec leurs veaux ne paraissent pas. Sont-elles perdues pour toujours? C'est possible. Et pourtant je dois partir pour Oak Lake, d'où je dois voiturer la quantité de planches nécessaires avant l'hiver. Cet hiver que je ne connais pas encore est bien un peu mon cauchemar! Un de mes chevaux est mort, l'autre va périr: je dois en louer d'autres. La chose n'est pas facile. À cette saison avancée, chaque fermier a besoin de ses bêtes pour terminer les derniers travaux; enfin je trouve mon affaire. Je pars, me traînant de ci de là pendant 4 jours. Que se passe-t-il chez moi? Mon autre cheval est-il péri? mes vaches sont-elles retrouvées? les incendies de prairie n'ont-il pas dévoré ma maison? Voilà cinq jours que je me démène à voiturer des planches à mi-chemin. Nous sommes au samedi soir, je dois rentrer chez moi pour le lendemain. Je laisse à leur maître les chevaux dont je me suis servi tous ces derniers jours; j'en trouve d'autres dans une ferme lointaine; je charge une masse de planches et je pars pour Grande-Clairière. La nuit me surprend à moitié chemin, nuit ténébreuse de fin d'octobre. Mon sentier disparaît complètement; il n'est du reste qu'un faible tracé visible à peine le jour. Malheur à moi si je le perds! je passerais dehors une nuit sombre, âcre et peut-être pluvieuse. Il me faut des précautions extrêmes. Je descends de voiture et marche à côté de mes chevaux, je les arrête à chaque pas pour tâtonner de la main si le sentier est bien toujours là: cela dure des heures. Grande-Clairière paraît se sauver devant moi. Enfin j'aperçois une lumière libératrice: c'est celle de Breland: deux kilomètres restent à faire; n'importe! je sais où je suis; je n'ai plus qu'à marcher à la lumière. Je respire. Trois minutes se passent; je regarde, plus de lumière; je tâte le sol, plus de sentier. Où suis-je? ai-je une fausse direction? Je fais un énorme effort de raisonnement; je tâche de marcher au mieux. Longtemps je désespère. Enfin la malheureuse lumière disparue réapparaît. J'en suis tout près, je retrouve mon chemin près de la maison; dix minutes plus tard, je suis chez moi. Il est neuf heures du soir; depuis six heures du matin, je n'ai plus rien mangé, si ce n'est un morceau de pain sec que j'ai trouvé dans ma poche! En rentrant, j'apprends d'assez bonnes nouvelles, j'oublie toutes mes misères, j'espère des jours meilleurs pour la semaine suivante.»
Hélas! elle devait être tout aussi terrible. Voilà dans quelles angoisses et au milieu de quelles fatigues se termina mon premier été à Grande-Clairière. Depuis le mois de juillet, les choses étaient allées bon train; d'autres familles étaient venues rejoindre les trois premières; elles étaient maintenant au nombre de dix et toutes très nombreuses. J'avais beau être ingénieux, mon petit chantier, qui servait d'église le dimanche, devenait absolument trop petit. Un agrandissement s'imposait, j'étudiai la question, et il fut résolu qu'un bâtiment de 8 mètres sur 5 serait construit, àccolé au chantier primitif, avec lequel il ne ferait qu'un.
Cette construction devait se faire vers la Toussaint. Je m'étais assuré les services d'un menuisier canadien français. Celui-ci, sans même prendre la peine de m'en avertir, ne vint pas. Heureusement mes bons métis étaient là, ils s'offrent spontanément. Le 31 octobre, six d'entre eux, tous bons constructeurs, viennent au rendez-vous chargés de leurs outils. Les voilà à l'oeuvre, je suis avec eux: nous y allons à grands coups; le tas de planches est rudement mis à contribution, et le soir du premier jour, le gros des murs est en partie debout. Nous soupons heureux tous ensemble; après souper nous causons, et la chose prend si bien qu'à la fin l'on se met à chanter. Thomas Breland se surpasse: il nous chante avec esprit 'la dispute d'un ivrogne avec sa femme'', puis un chant de victoire des métis sur les stipendiés. On le voit, la poésie se rencontre partout.
Nous laissons passer la Toussaint, et les planches manquant, nous ne reprendrons nos travaux que le 6 novembre. Après bien des contre-temps, le bâtiment était assez achevé pour me permettre d'y chanter la messe dès le dimanche 25 novembre. Ce fut grande fête, et si je ne me trompe, ce fut ma première messe chantée à Grande-Clairière devant mes paroissiens réunis au grand complet; mes bons métis reçurent de moi des remerciements mérités.
À ce moment 8 familles de métis et 2 familles françaises composaient toute ma paroisse; ce chiffre était modeste sans doute, mais ma population n'en avait pas moins triplé en quatre mois. Il y avait là un beau succès qui en faisait présager de plus grands encore.
Les chiffres suivants donneront une idée de mon activité, ce premier été pendant 5 mois.
J'y ai fait 3 fois le voyage aller et retour de Winnipeg, St-Boniface 3 × 600 km 1.800 km
4 fois le voyage de Brandon 4 × 200 km 800 km
25 fois le voyage d'Oak Lake 25 × 64 km 1.600 km
2 fois le voyage de St-Pierre 2 × 175 km 350 km
voyages de St-Eustache, Ste-Agathe, Piguis, etc. 400 km
Total, dont 900 km au moins à pied 4.950 km
(Les Cloches de Saint-Boniface, vol. 39, #5, mai 1940)